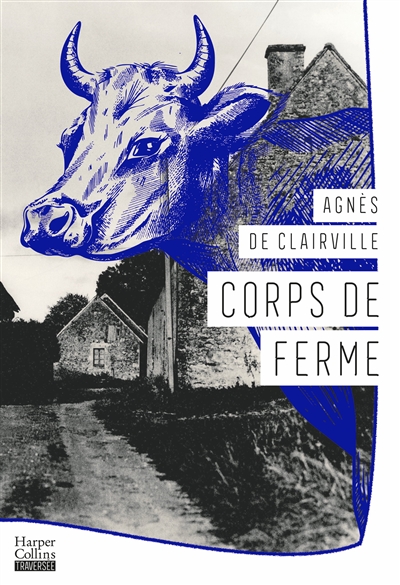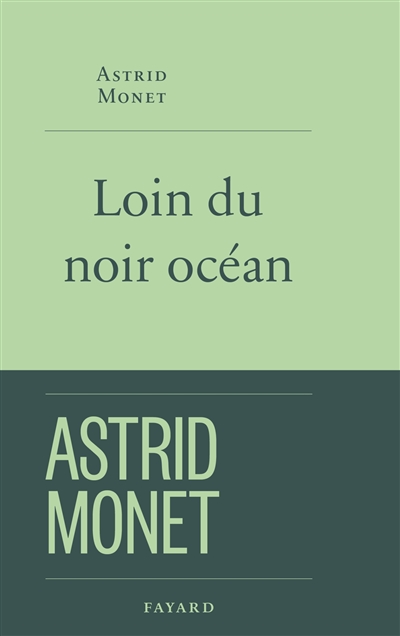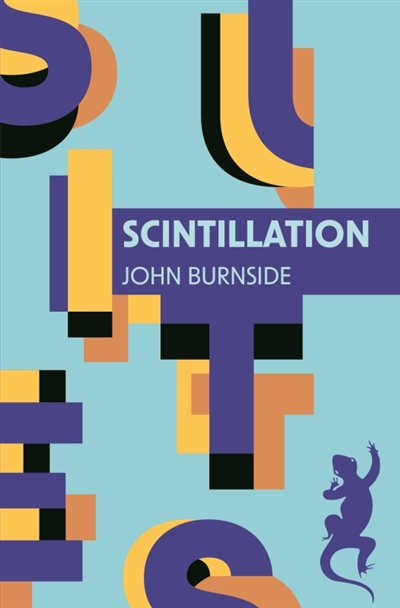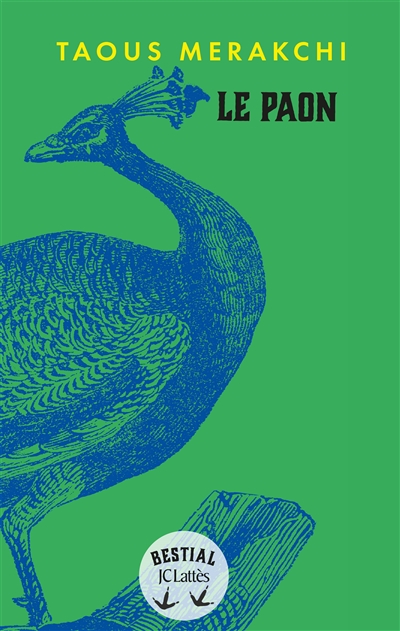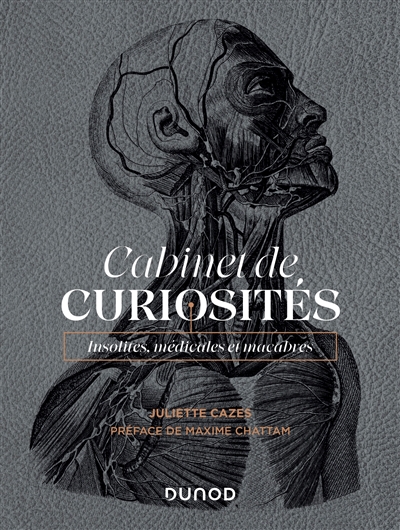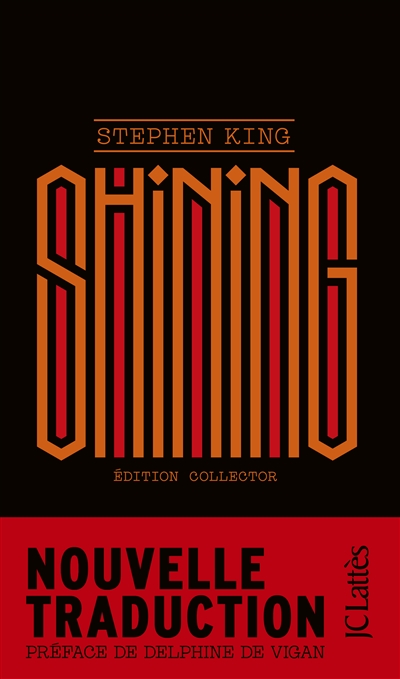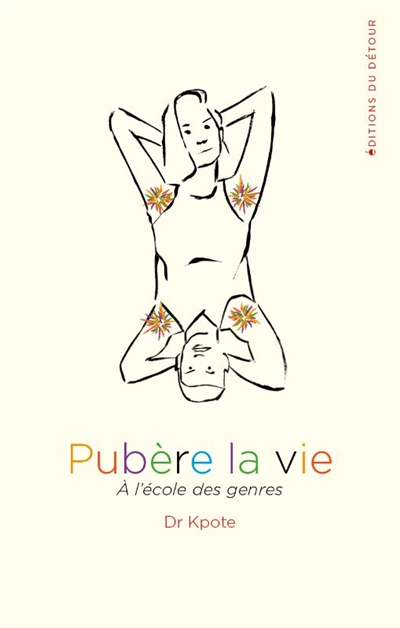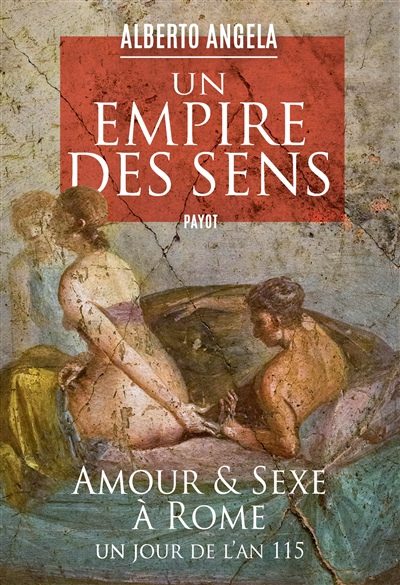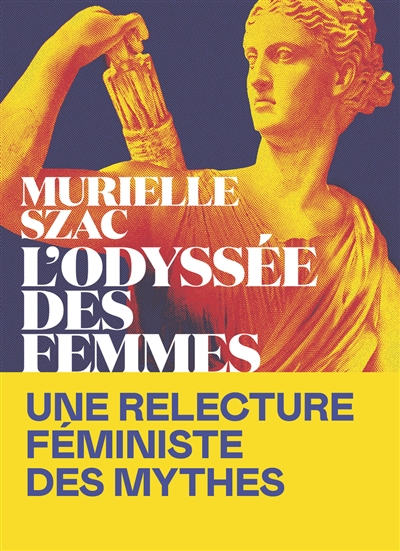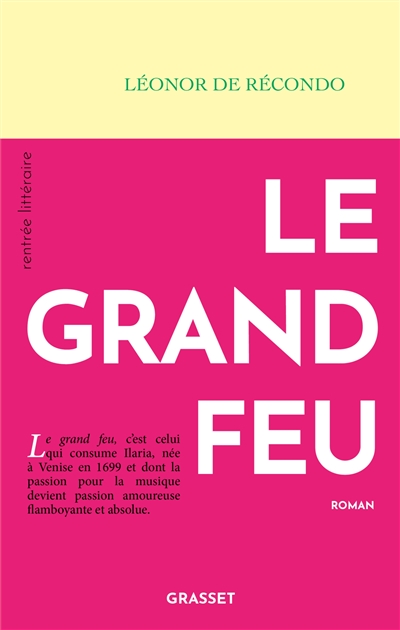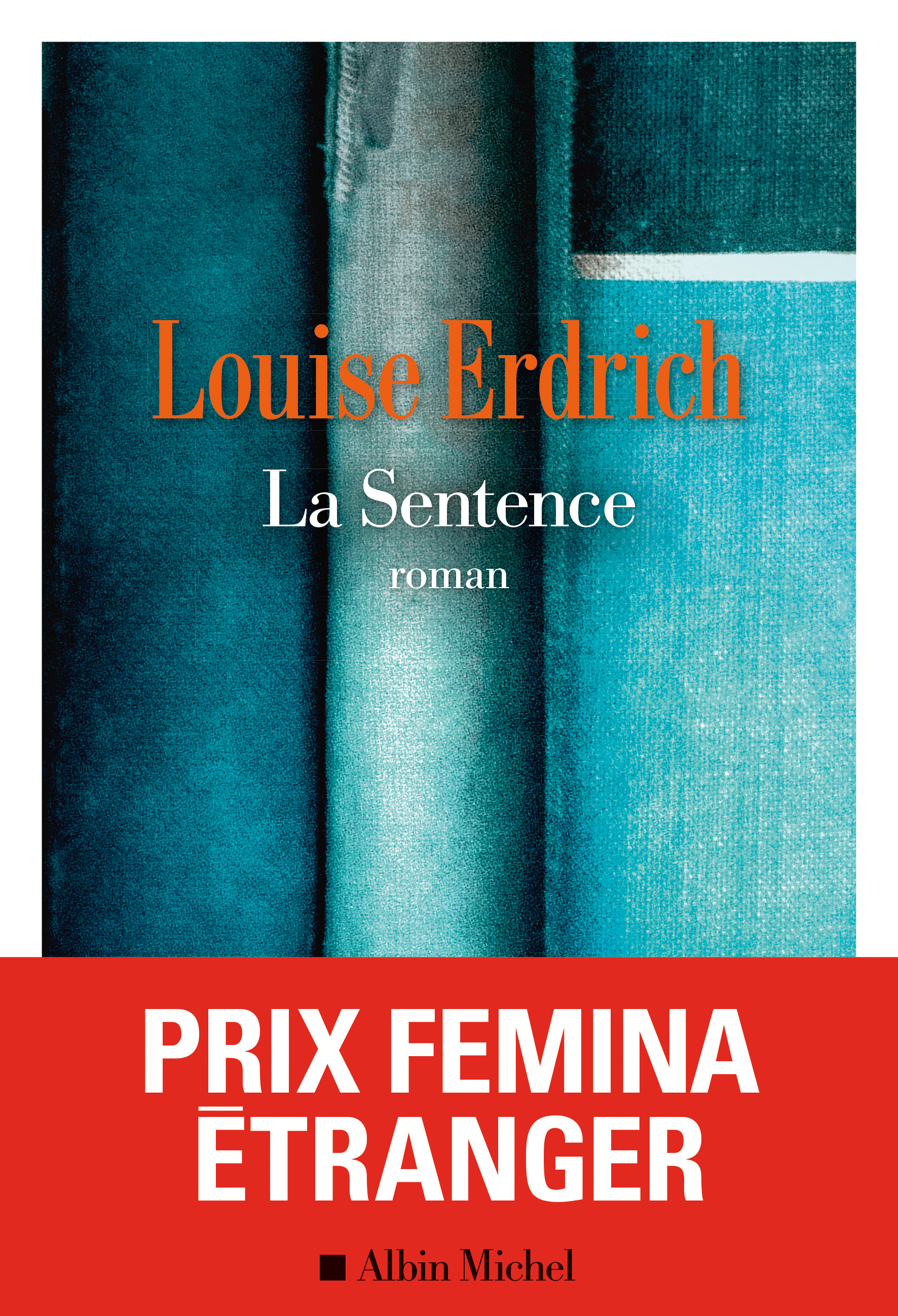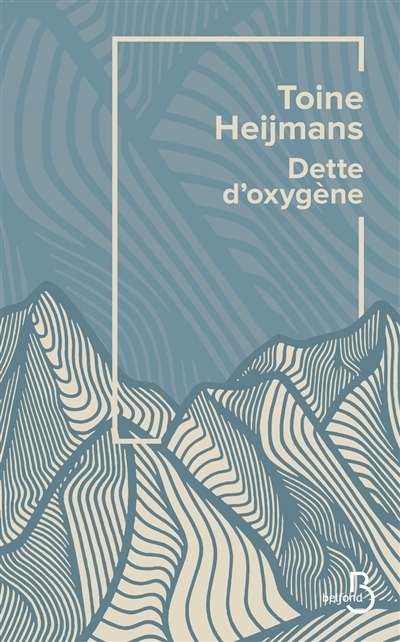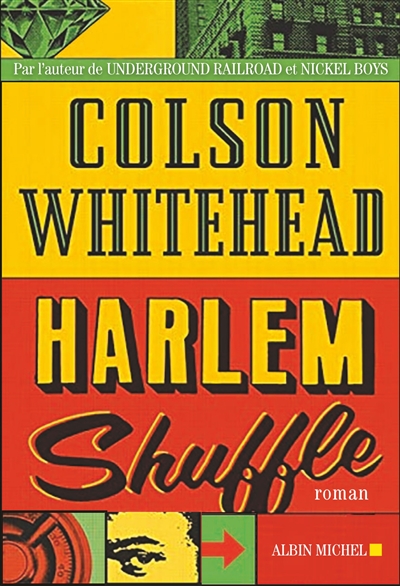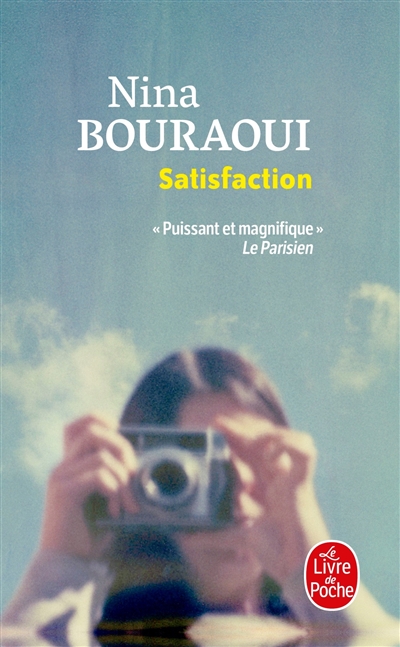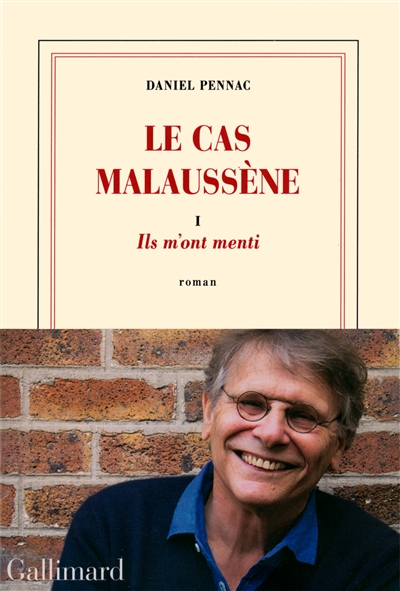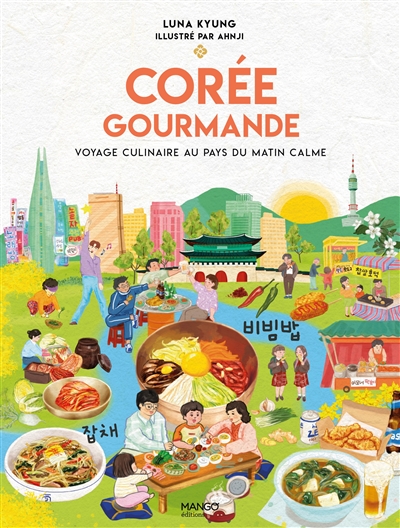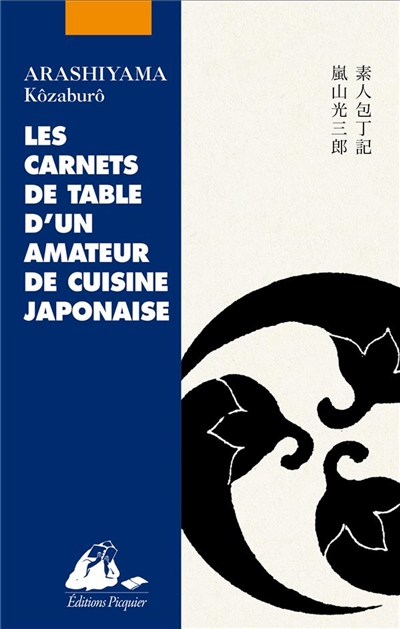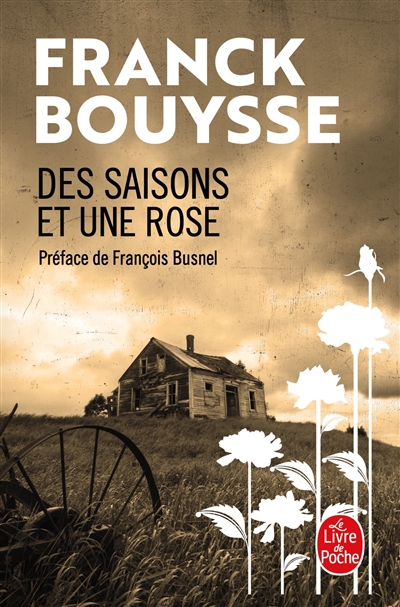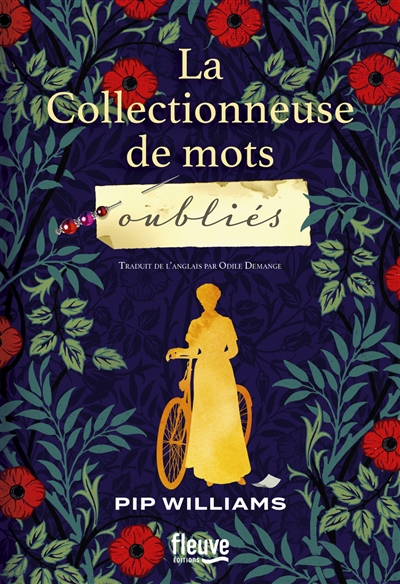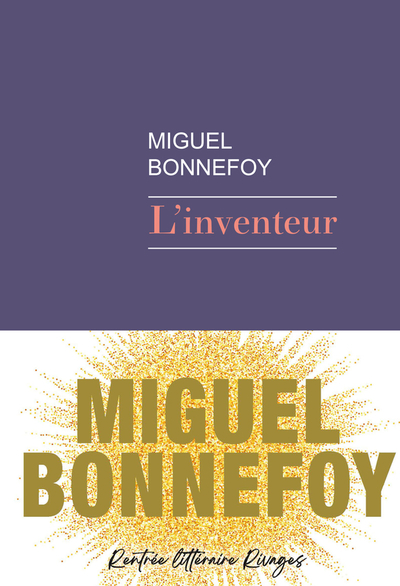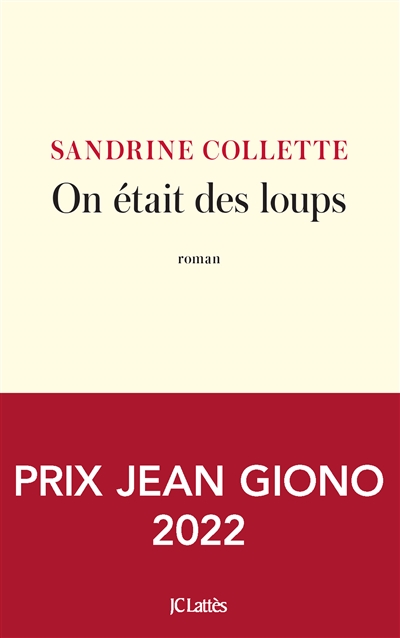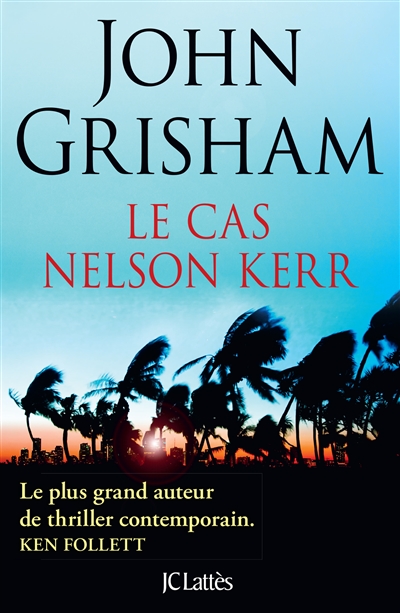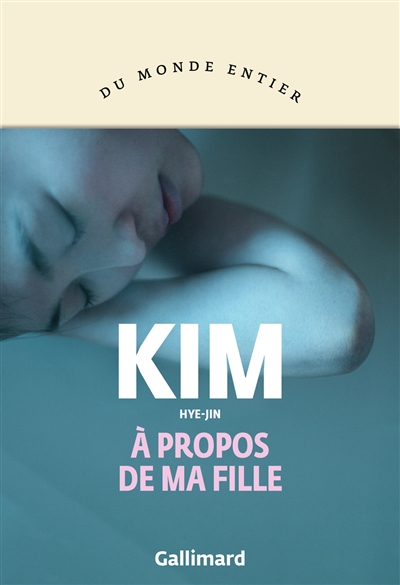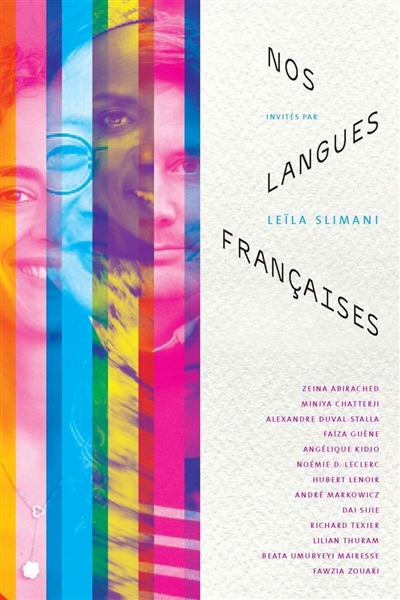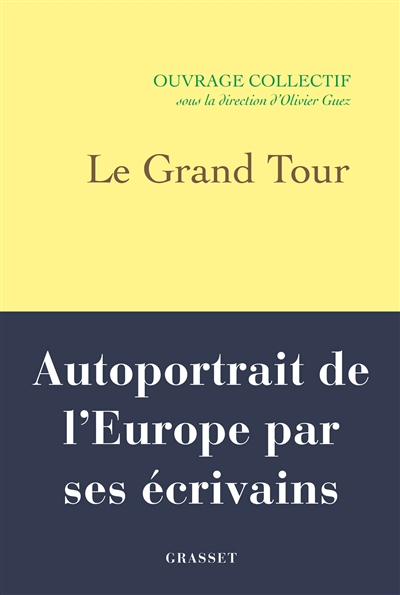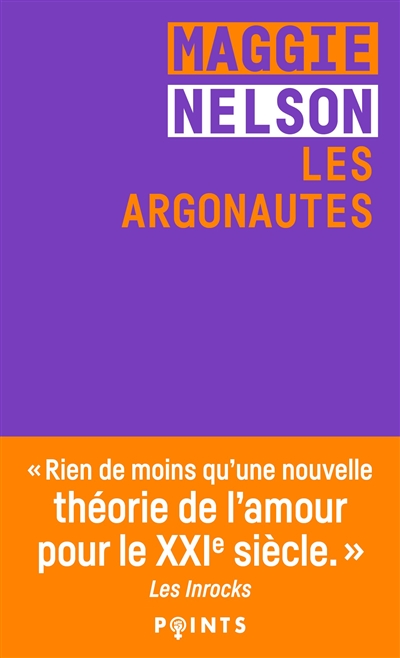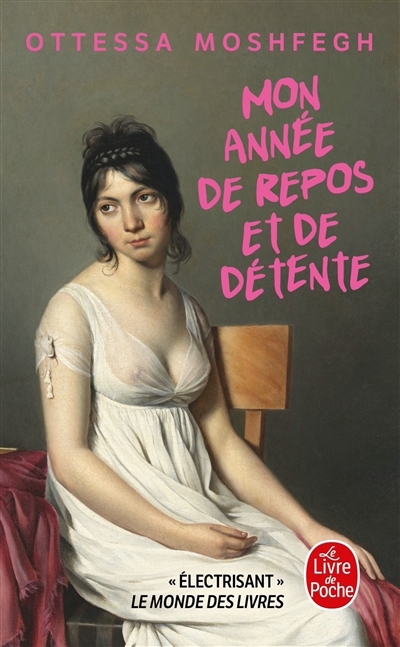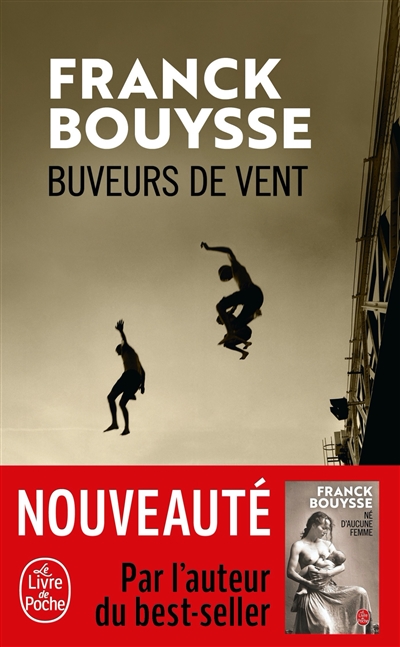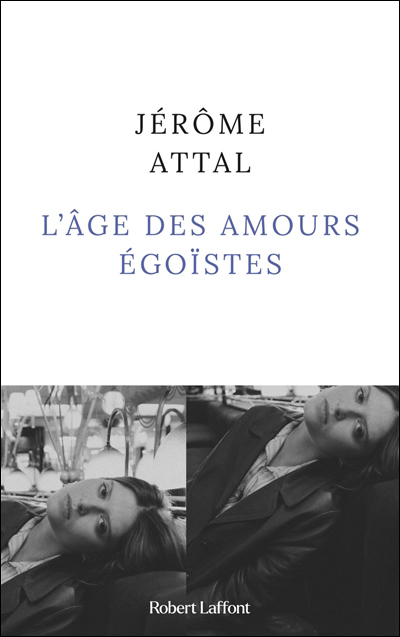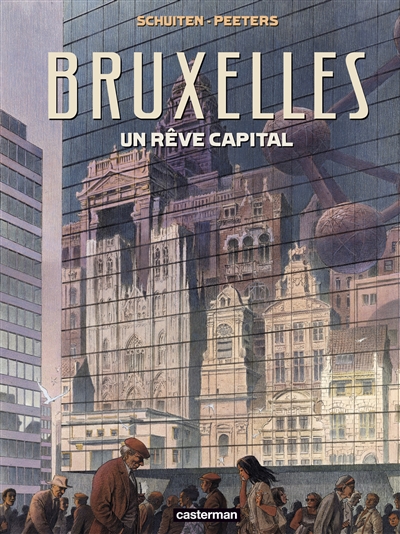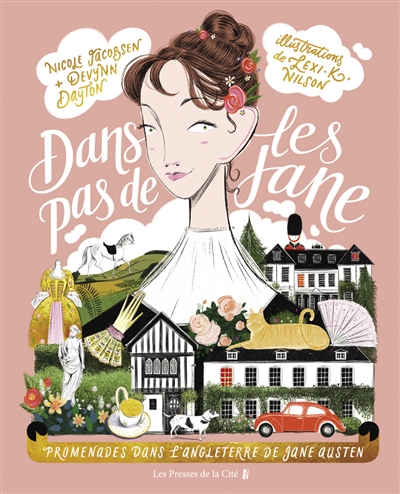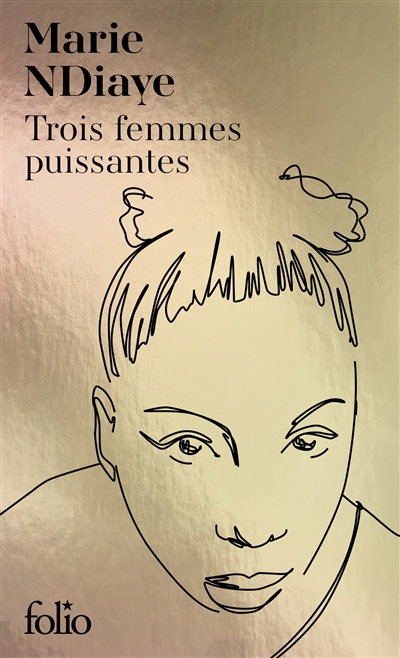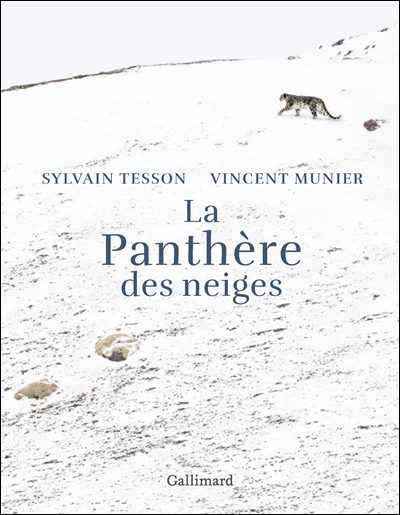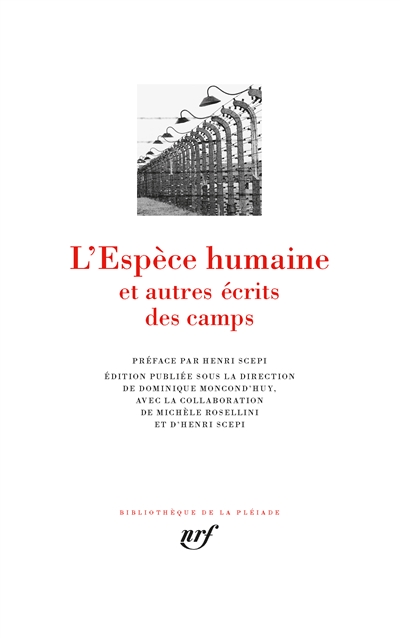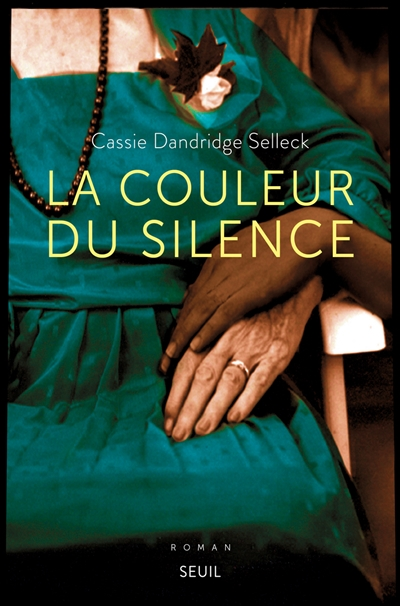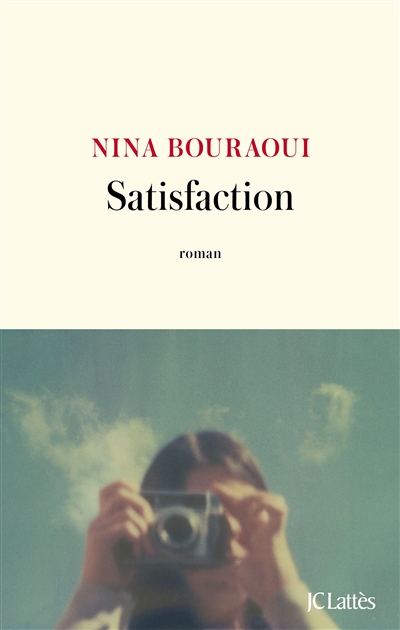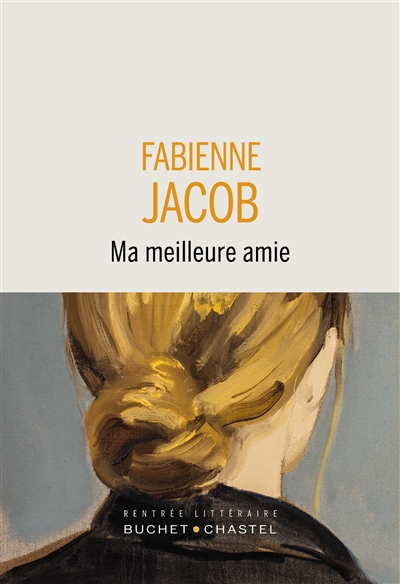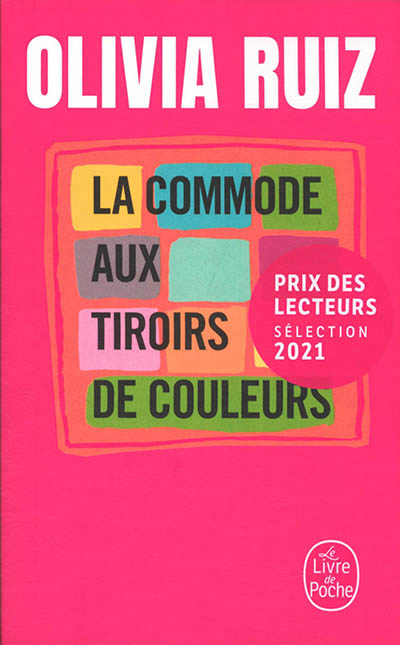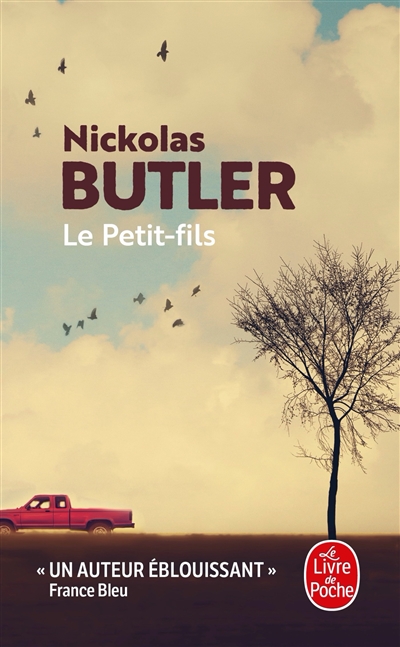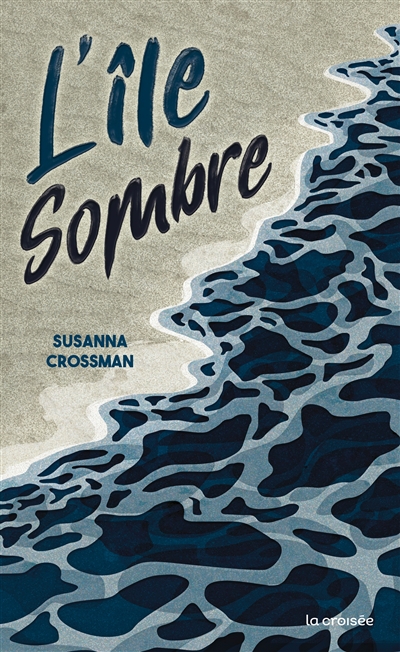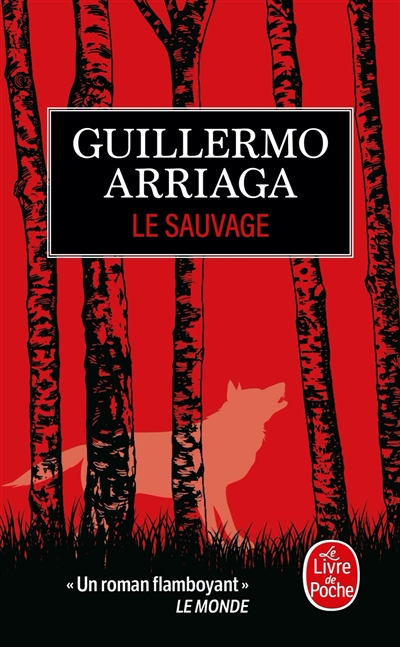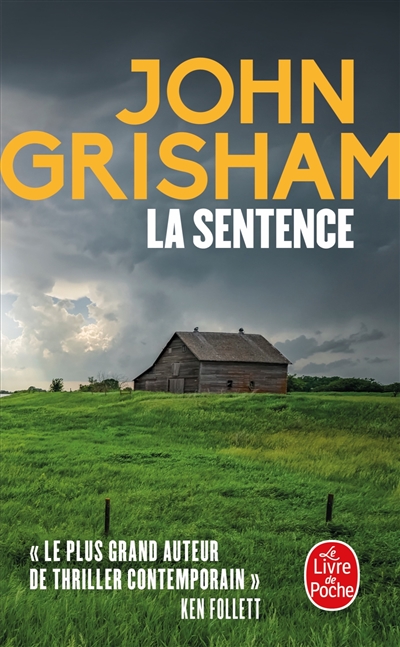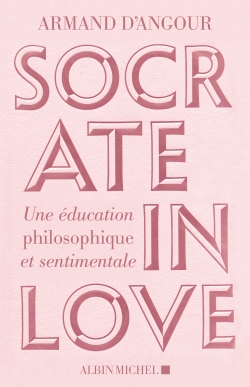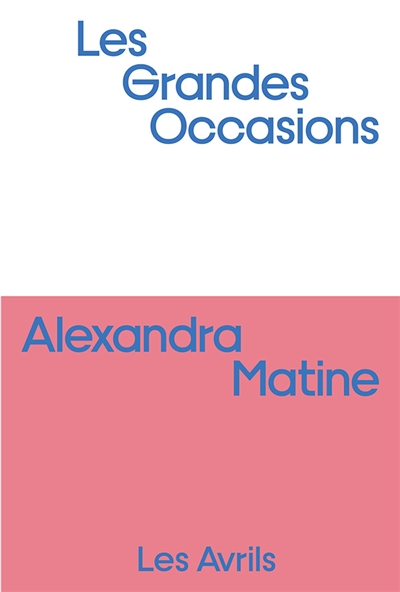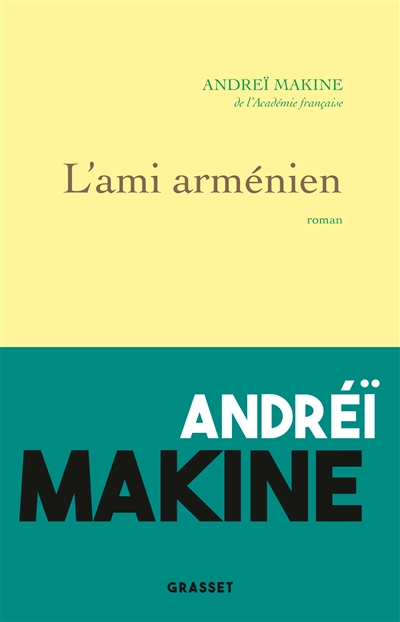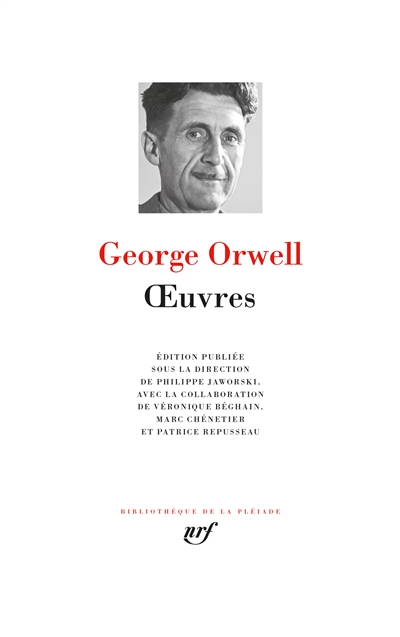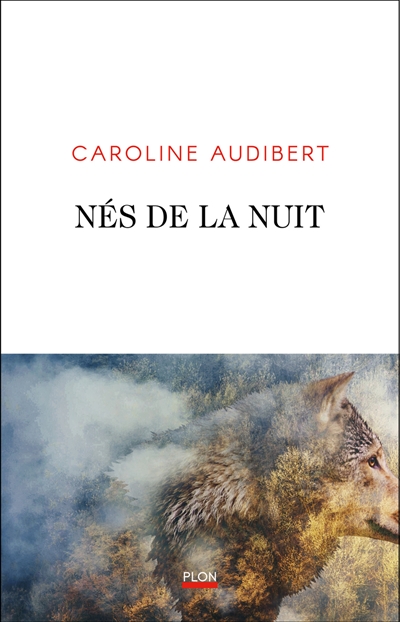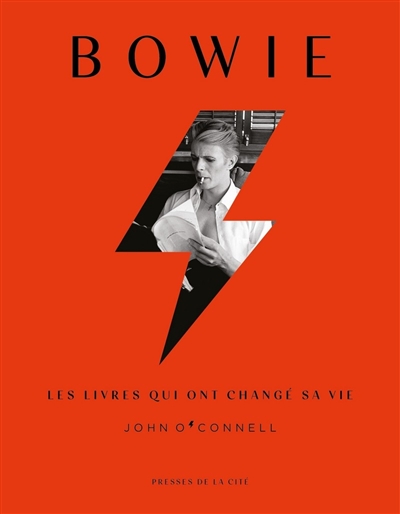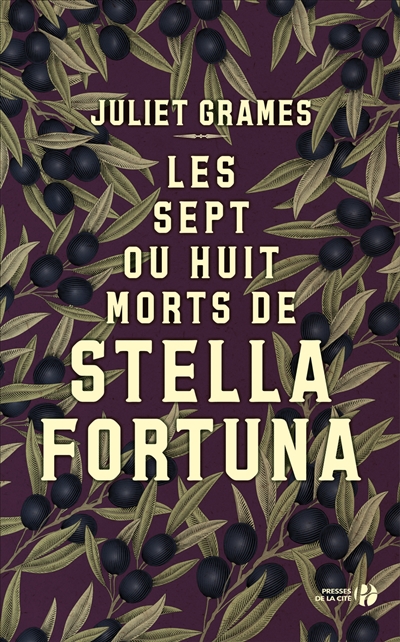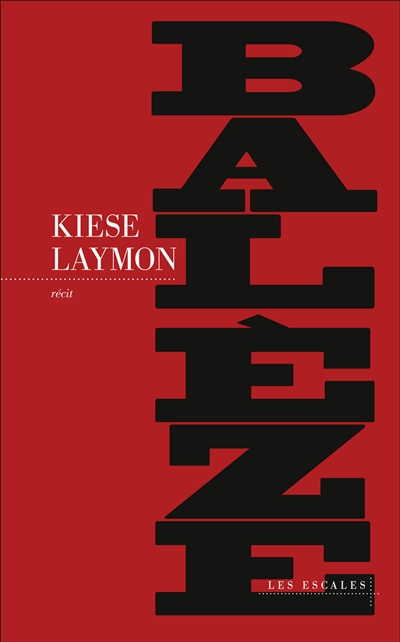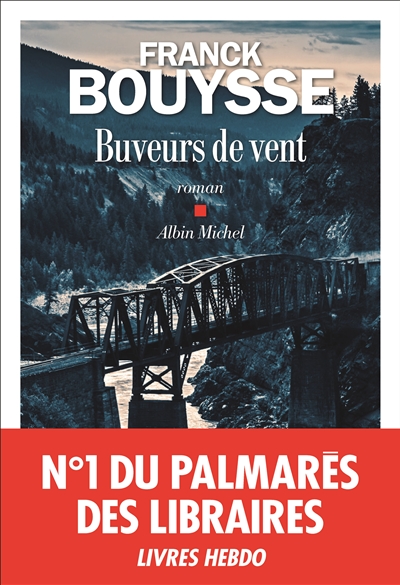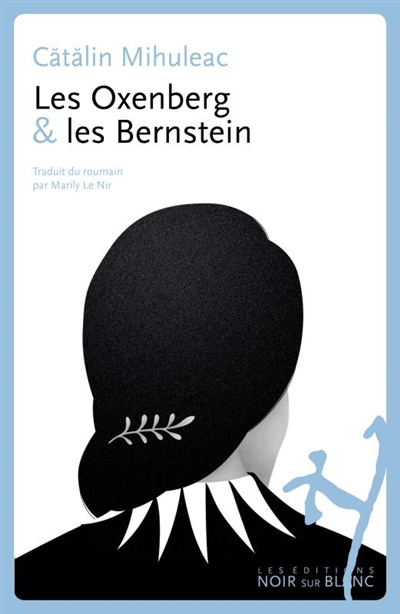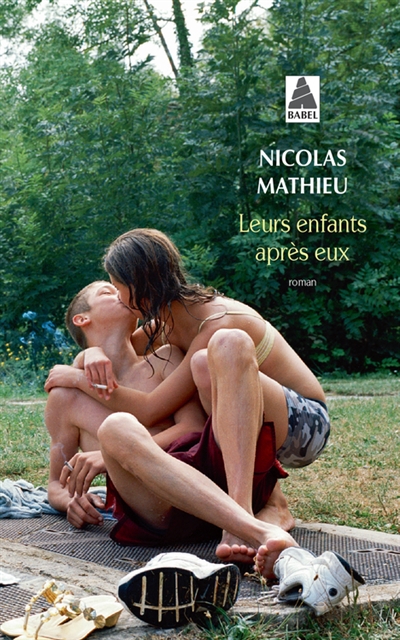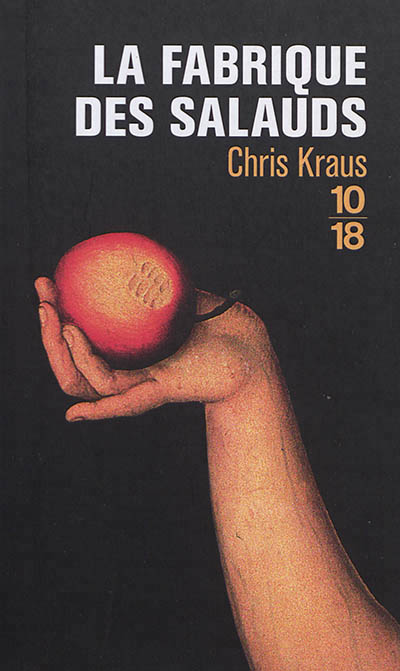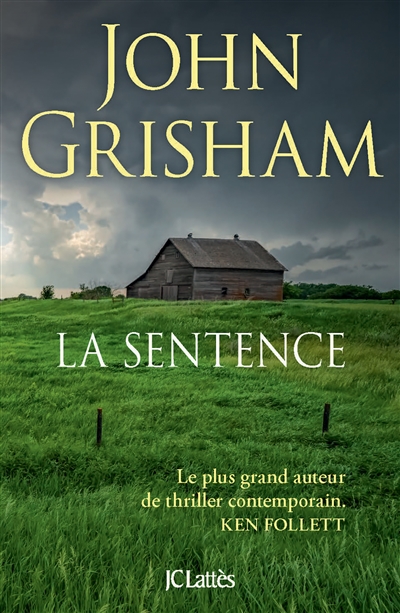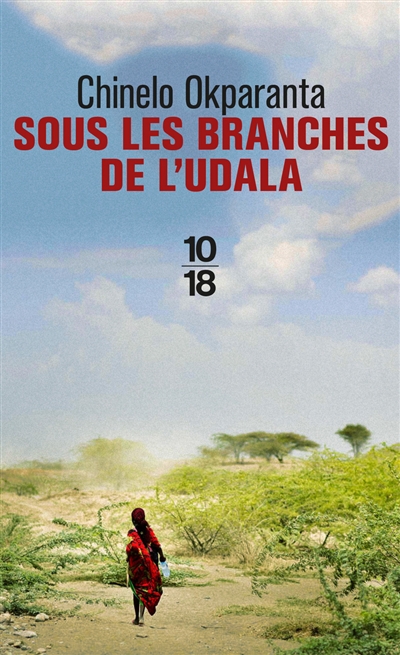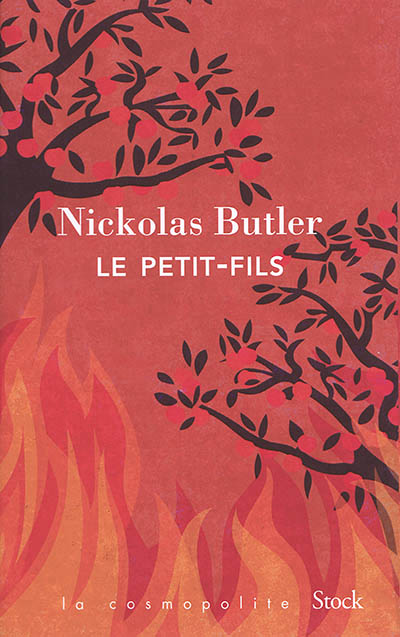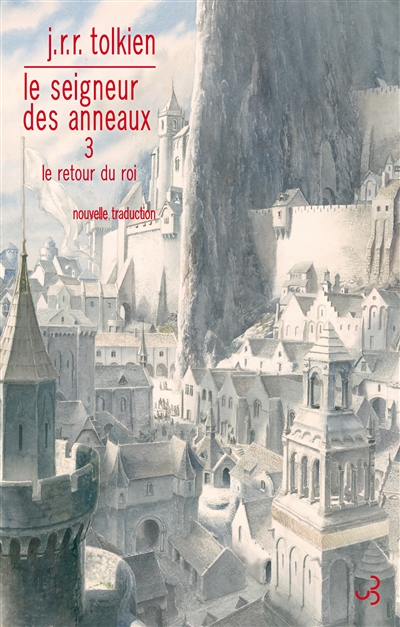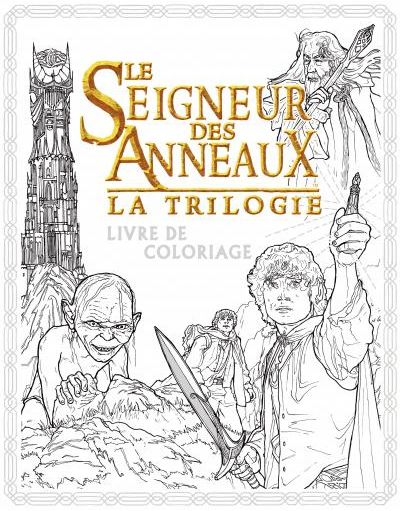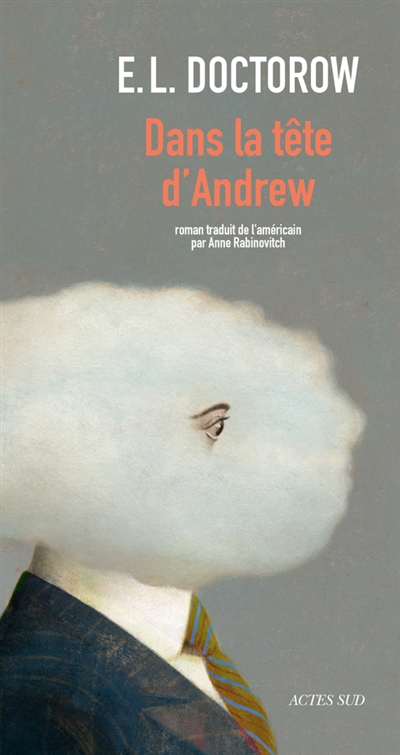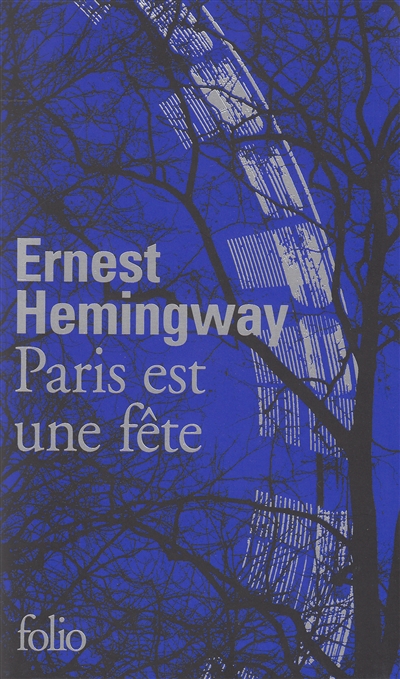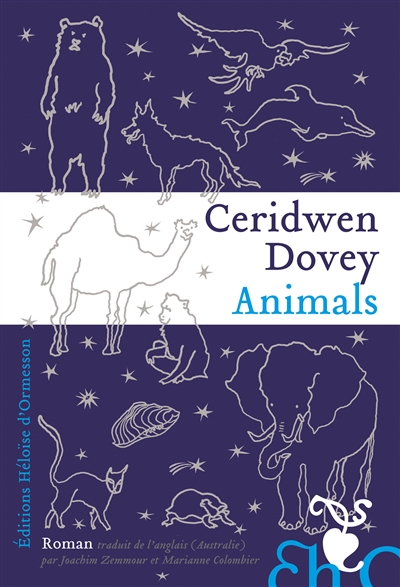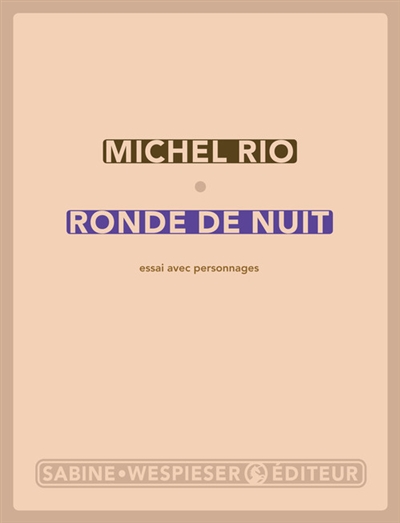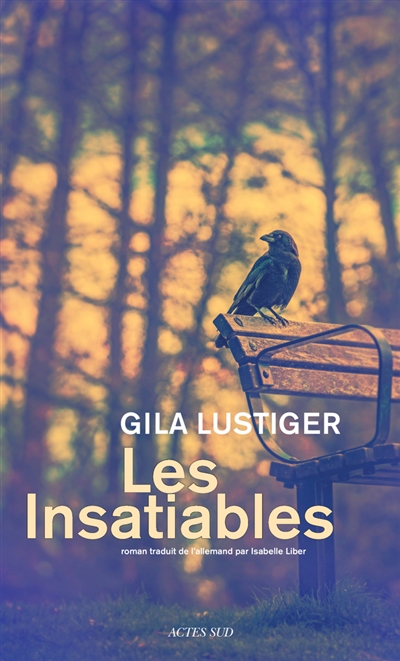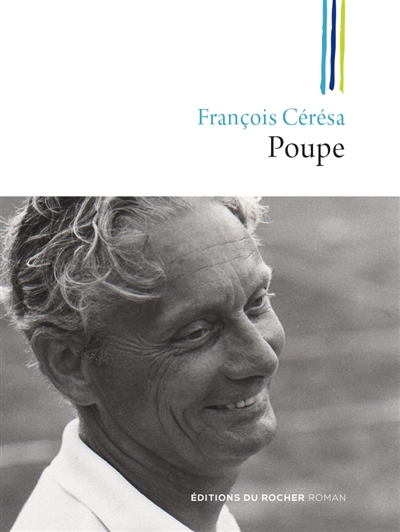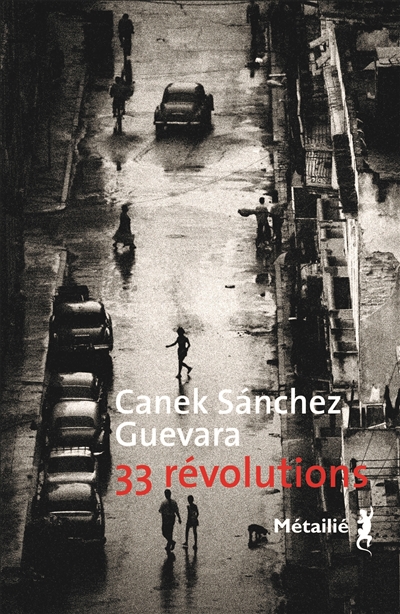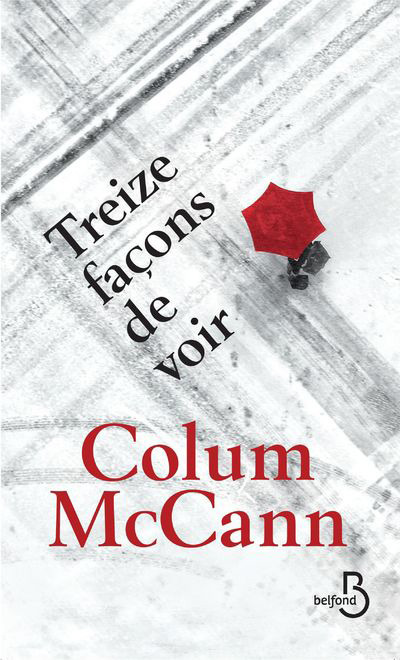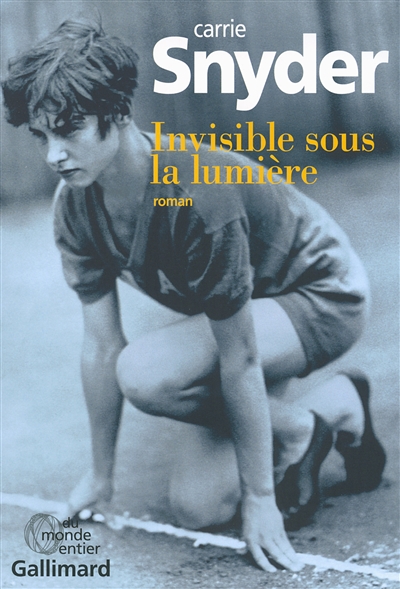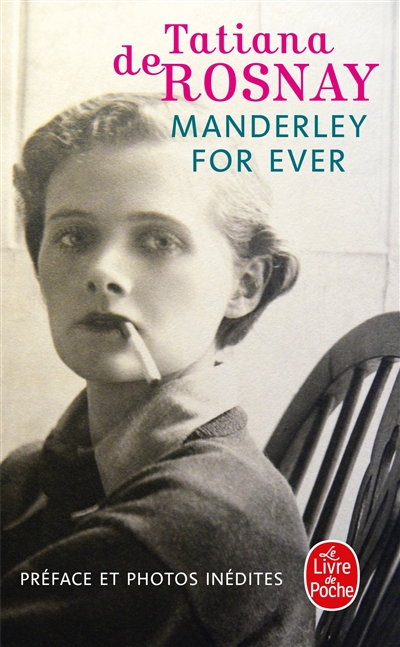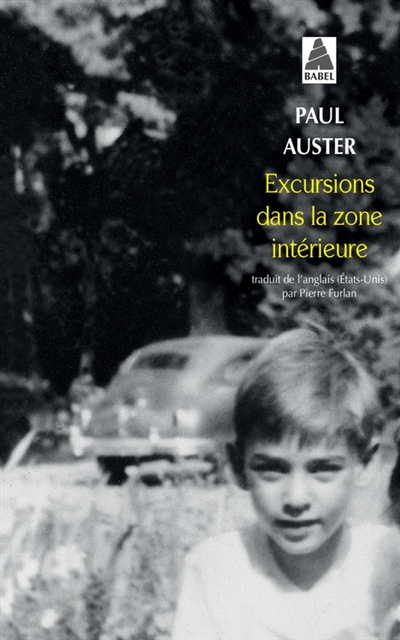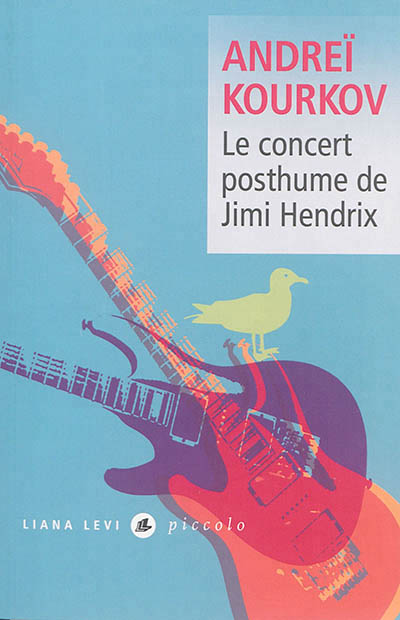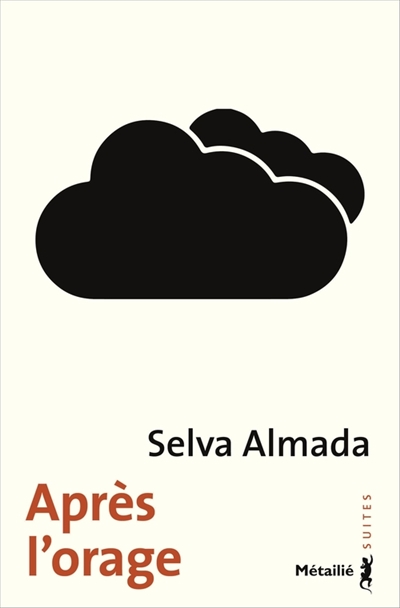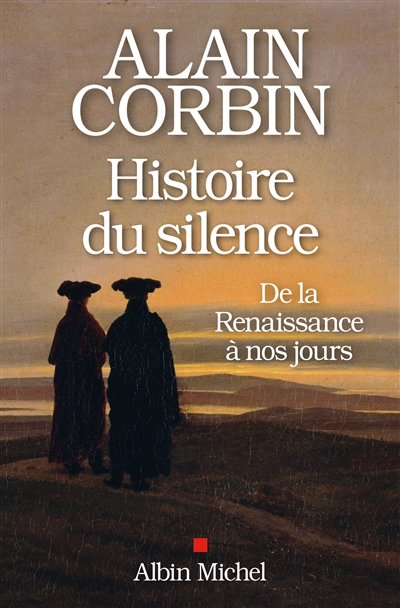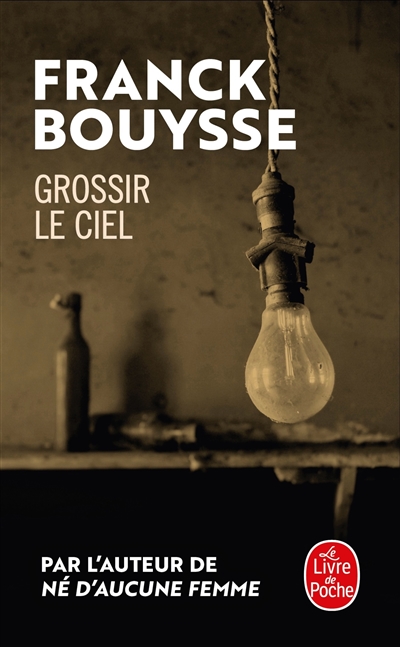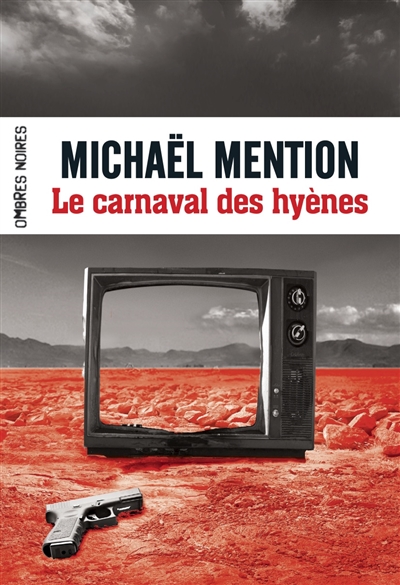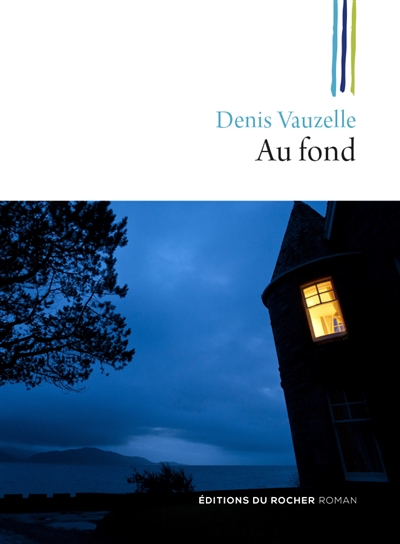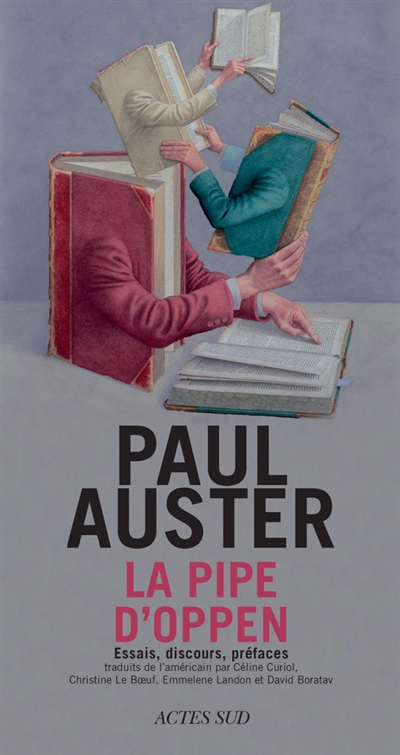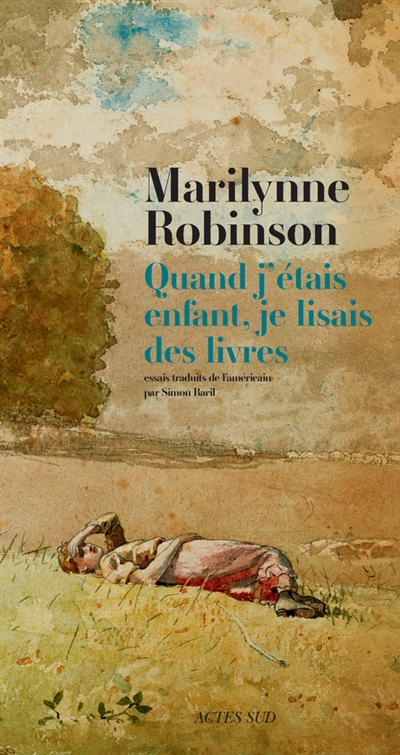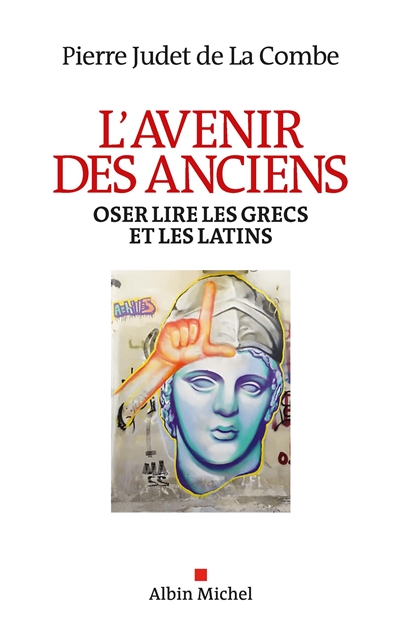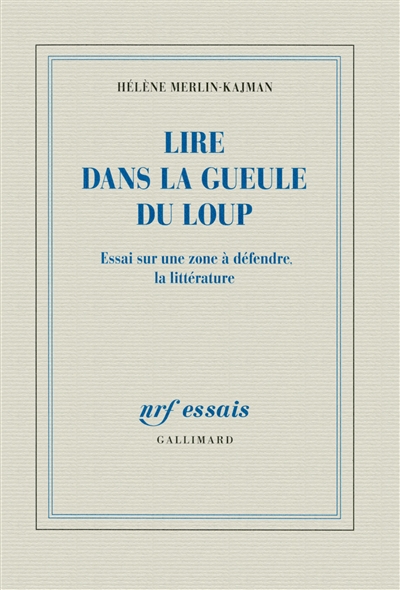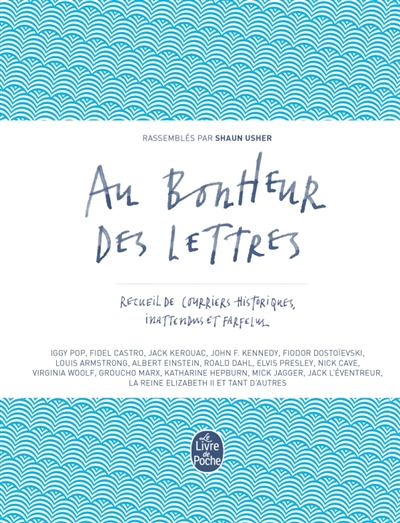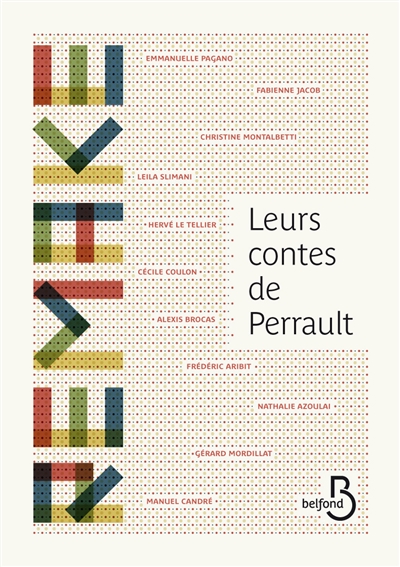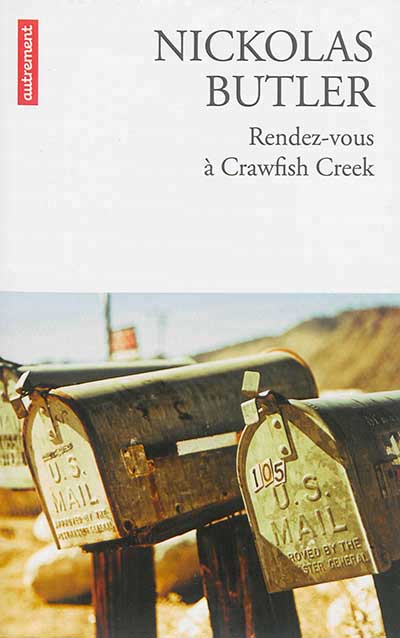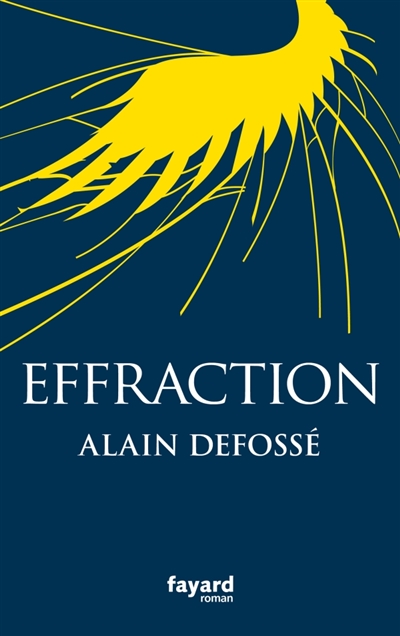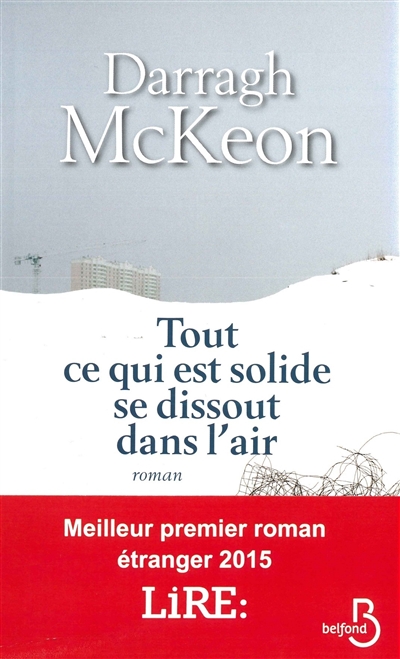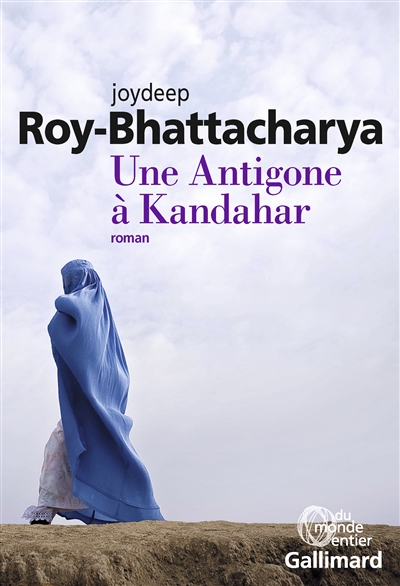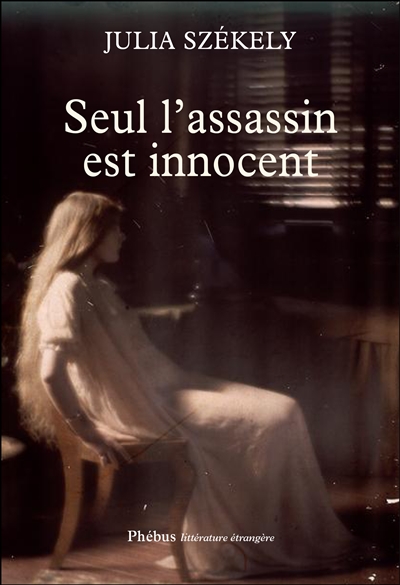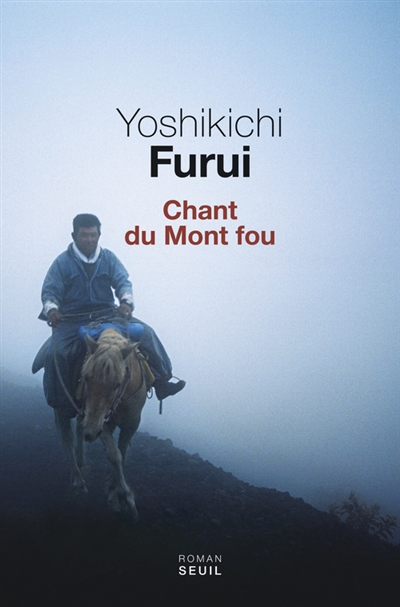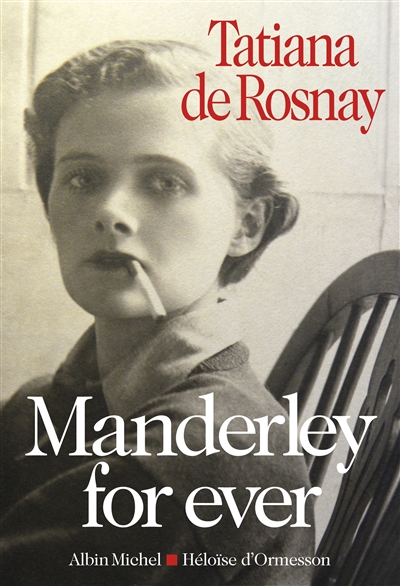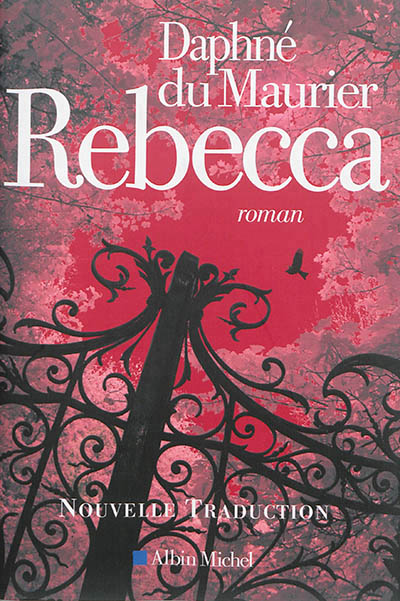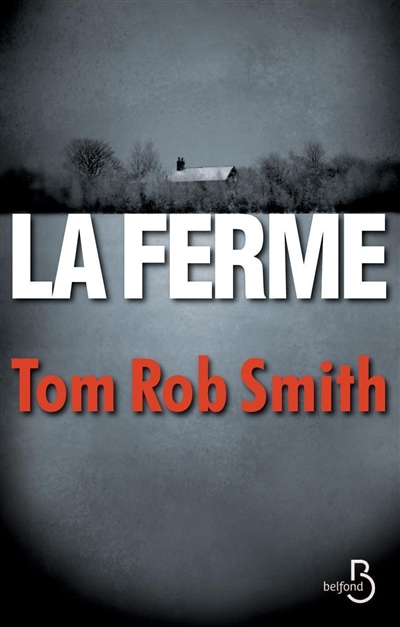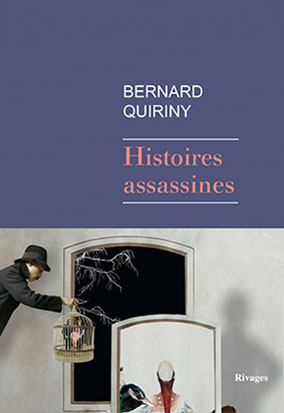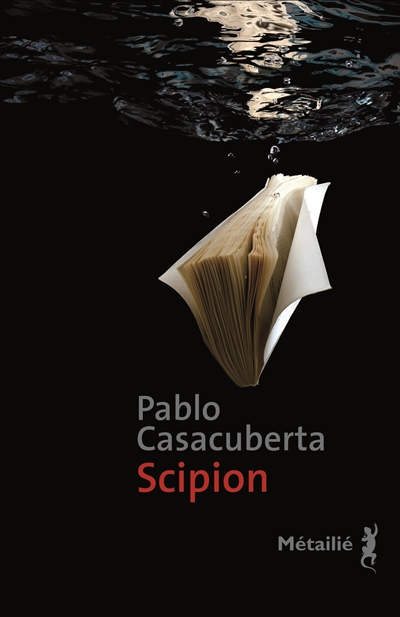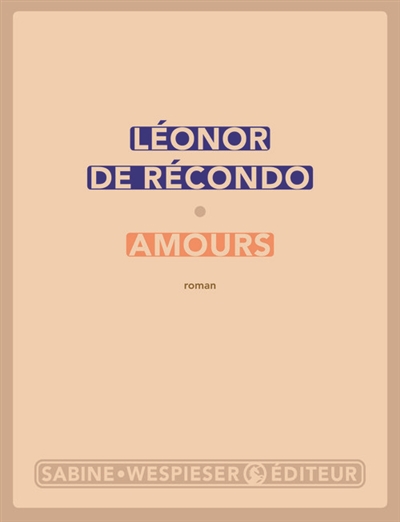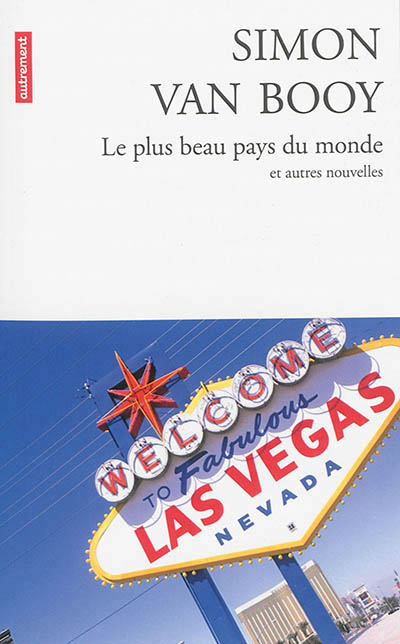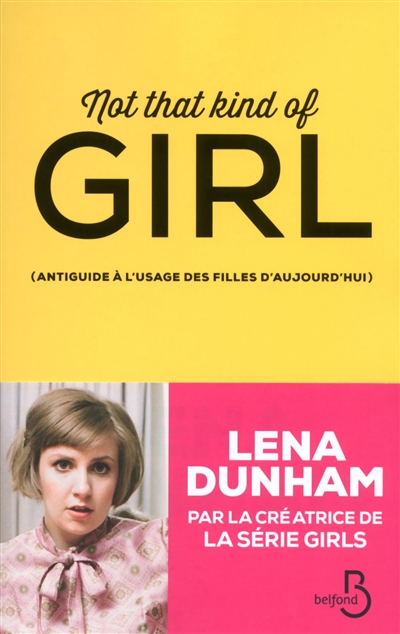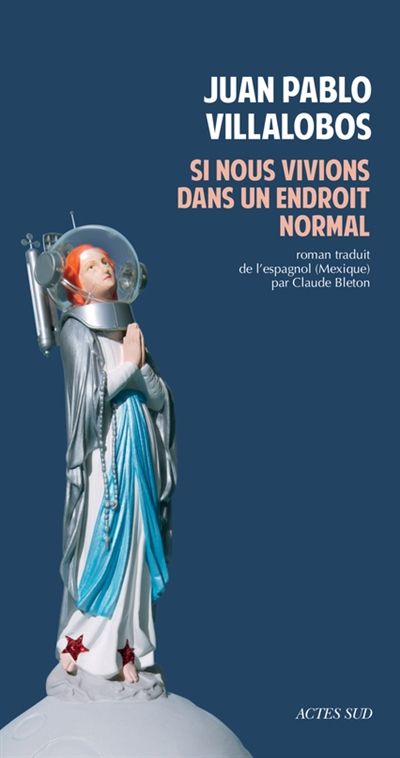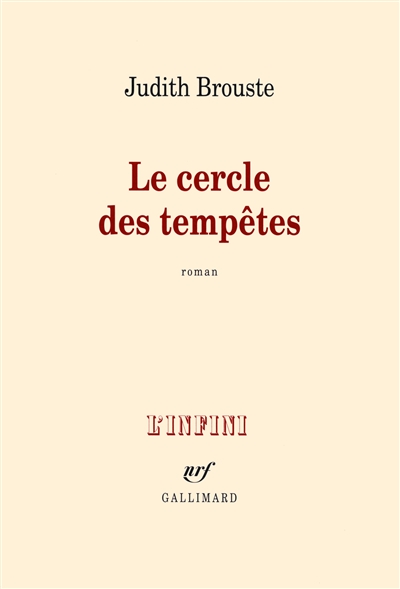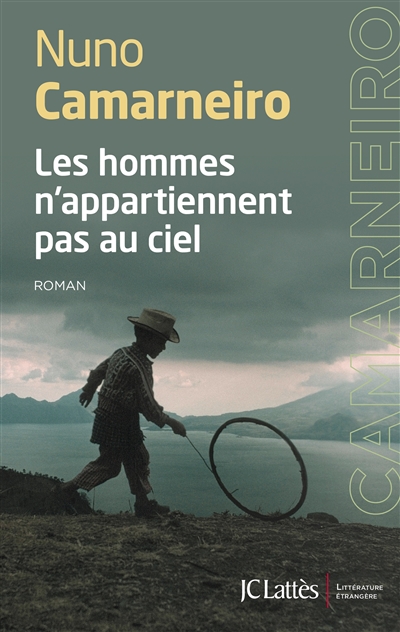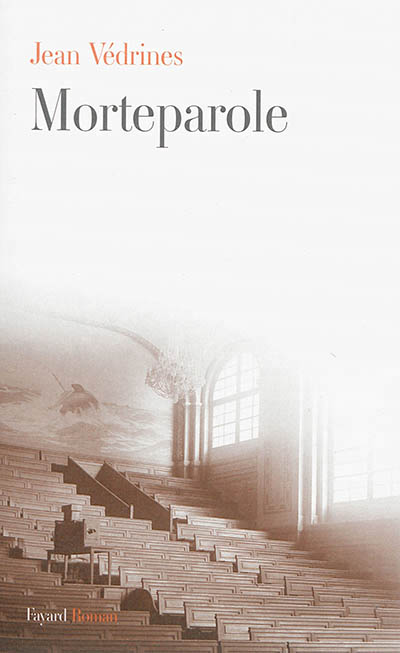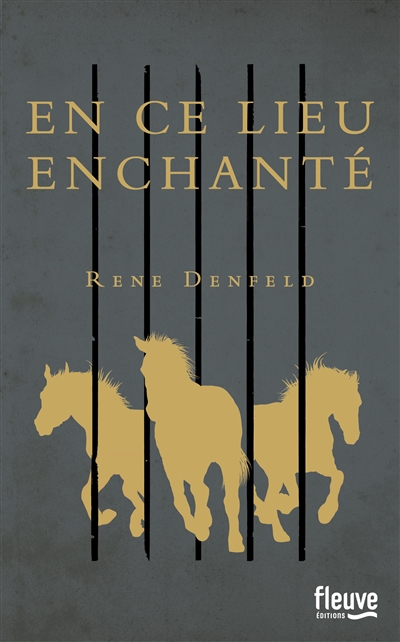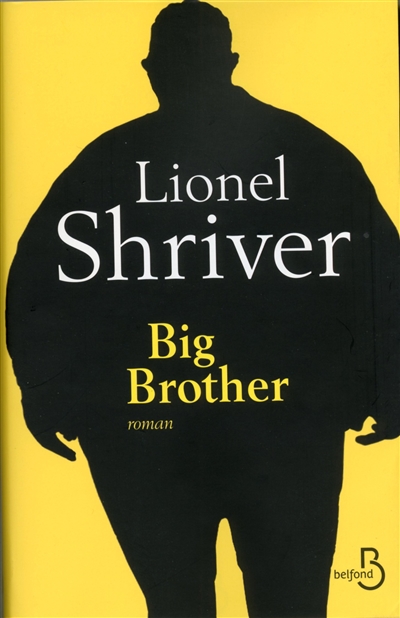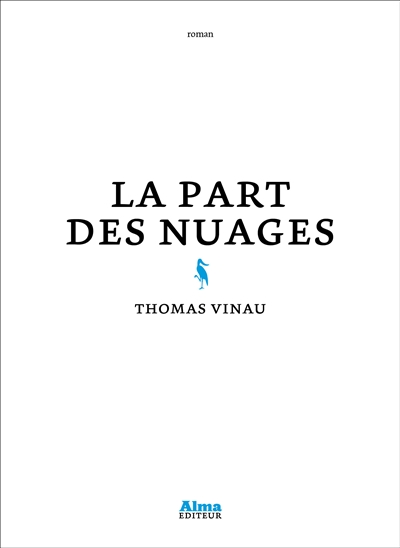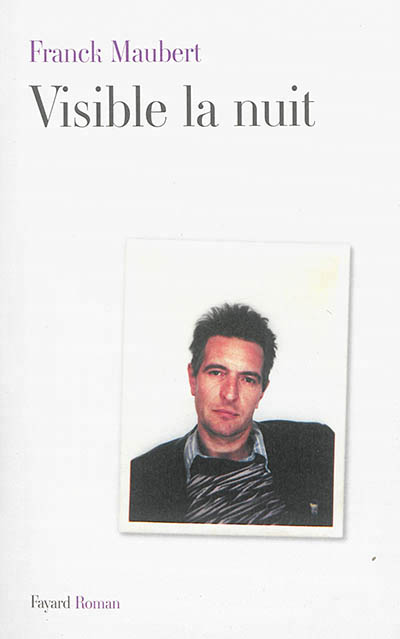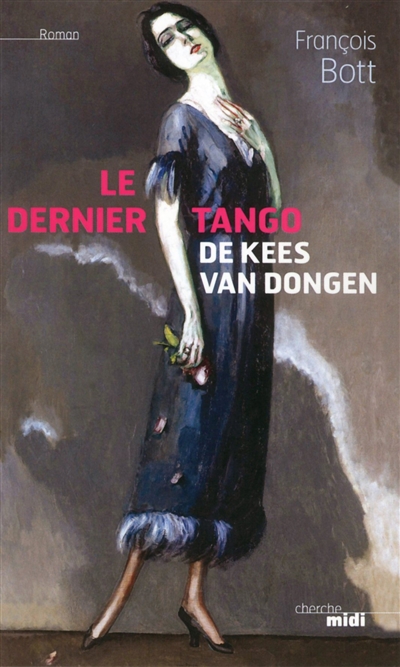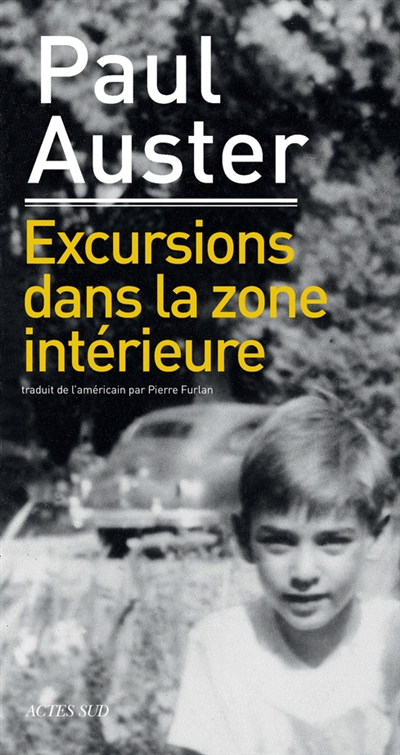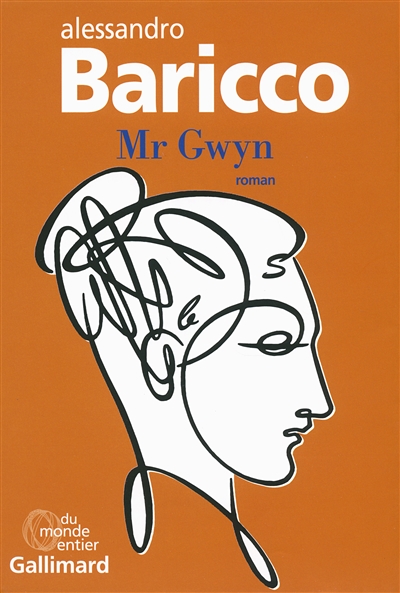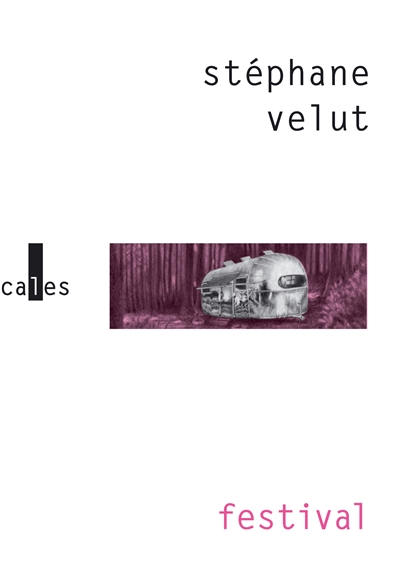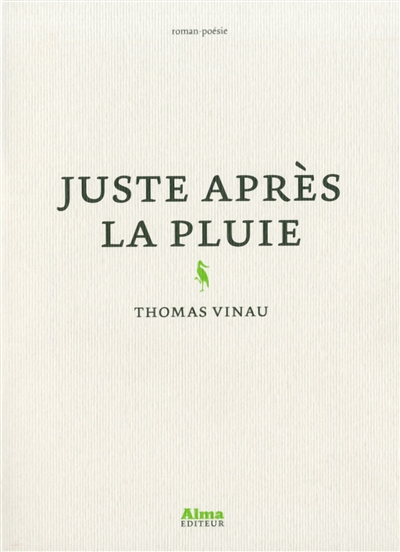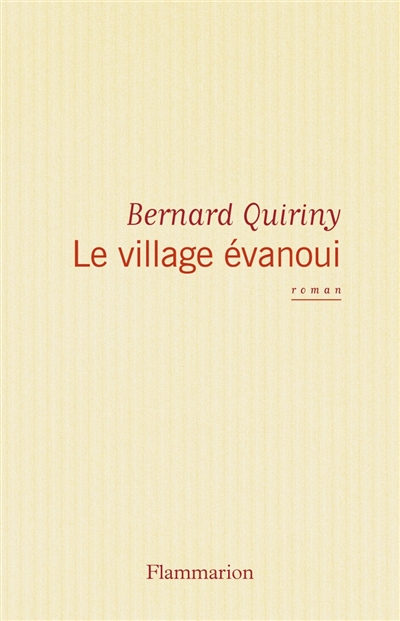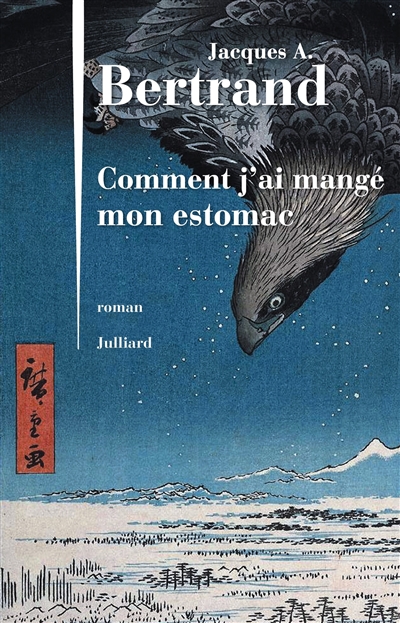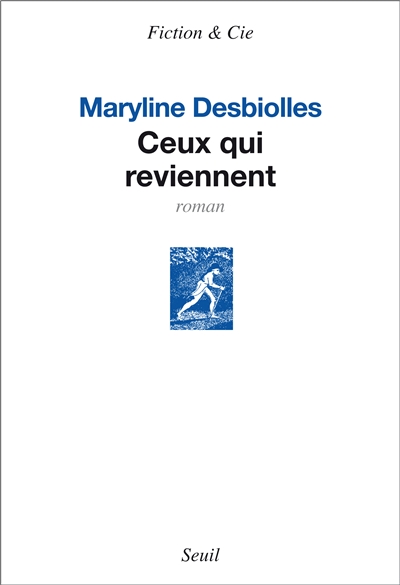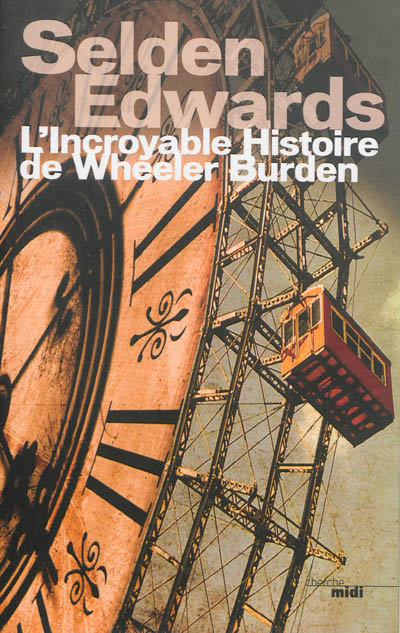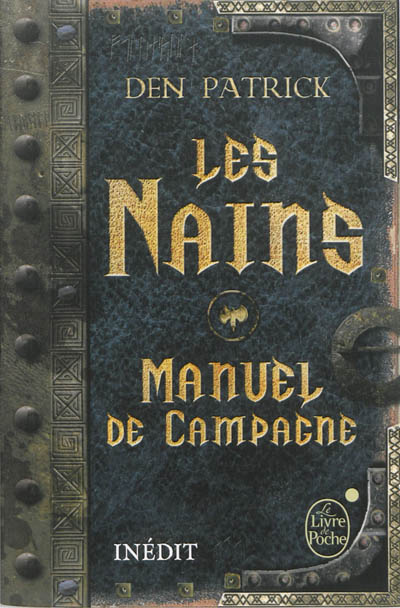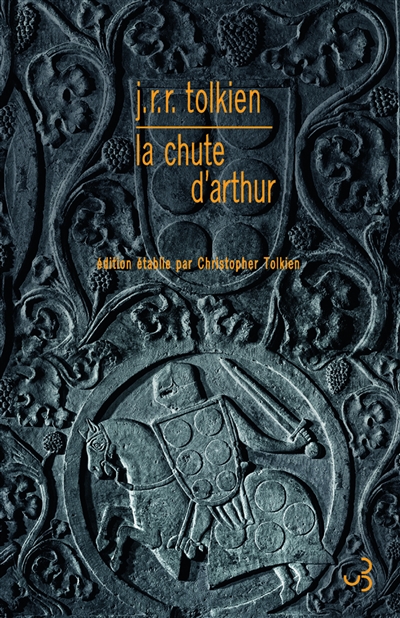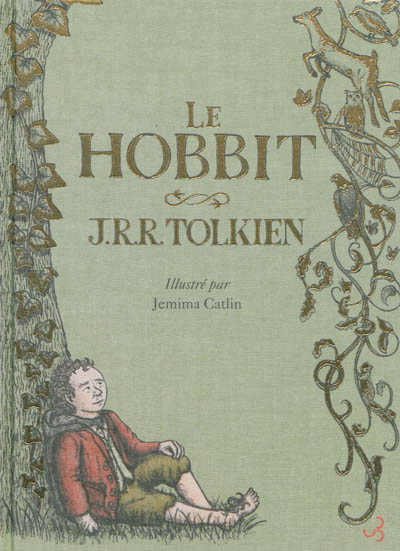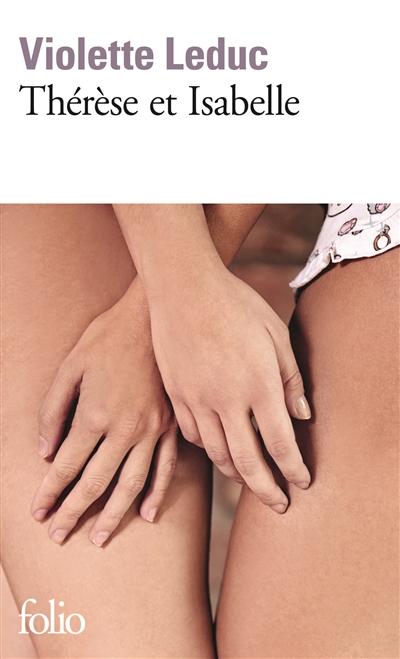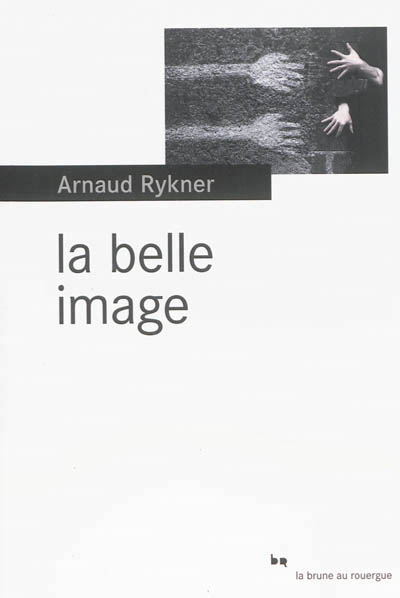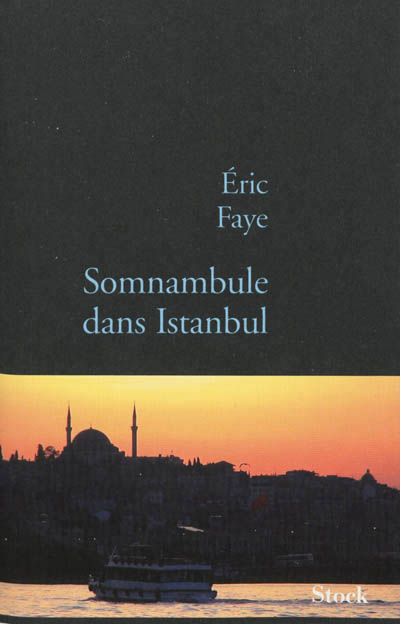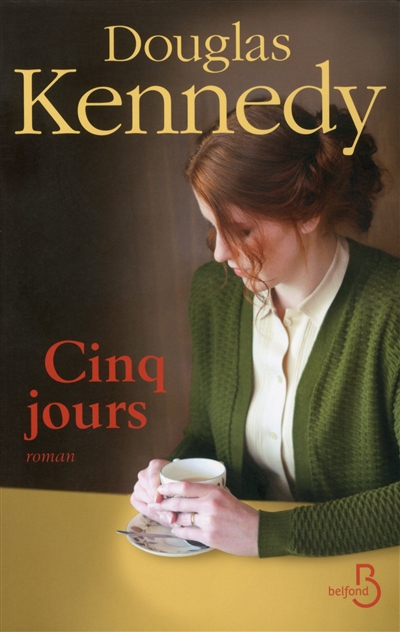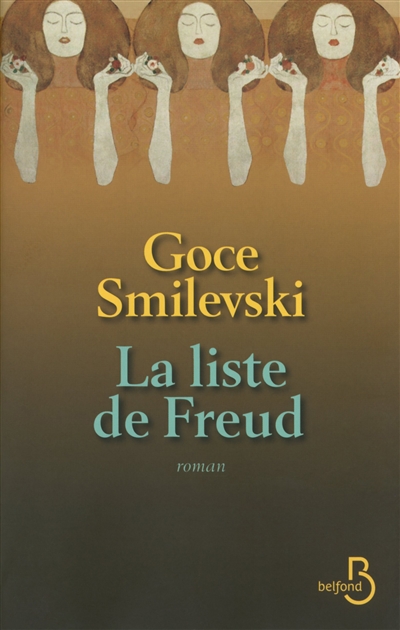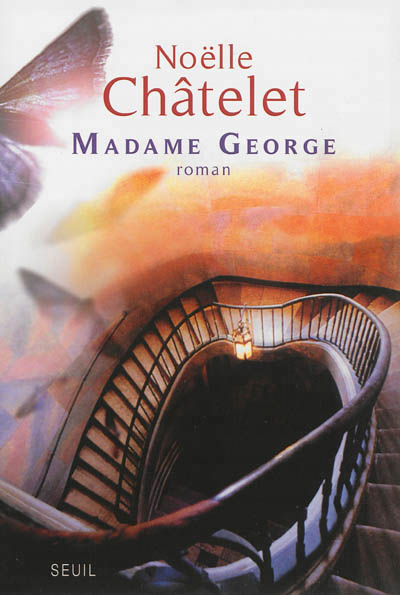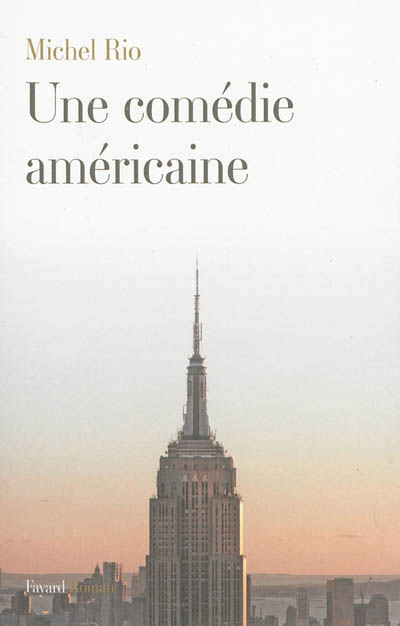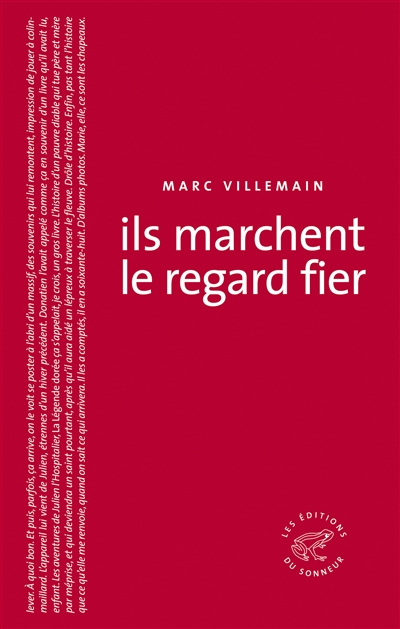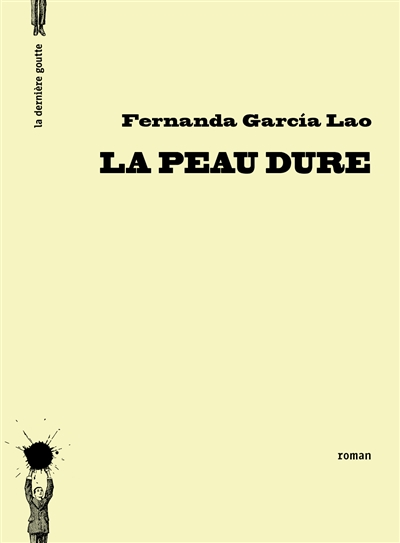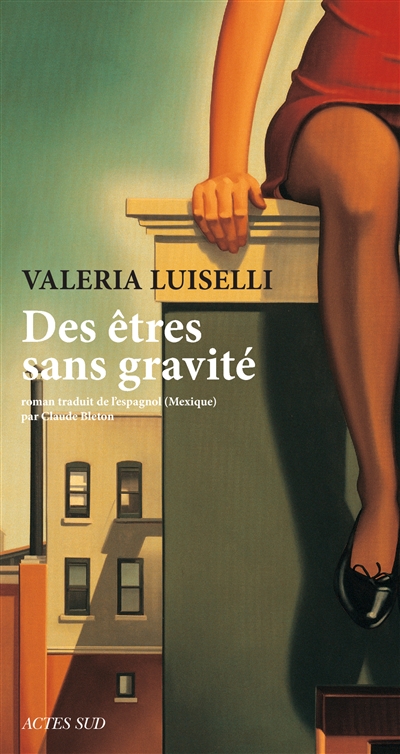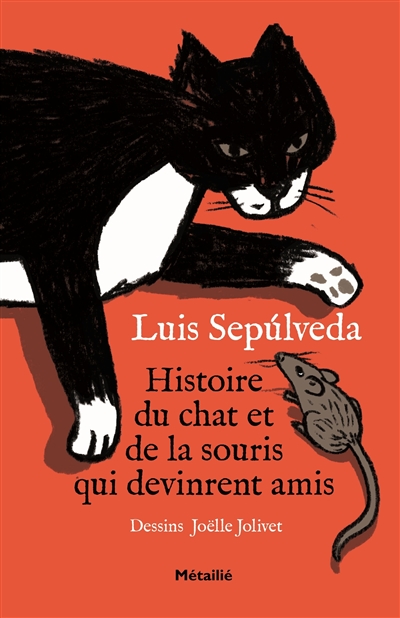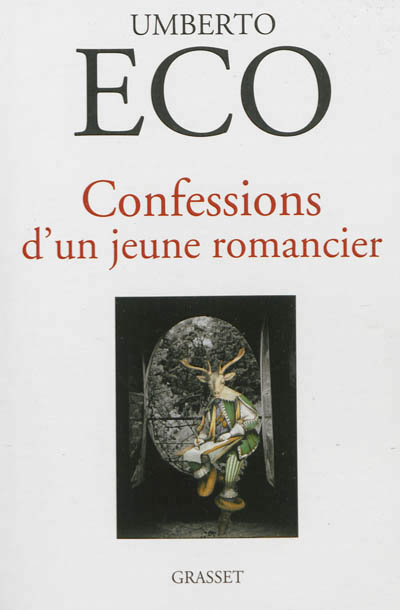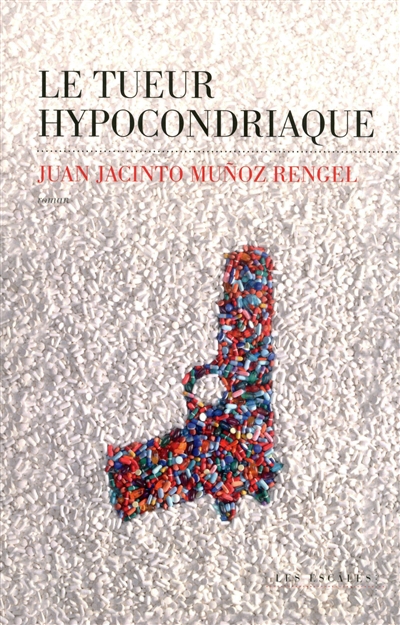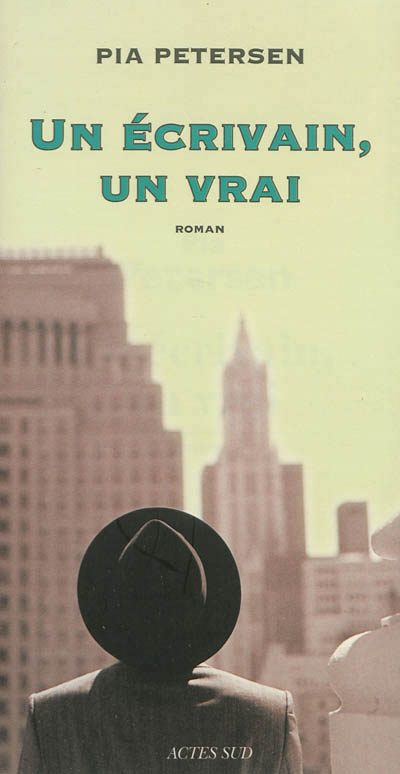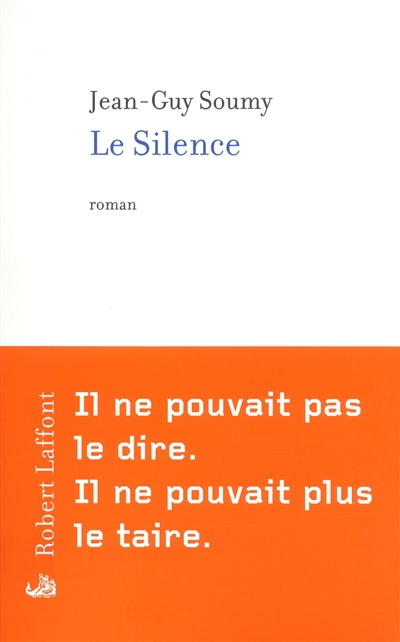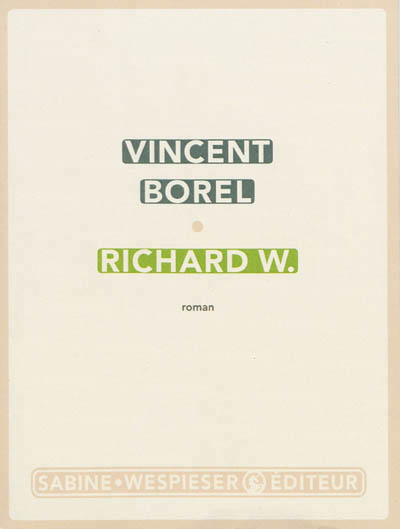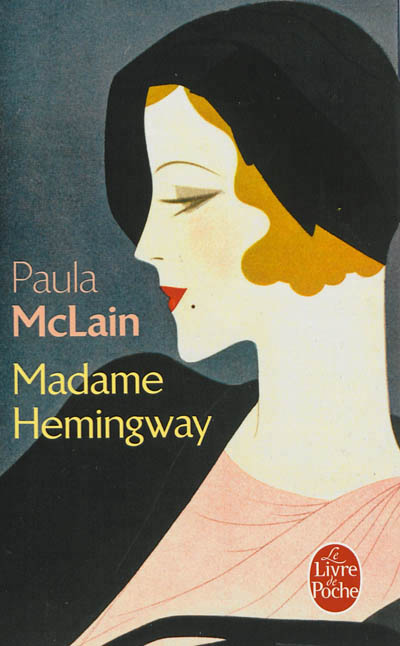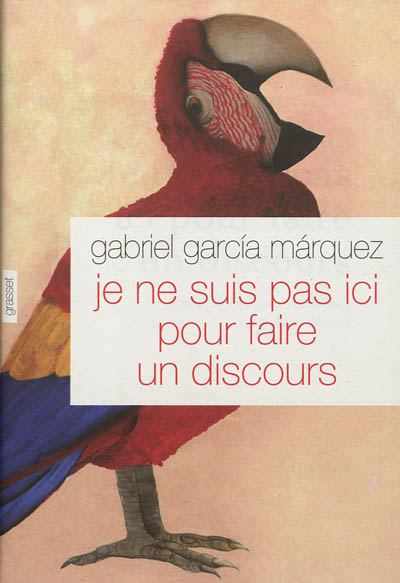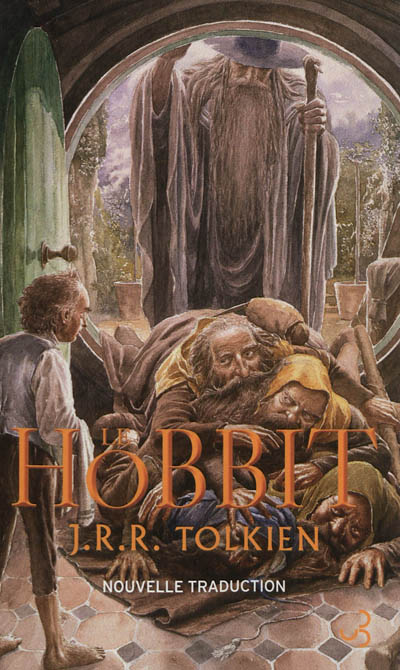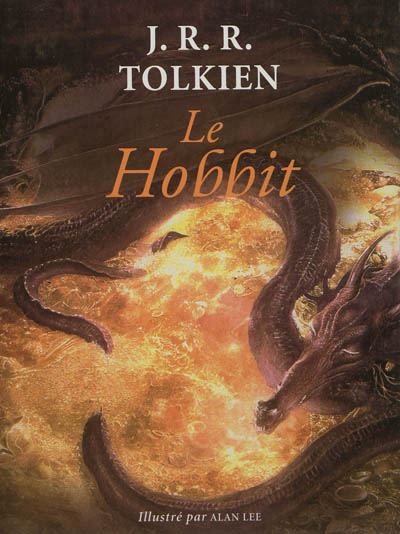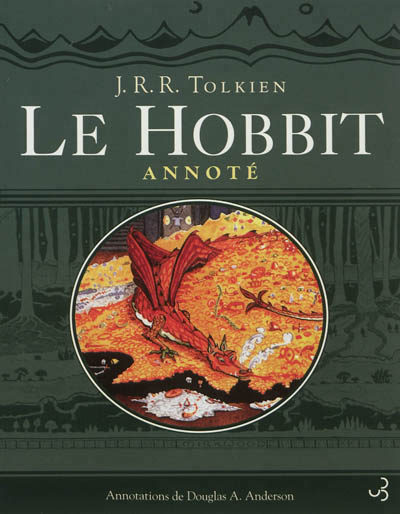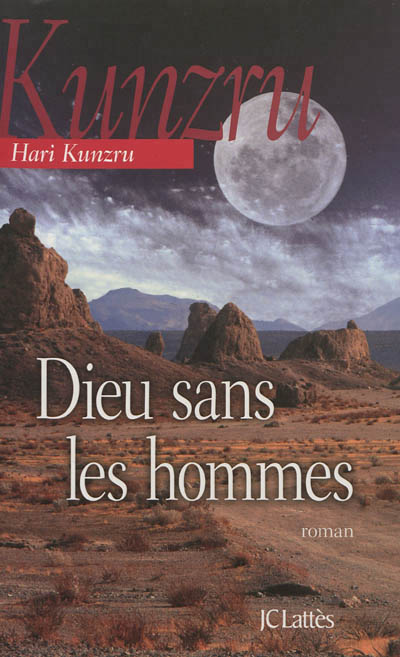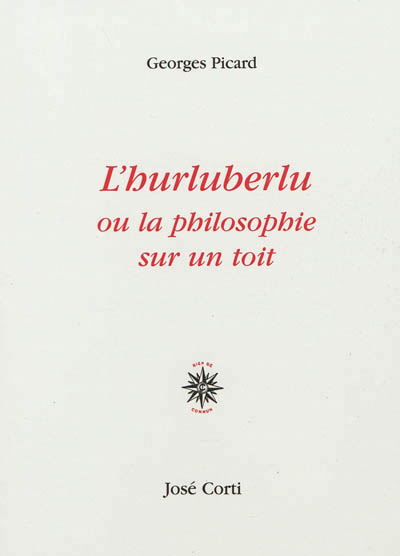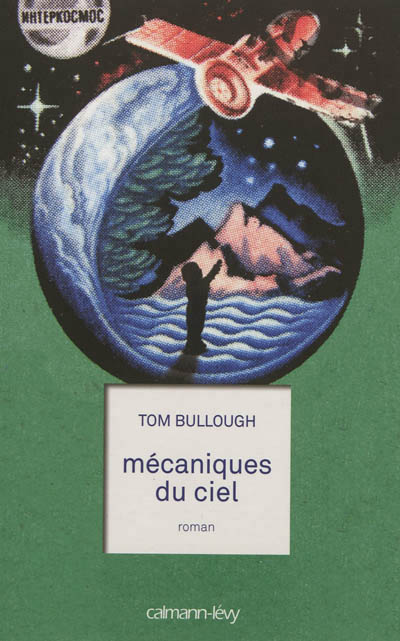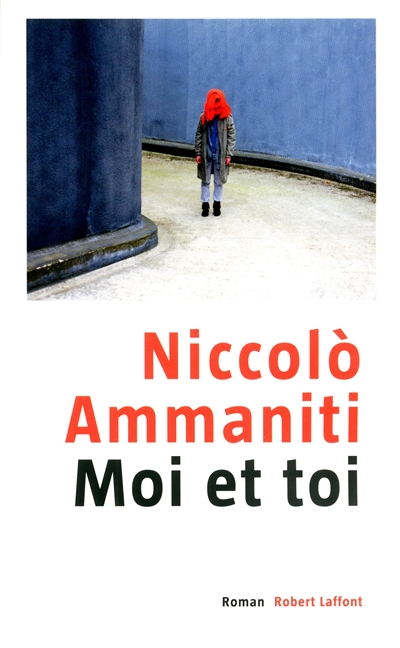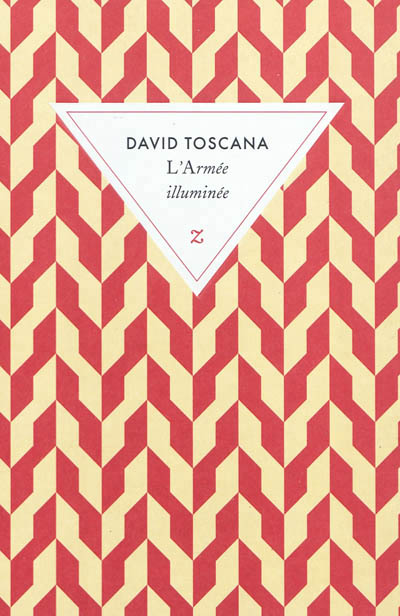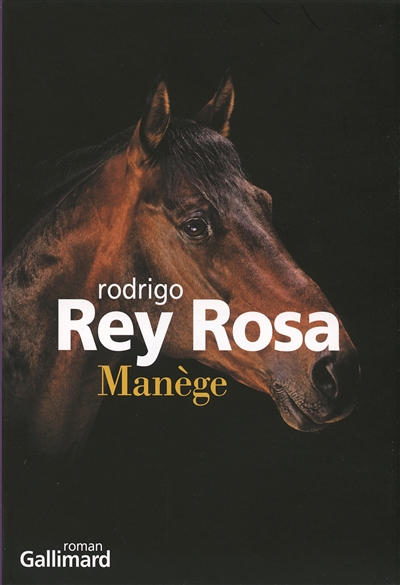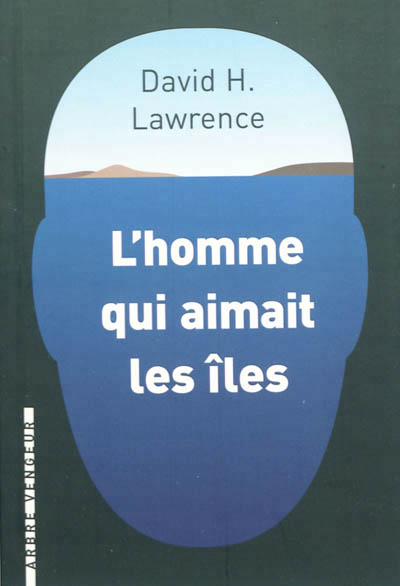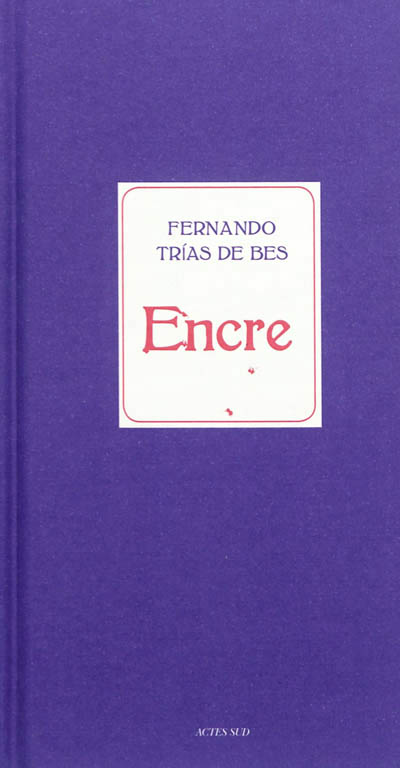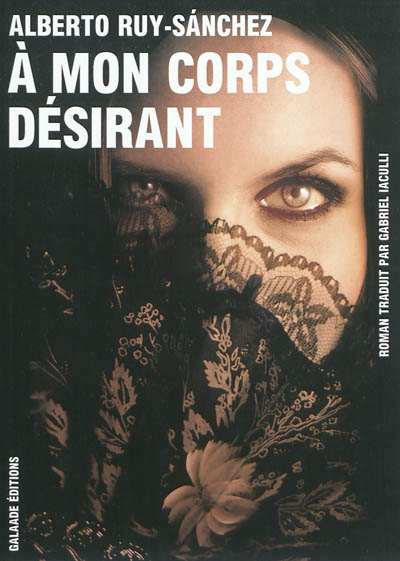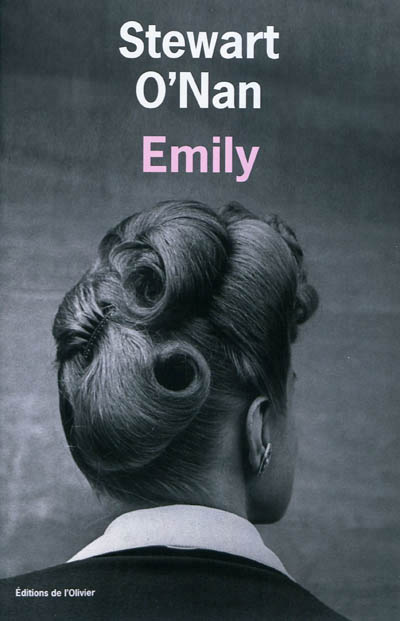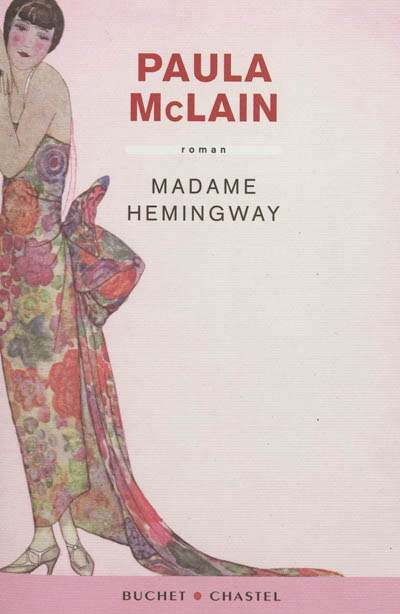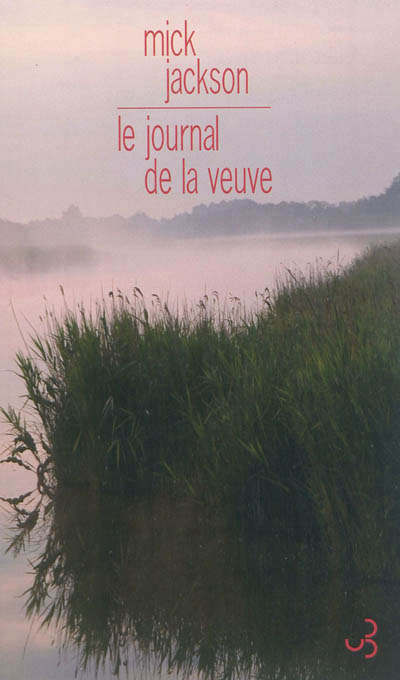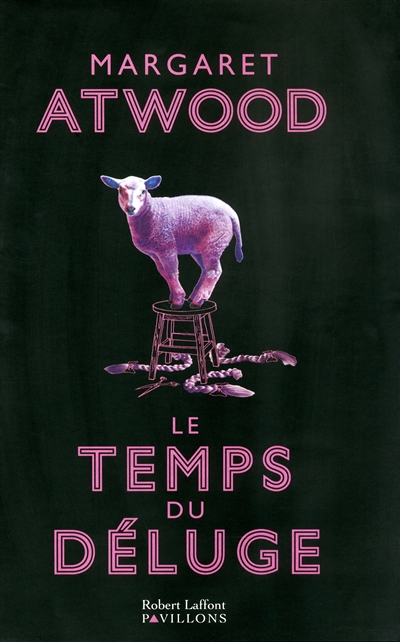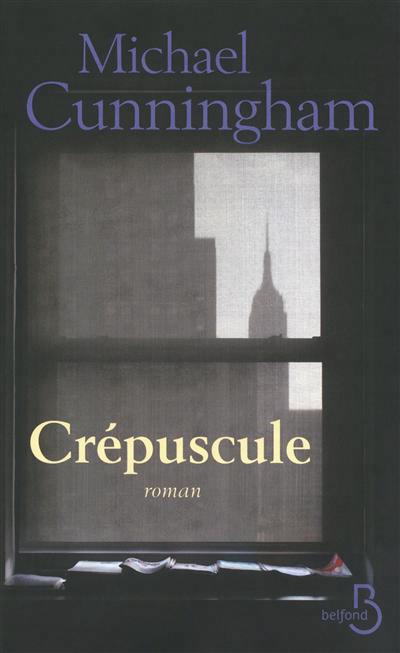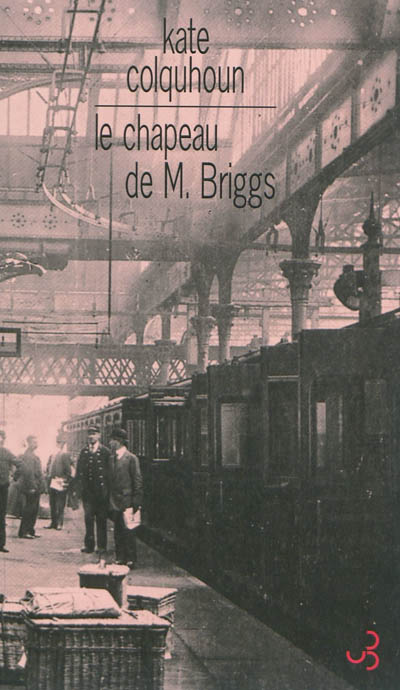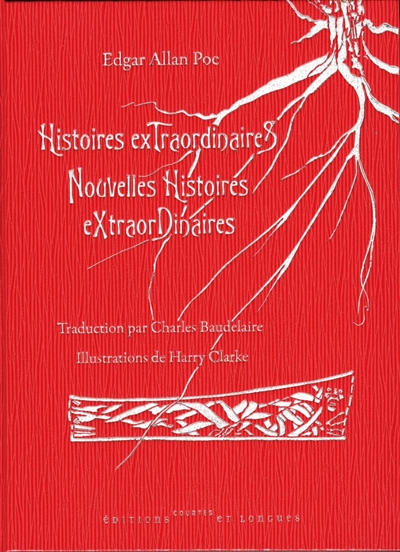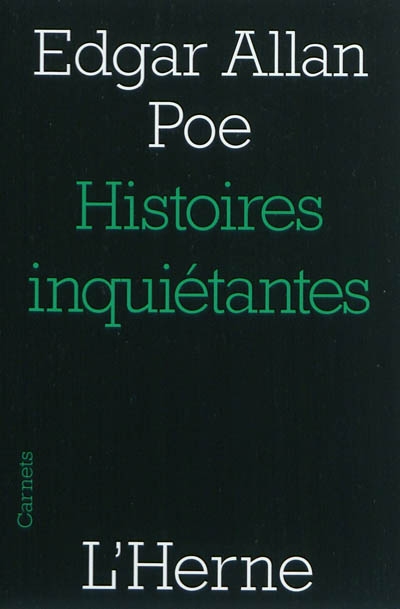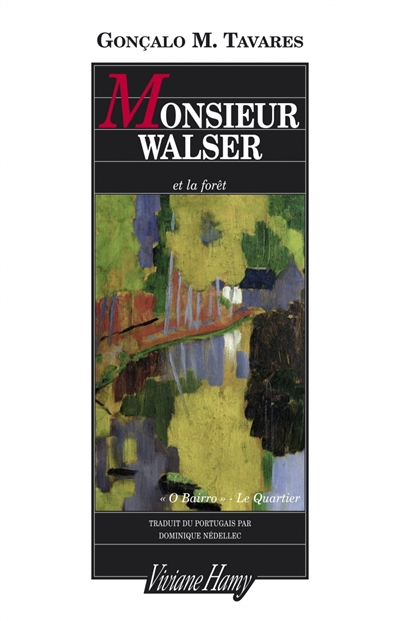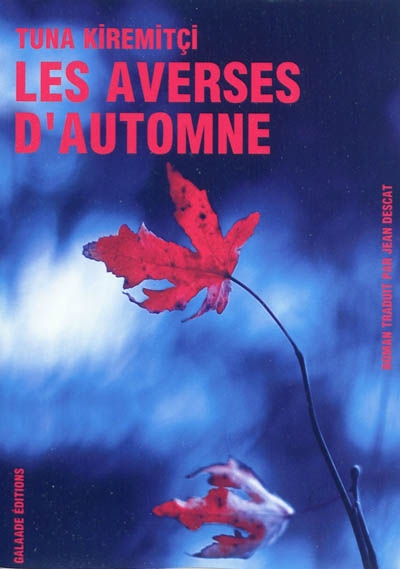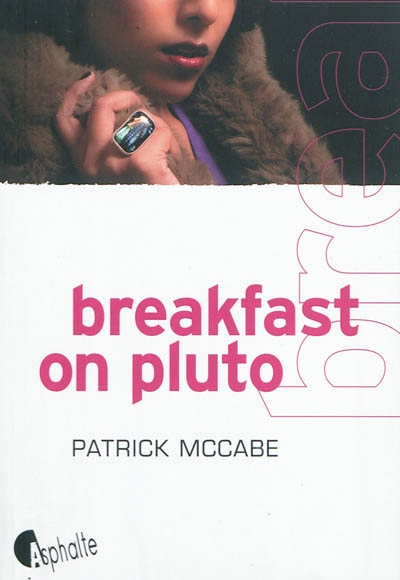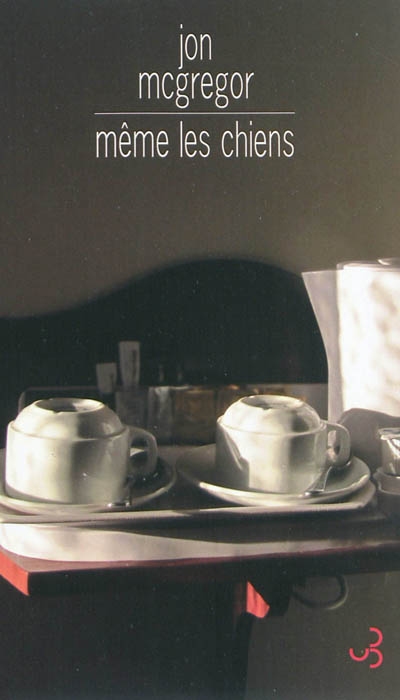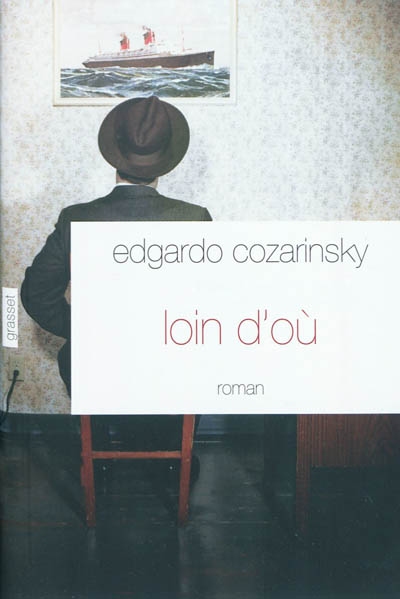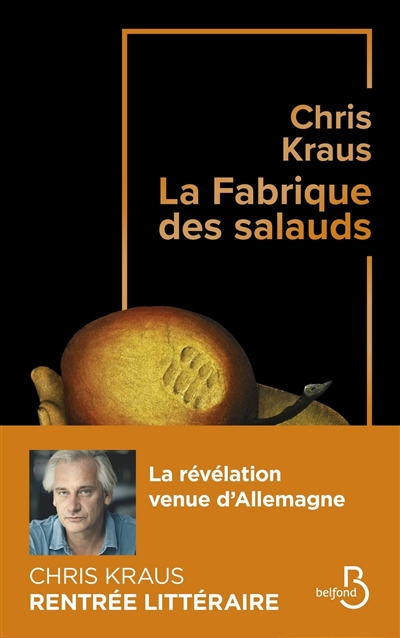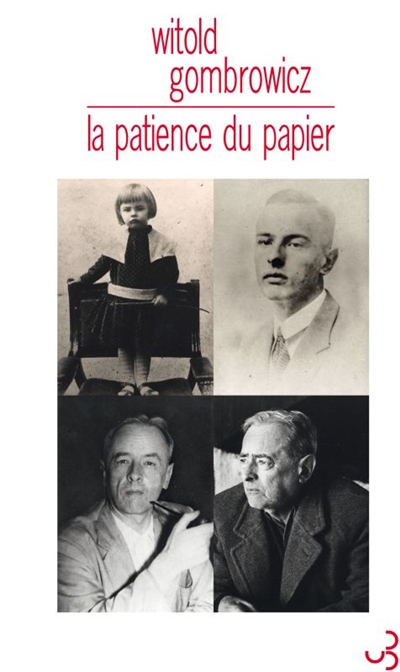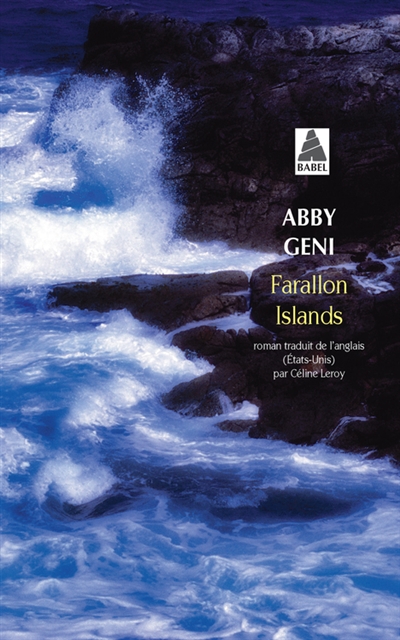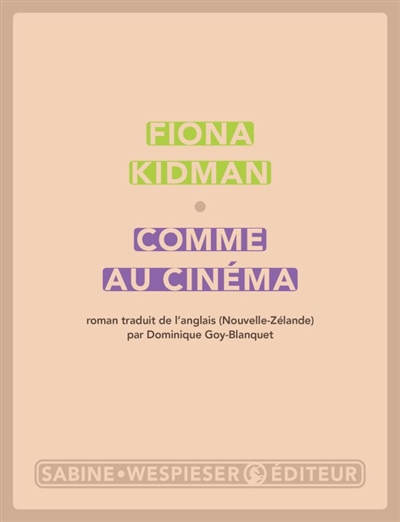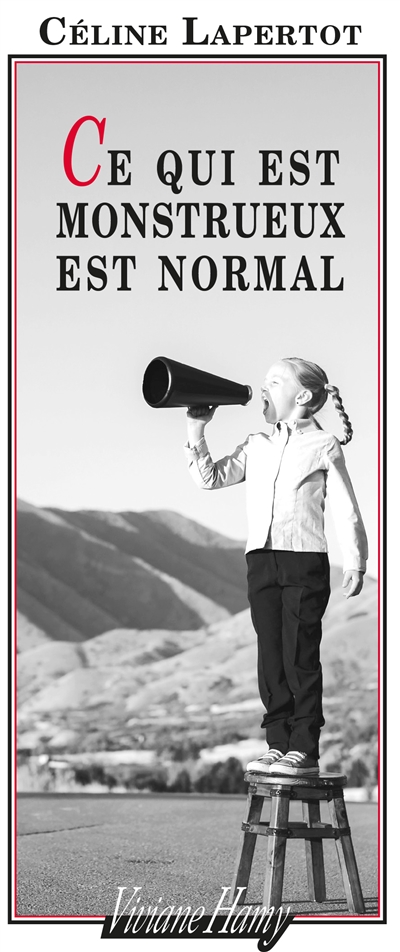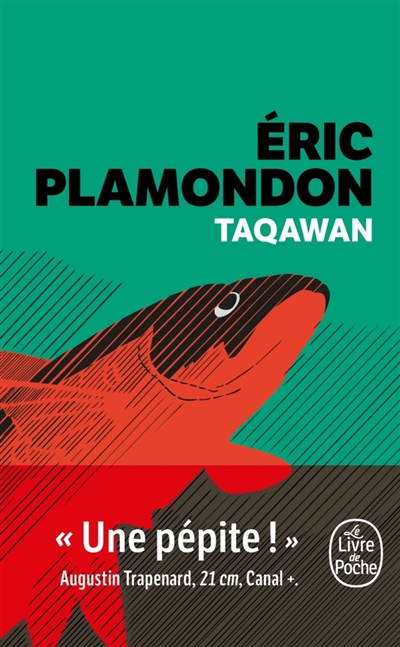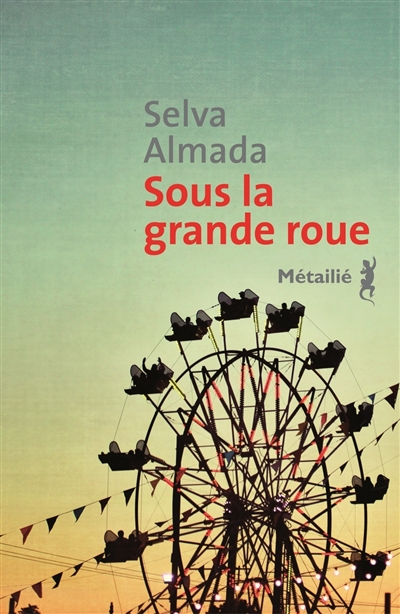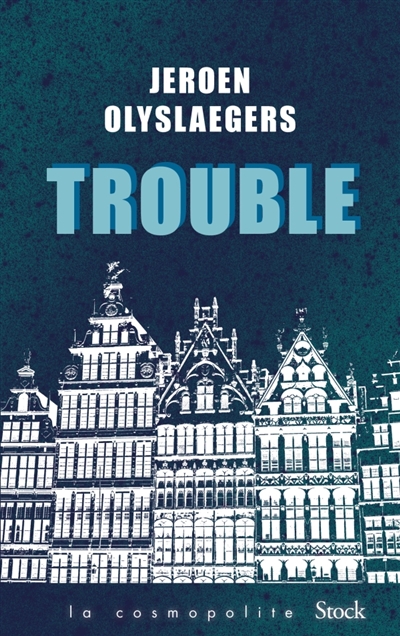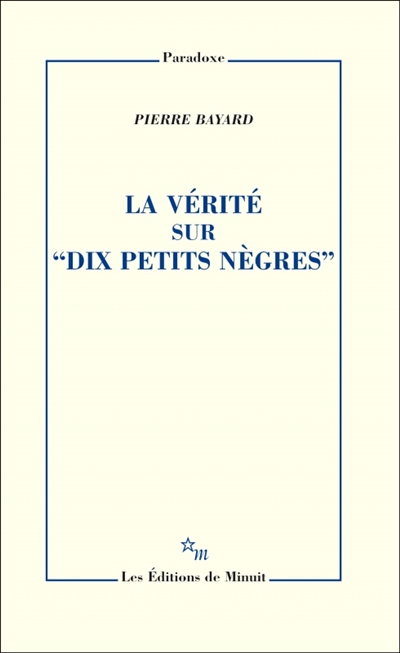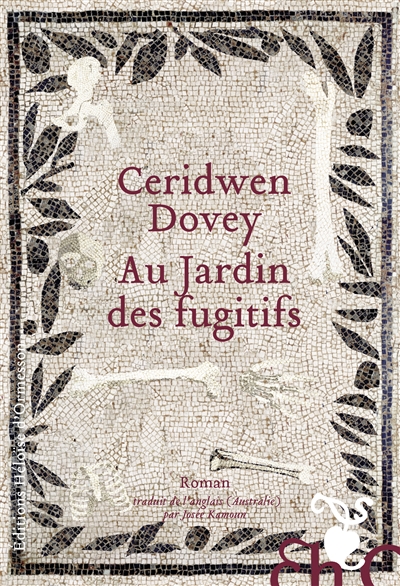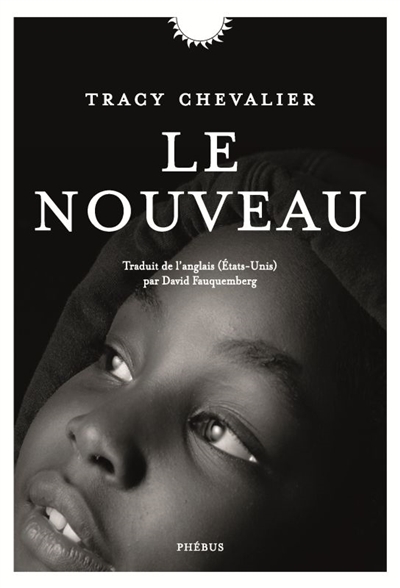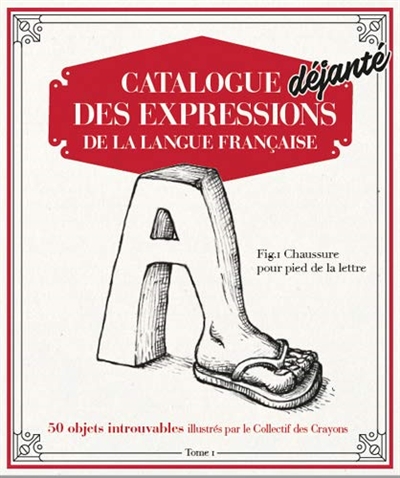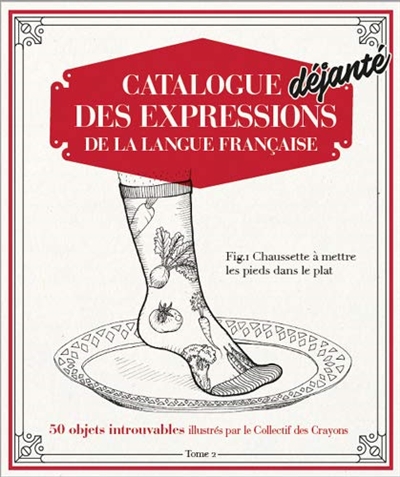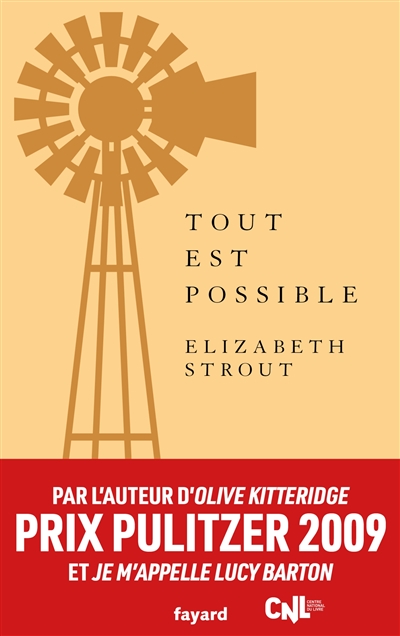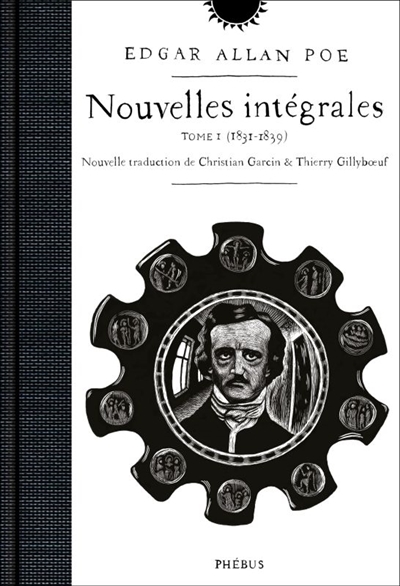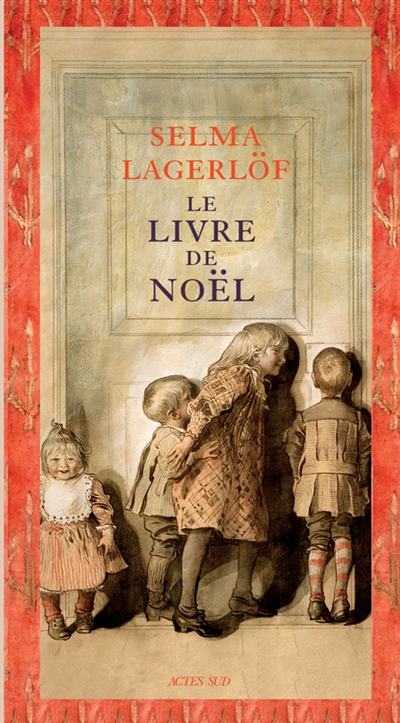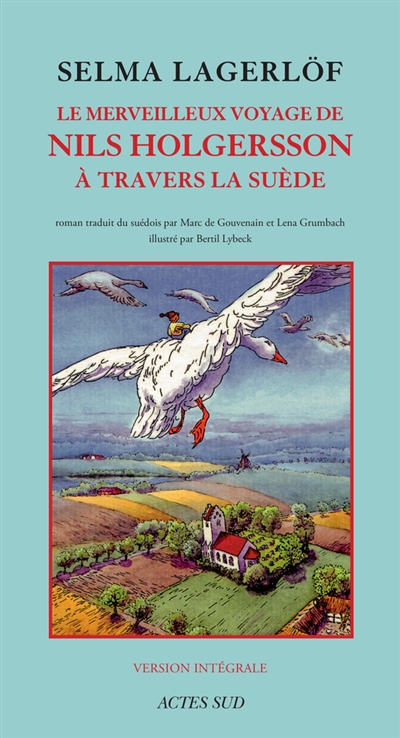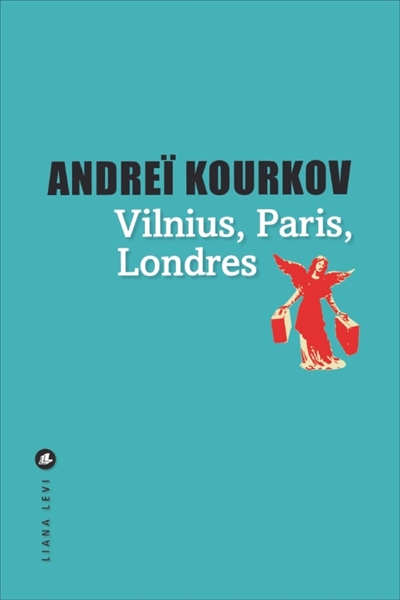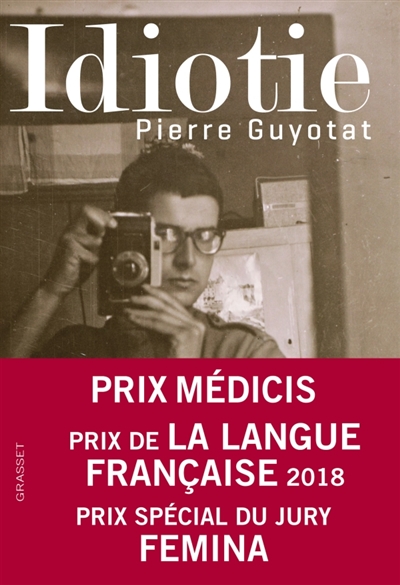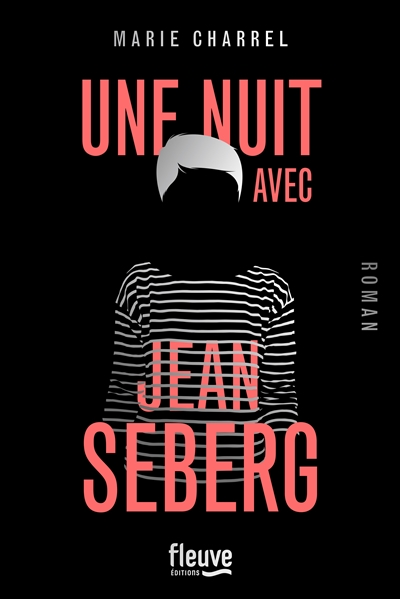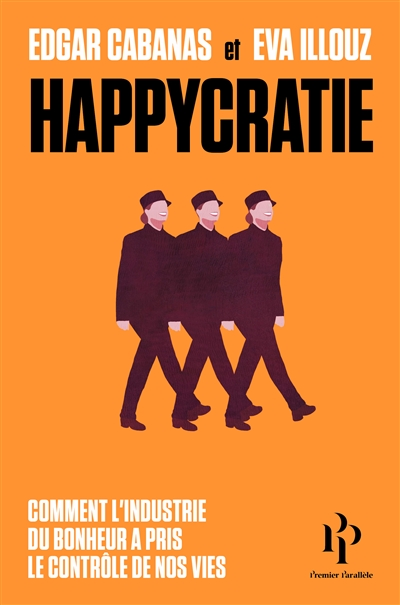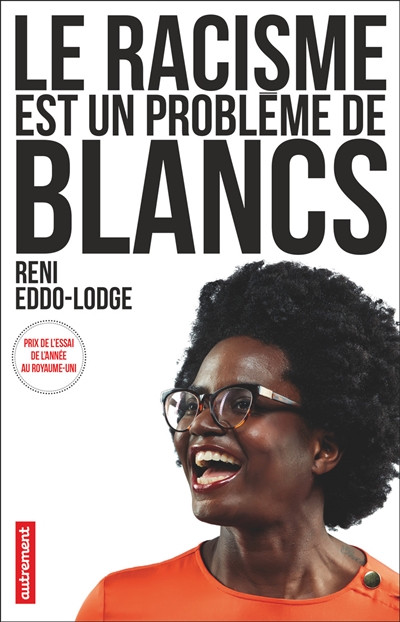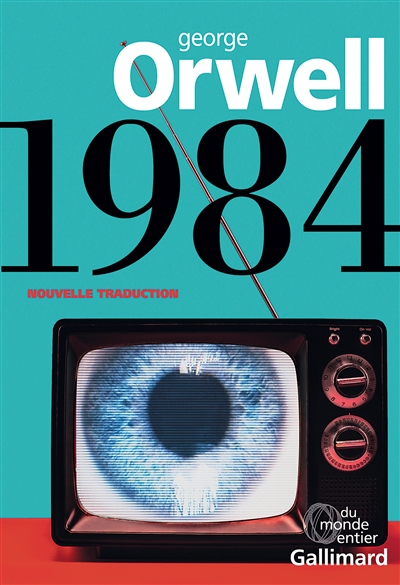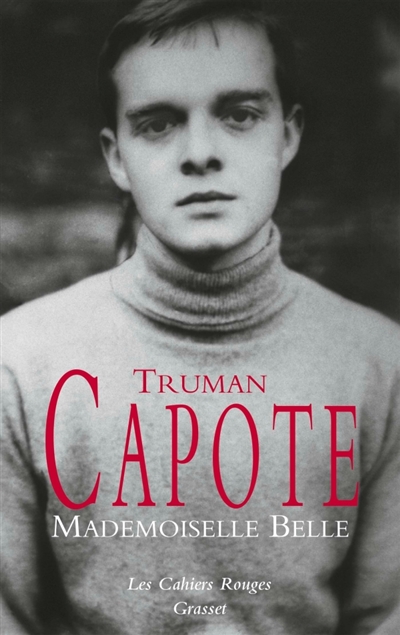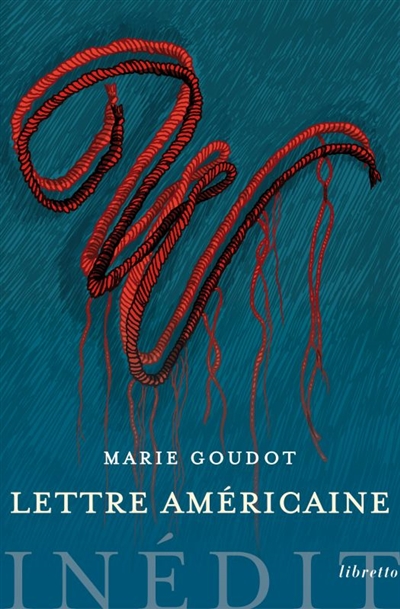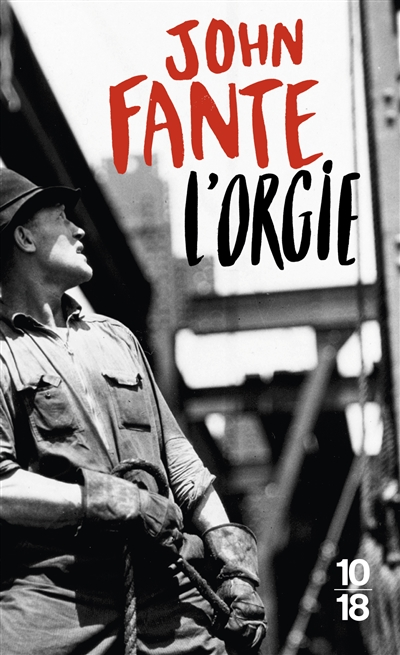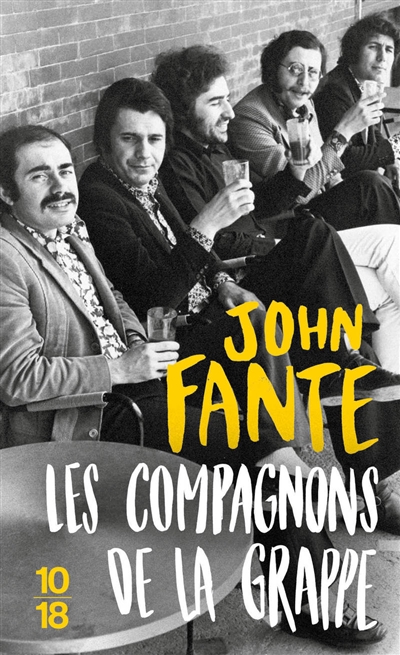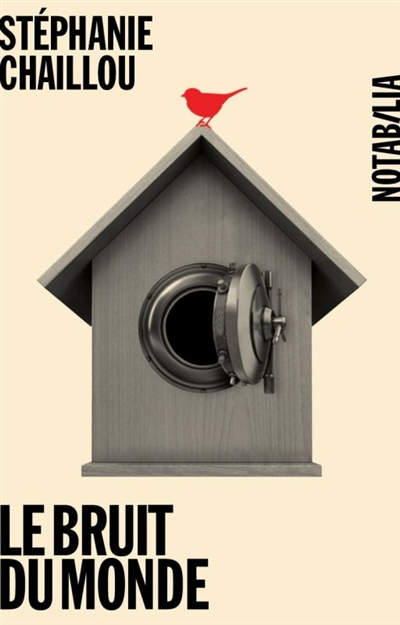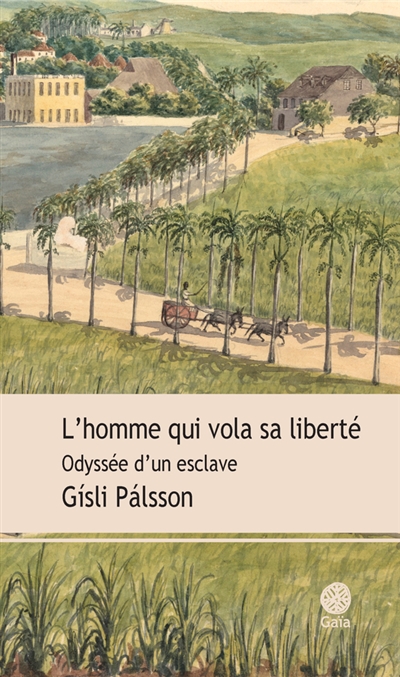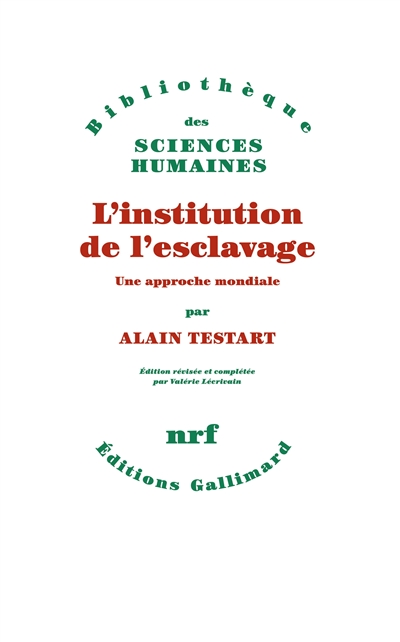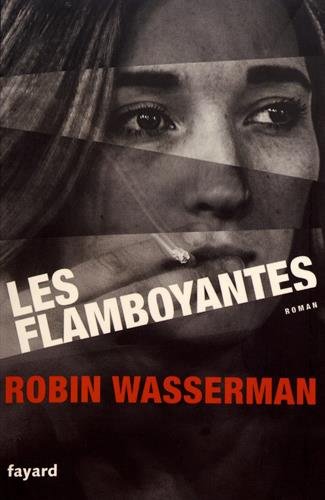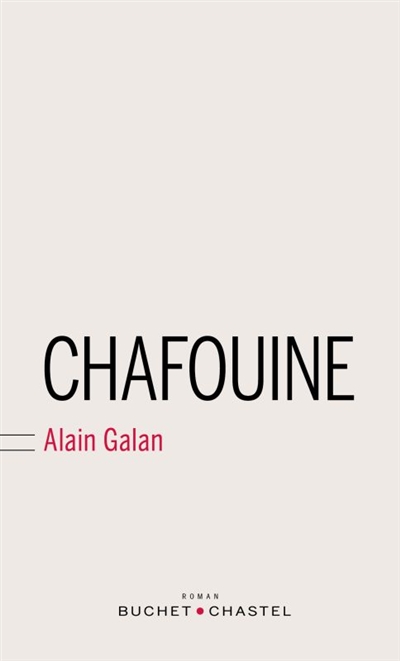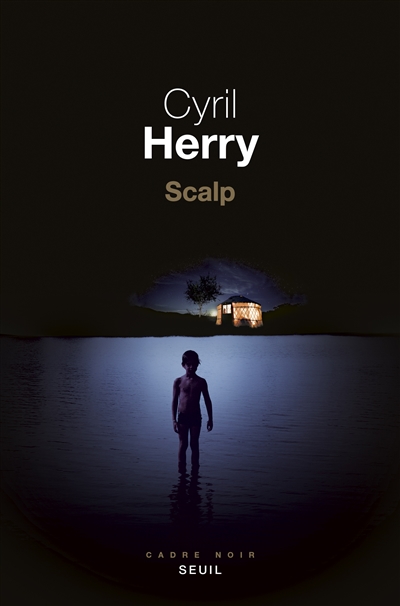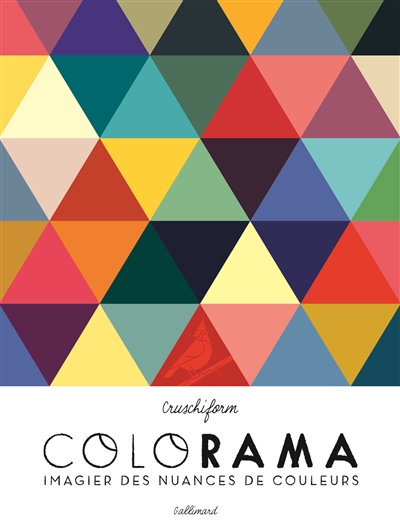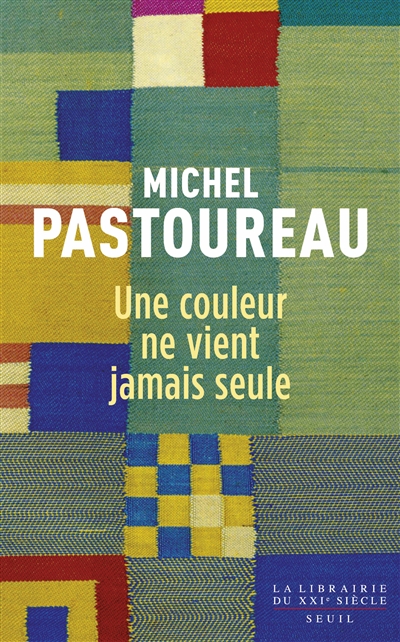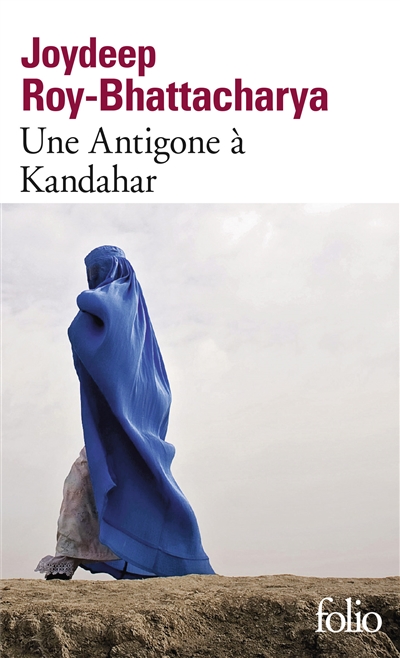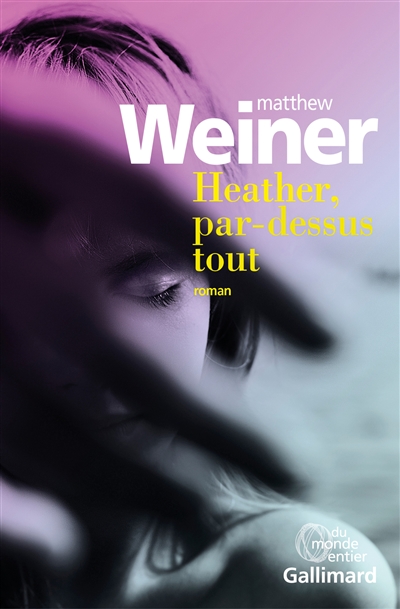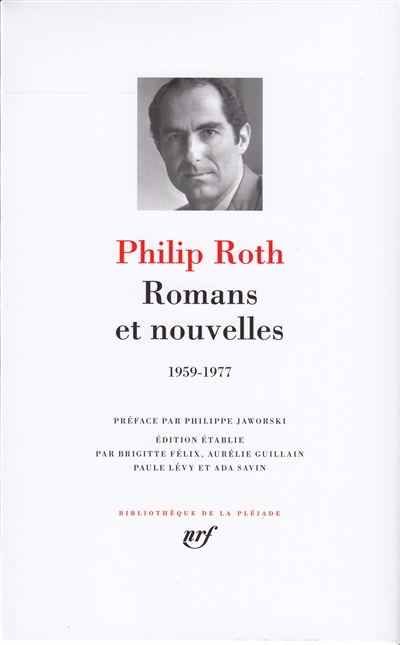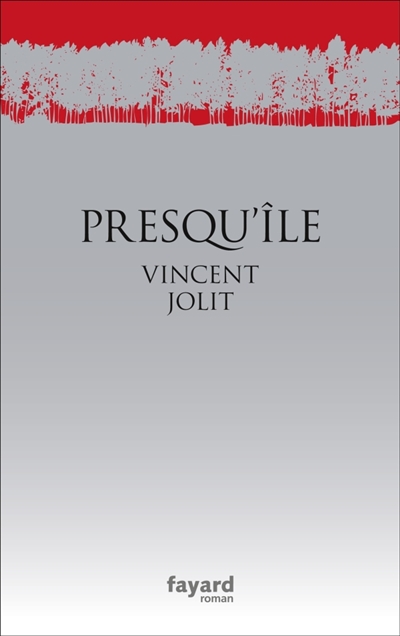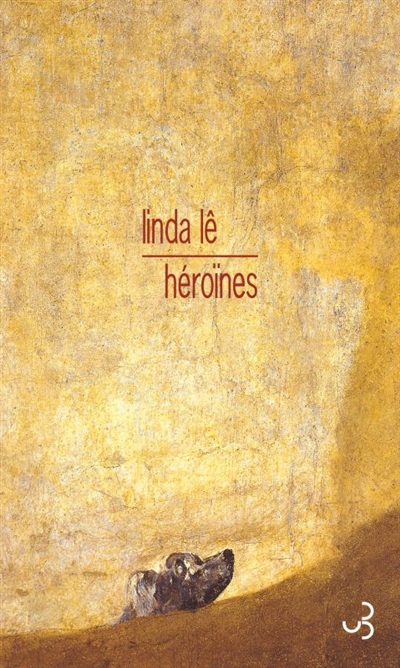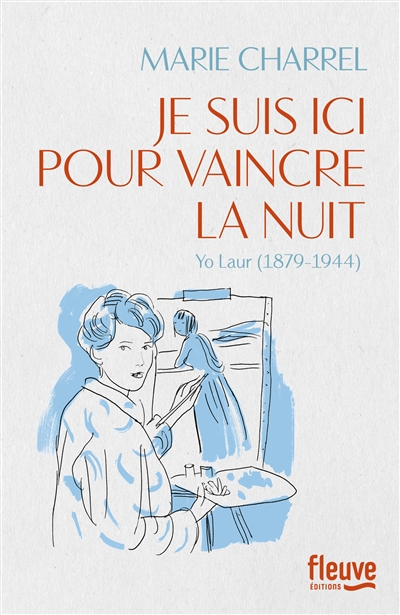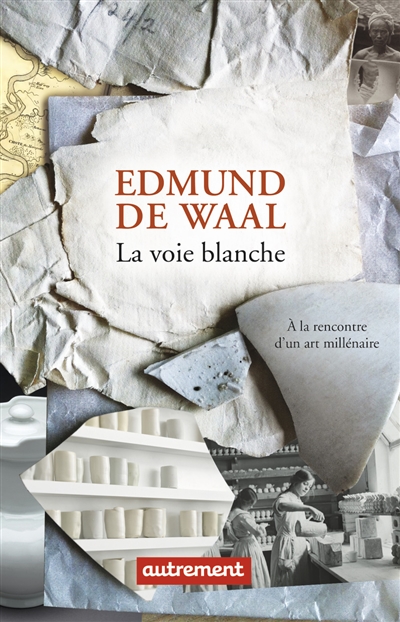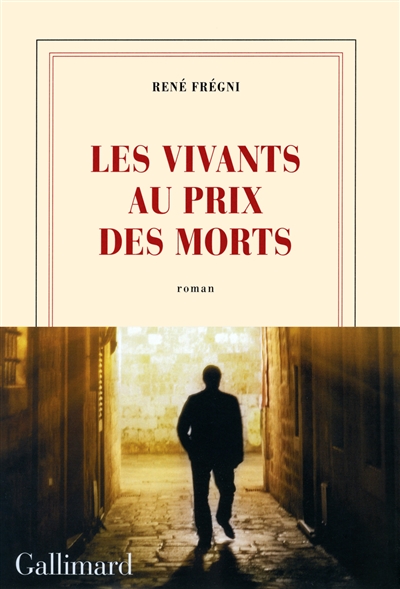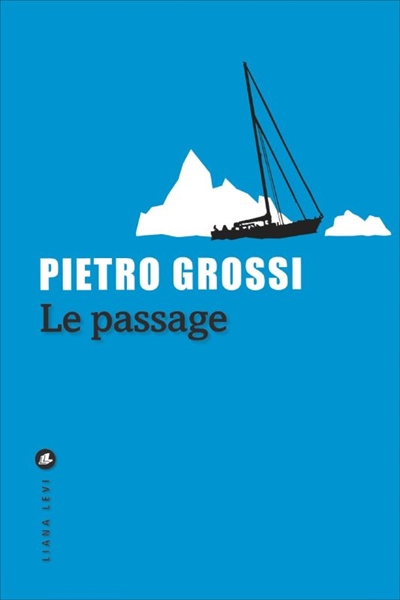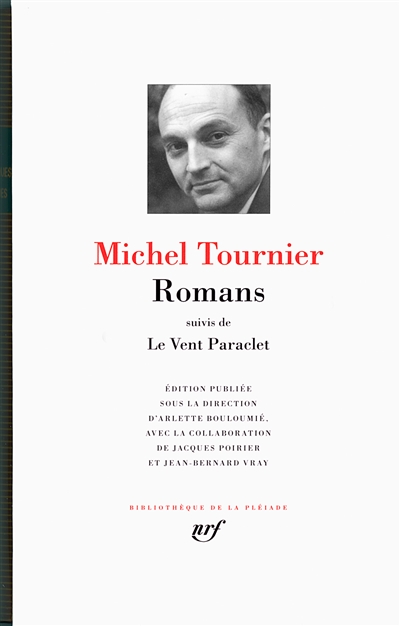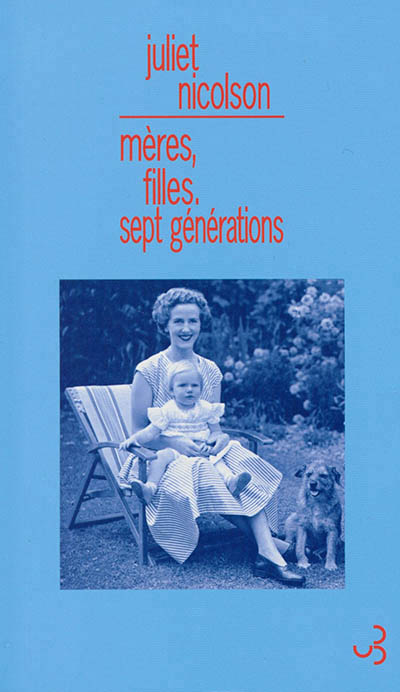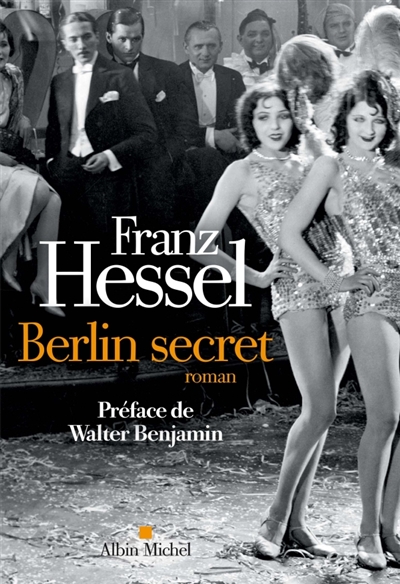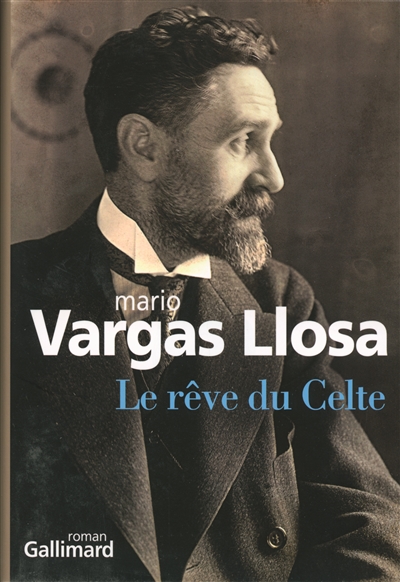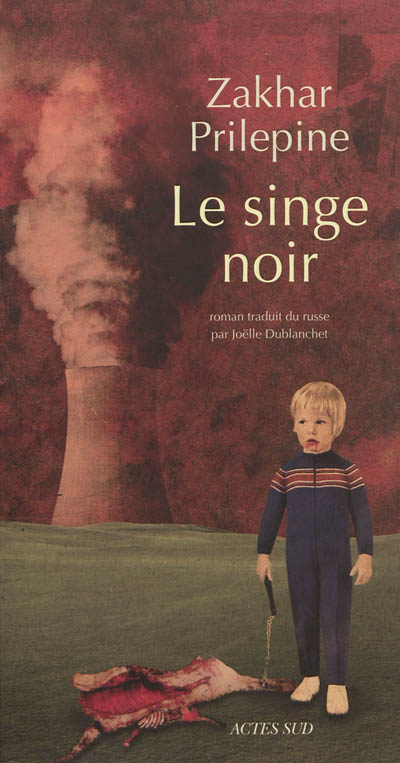Littérature française
Jean Echenoz
Envoyée spéciale
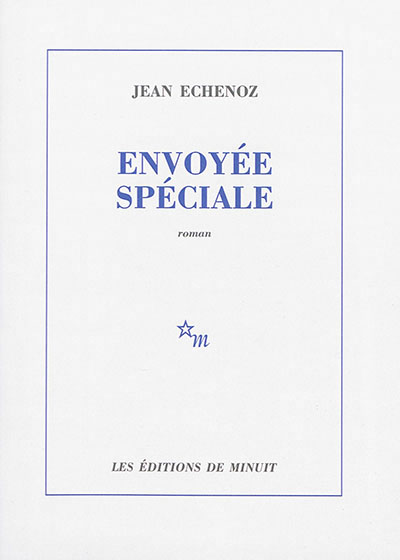
Partager la chronique
-
Jean Echenoz
Minuit
07/01/2016
320 p., 18.50 €
-
Chronique de
Aurélie Janssens
Librairie Page et Plume (Limoges) -
Lu & conseillé par
53 libraire(s)


Chronique de Aurélie Janssens
Librairie Page et Plume (Limoges)
Après avoir exploré les vies de Ravel, ZÀtopek et Tesla, nous avoir plongé avec émotion et poésie au cœur des tranchées de 14-18, le dernier roman de Jean Echenoz nous ramène au présent, à des êtres de fiction, pour une opération spéciale : réaliser un roman d’espionnage drôle et fascinant.
Lou Tausk, pseudonyme de Louis Coste, a été l’auteur d’un tube, « Excessif », chanté par sa compagne Constance, tube planétaire qui a fait d’elle une star jusqu’en Corée du Nord. Des années plus tard, Lou Tausk tente, tant bien que mal, de se refaire une notoriété, tandis que Constance s’éloigne de lui. Cette femme sans histoires, sans passion, « oisive » comme la décrit Jean Echenoz, va pourtant se faire enlever. Ses ravisseurs, « Autruche » et « Lamantin » aux ordres de l’obscur Victor, la séquestrent dans la Creuse. Cet emprisonnement à ciel ouvert a pour but de la « retourner », avant de l’envoyer en Corée du Nord en mission spéciale. On le comprend avec ce résumé, Jean Echenoz distille encore une fois une bonne dose d’humour et recourt à un ton décalé pour servir son histoire. Les personnages sont irrésistibles, à la fois hauts en couleur et attachants. L’intrigue, sur le mode du roman d’espionnage, nous happe, nous emmenant de Paris en Corée du Nord. Jean Echenoz est un funambule des mots. Avec lui, tout est une question d’équilibre entre gravité et légèreté.
Page — Le titre, Envoyée spéciale, la quatrième de couverture évoquant une mission, et, bien entendu, l’intrigue, les personnages… on ne peut s’empêcher de parler de « roman d’espionnage » pour qualifier votre livre. Souhaitiez-vous avec ce texte (comme avec Lac, Minuit, 1989), montrer que le roman d’espionnage, souvent présenté comme un genre mineur, a parfaitement sa place dans le monde des Lettres ?
Jean Echenoz — Je ne crois pas que ce soit encore à démontrer. Il existe bien sûr des romans d’espionnage qui ne s’embarrassent pas de souci littéraire – c’est d’ailleurs le cas, me semble-t-il, de toutes les formes romanesques. Mais de Joseph Conrad à John Le Carré, en passant par Eric Ambler, le thème de l’espionnage a toujours parcouru le champ de la littérature. Ce n’est pas une forme mineure, c’est une forme possible.
P — Quelle était votre envie initiale en écrivant ce roman ? Faire de la littérature de genre ? Ou l’accent s’est-il plutôt porté sur des personnages, des lieux ?
J. E. — J’avais surtout envie d’un roman situé dans l’espace contemporain. J’ai passé ces dernières années à écrire sur des personnages ou des événements qui appartiennent à l’Histoire et je voulais retrouver le temps présent. Profiter d’une intrigue pour donner des images de notre époque. Donner des nouvelles, si vous voulez.
P — Dans certains articles, on évoque OSS 117 ou la série diffusée en octobre sur Arte Au service de la France, au sujet de votre roman. Aviez-vous certaines références en tête lors de l’écriture, ou souhaitiez-vous au contraire vous détacher complètement des productions (littéraires et cinématographiques) existantes ?
J. E. — Je n’ai pas vu la série dont vous parlez, et je n’ai pas le souvenir d’avoir lu beaucoup d’OSS 117. Cela dit, les références abondent évidemment dès qu’on aborde telle ou telle forme. J’ai eu envie, par exemple, de reprendre dans ce roman deux situations repérées dans des films – l’un d’Alfred Hitchcock, l’autre des frères Coen. Mais l’intérêt qu’on trouve à construire une action peut aussi consister à prendre les modèles à contre-pied. Ce qui m’importe le plus, disons que c’est la liberté, et je me suis peut-être senti plus libre dans l’écriture de ce livre que dans les précédents.
P — Avez-vous des références réelles, littéraires ou cinématographiques, lorsque vous construisez vos personnages ?
J. E. — Pas tellement. Je peux me servir de détails que j’observe dans la vie réelle en les greffant sur un personnage. Quand je n’ai pas la patience ou l’envie de décrire un personnage tel que je l’imagine, je peux aussi faire référence par exemple à tel ou tel acteur qui me semble avoir le même profil – disons que ça va plus vite. Même si, cet acteur, les gens ne le connaissent pas, ça n’a pas tellement d’importance : son nom seul sert un peu de passeport. Un nom fait toujours plus ou moins partie d’une description physique.
P — On parle souvent d’ironie à propos de votre œuvre. Les interventions de vos narrateurs, qui apparaissent comme des sortes de discussions avec le lecteur, ont pris au fil de vos romans un ton très reconnaissable. Est-ce devenu pour vous un style indispensable, une « marque de fabrique », votre souffle d’écriture, plus ou moins accentué selon les sujets de vos romans ?
J. E. — Je n’ai pas besoin de marque de fabrique et je n’en recherche pas, mais je n’y peux rien si c’est toujours moi qui écris mes livres. Sans vouloir faire le malin, je cherche simplement à trouver la distance qui me convient par rapport aux situations, aux personnages, aux décors. Si cela produit un rire ou un sourire, tant mieux, je me méfie toujours un peu d’une littérature d’où le rire est absent. Il est en tout cas toujours là chez les auteurs qui m’importent, que ce soit Diderot, Dickens, Flaubert ou Proust. Quant à l’intervention dans le récit d’un ou plusieurs narrateurs, qui ne sont pas forcément moi, c’est justement une tentative de créer une distance supplémentaire, parallèle, un regard différent sur ce qui se passe dans le roman.
P — Le roman débute à Paris, se poursuit dans la Creuse, avant de se diriger vers la Corée du Nord. Nous savons que les lieux sont importants pour vous, que la géographie occupe une part aussi importante que vos personnages. Comment avez-vous choisi les lieux de ce roman ?
J. E. — Ce seraient plutôt les endroits qui me choisissent, si je puis dire. La grâce et le mystère de certains lieux, c’est de déclencher des situations imaginaires, de ne plus être simplement un décor possible, mais le moteur ou le démarreur, ou le carburant d’une histoire. Ces lieux jouent quelquefois ce rôle malgré eux, en un sens, car ce ne sont pas forcément les plus beaux ni les plus intéressants à première vue qui produisent de la fiction.
P — Que ce soit dans la description de la Creuse ou dans celle de la Corée du Nord, on retrouve un humour extrêmement incisif et grinçant. Quel courroux craignez-vous le plus : celui des Creusois ou celui des Nord-Coréens ?
J. E. — Je n’ai pas le sentiment d’avoir été spécialement désobligeant à l’égard de l’une ou l’autre de ces zones : je connais un peu la Creuse, d’abord, qui est une très belle région. Quant à mes descriptions de la Corée du Nord, faute d’avoir pu me rendre dans ce pays, elles s’appuient sur différents récits et témoignages. À partir d’eux, et en les développant, j’ai pu me livrer à mon exercice de romancier, qui est avant tout d’imaginer des scènes et de les articuler, de construire des images et d’essayer de donner à voir tout ça.