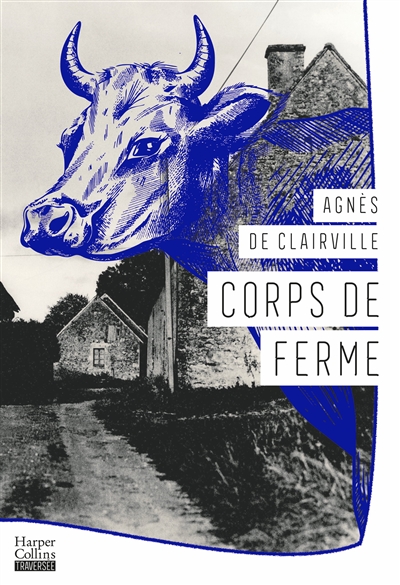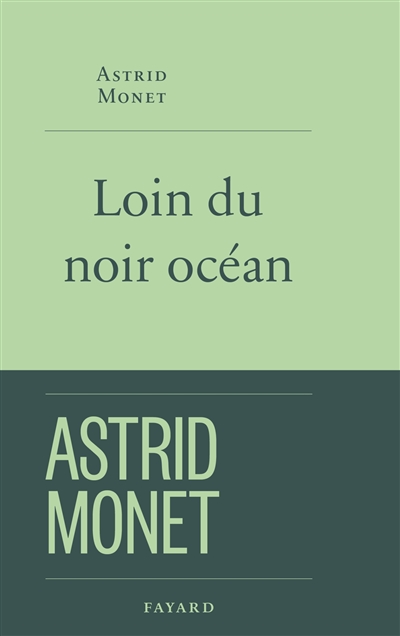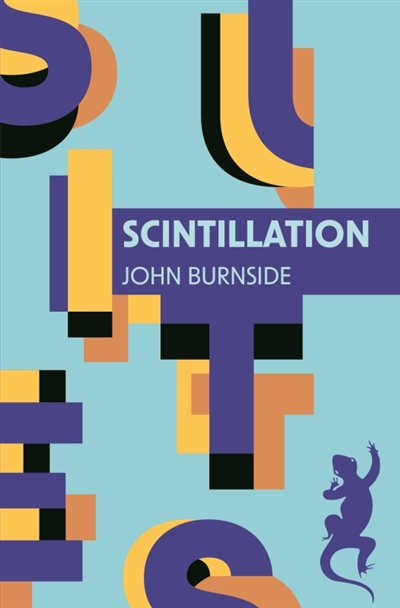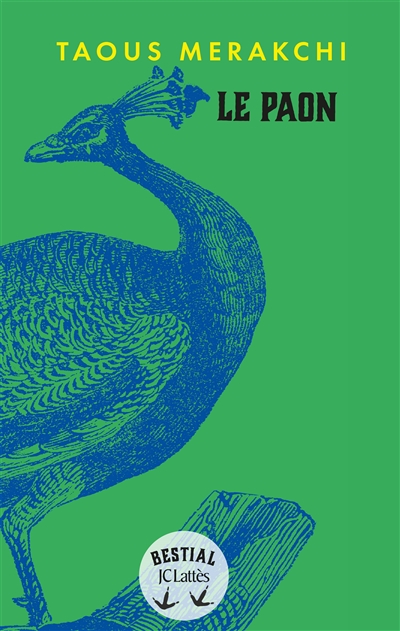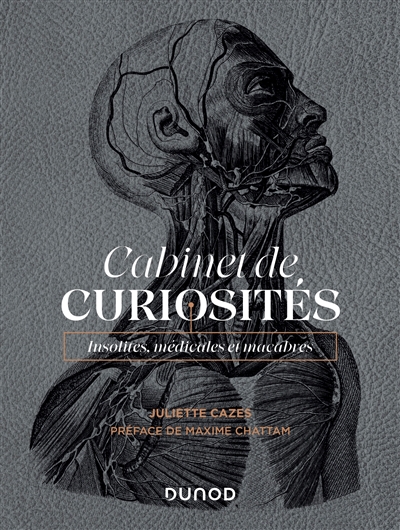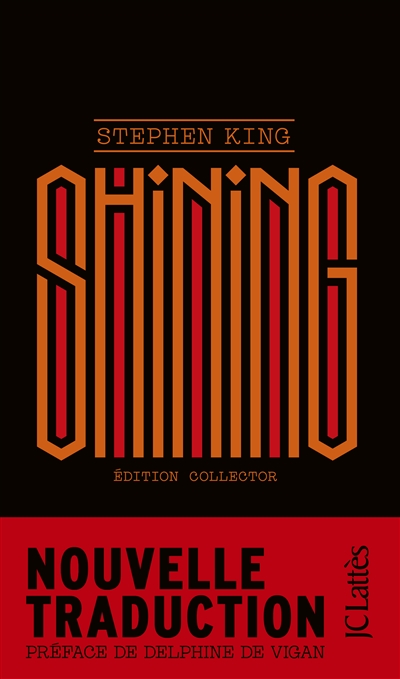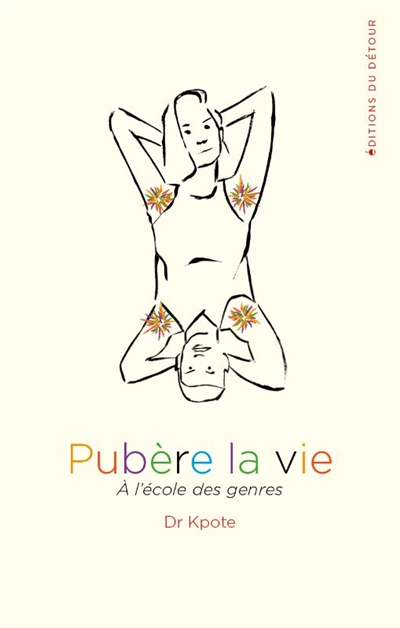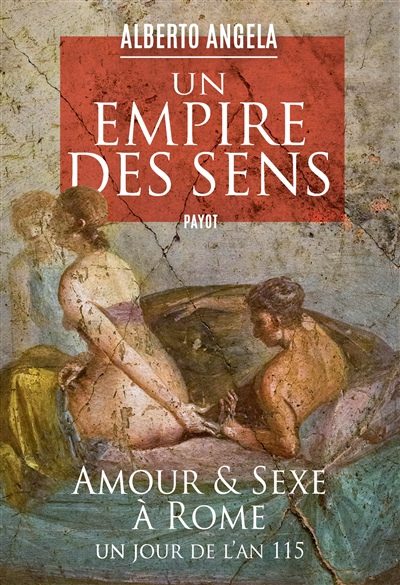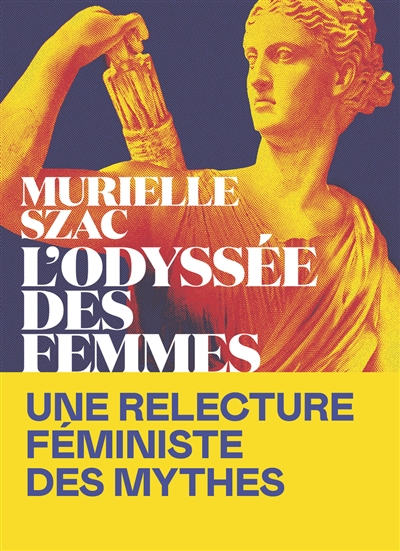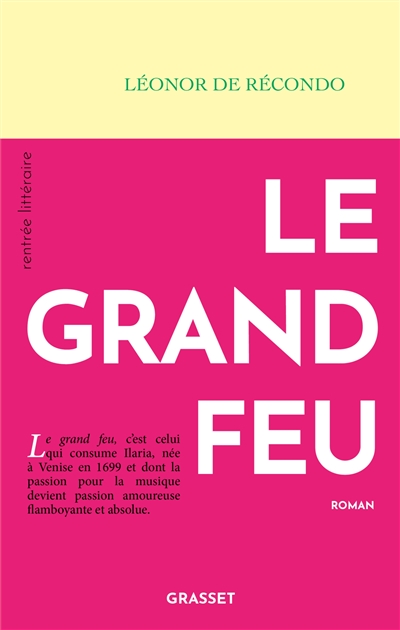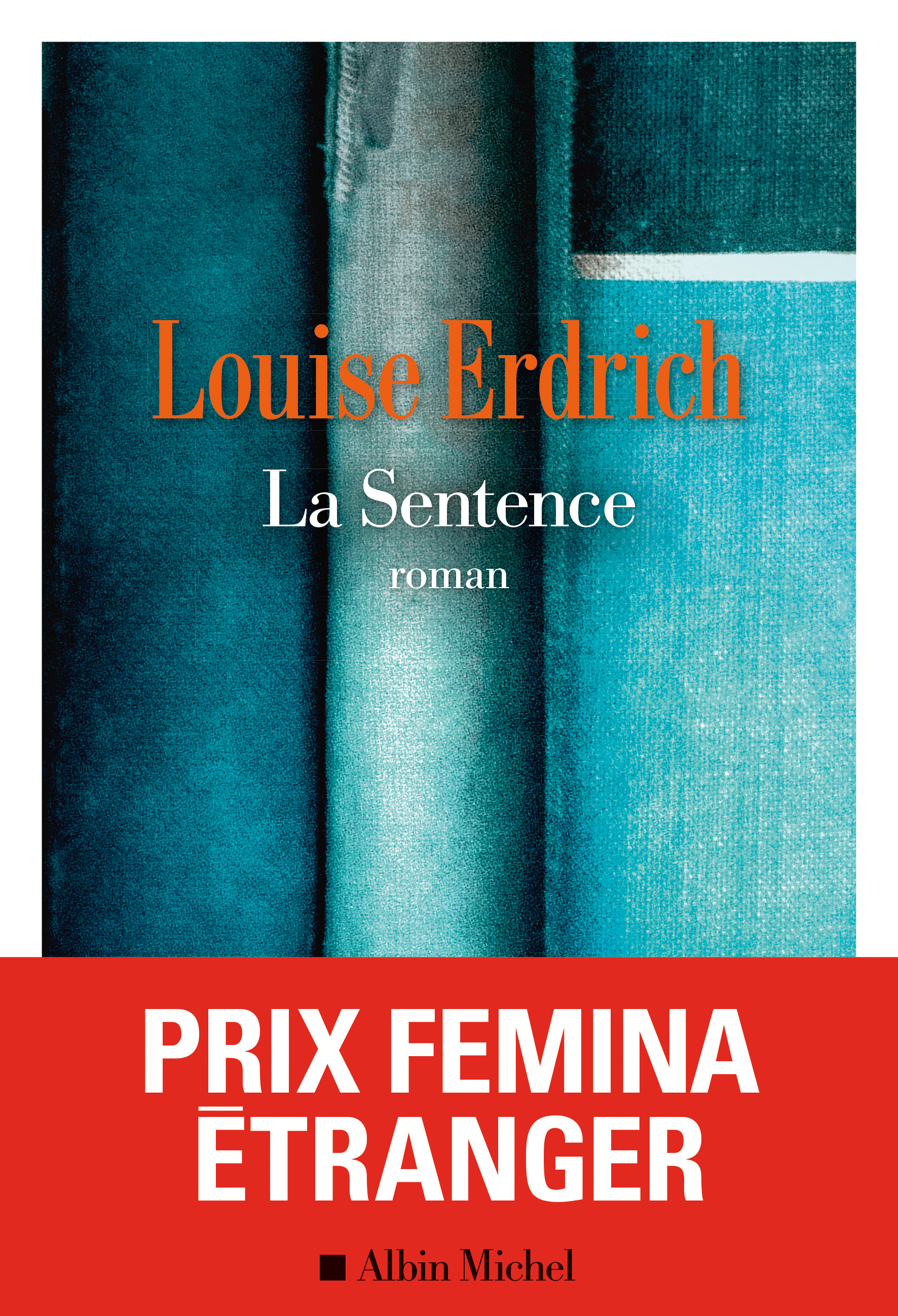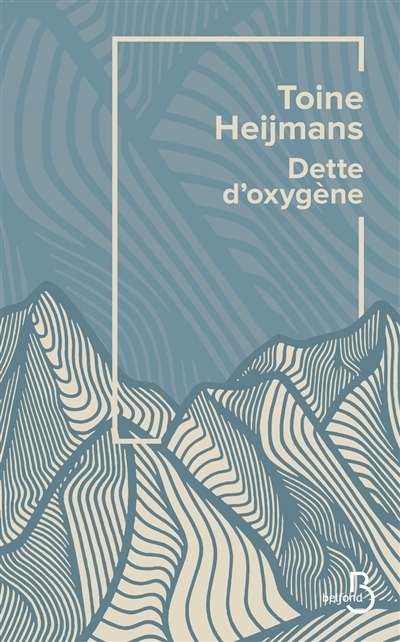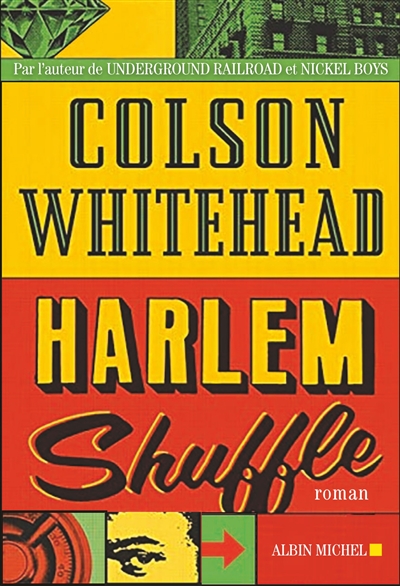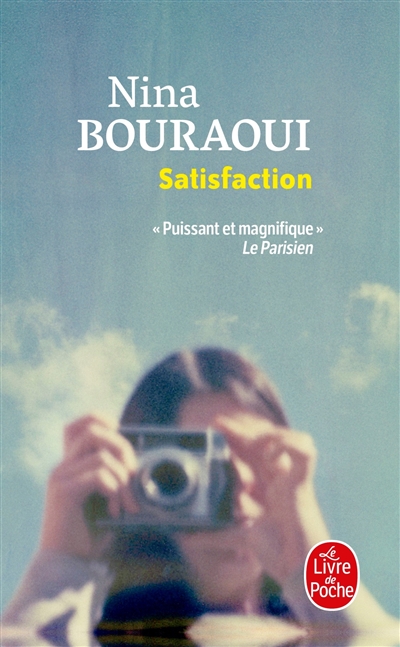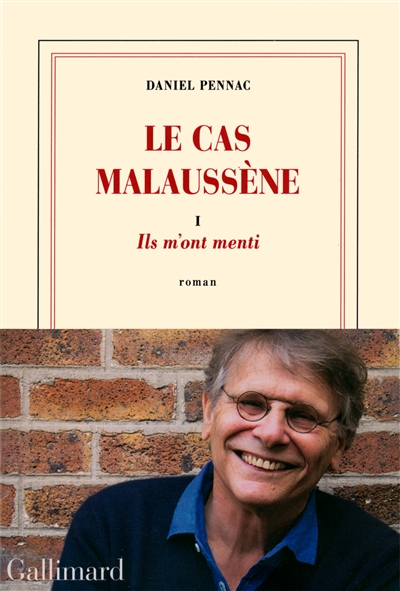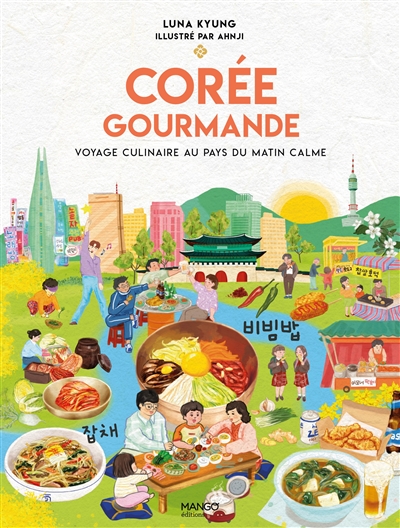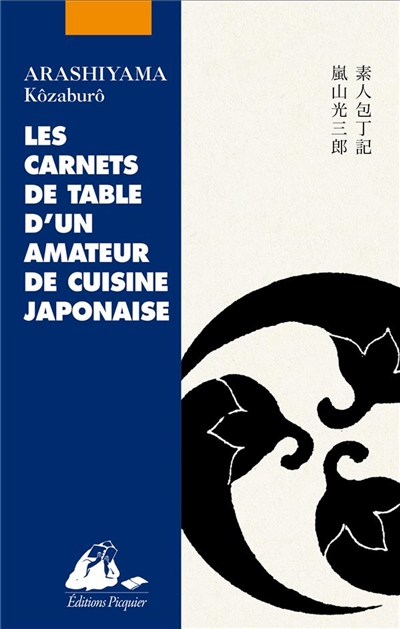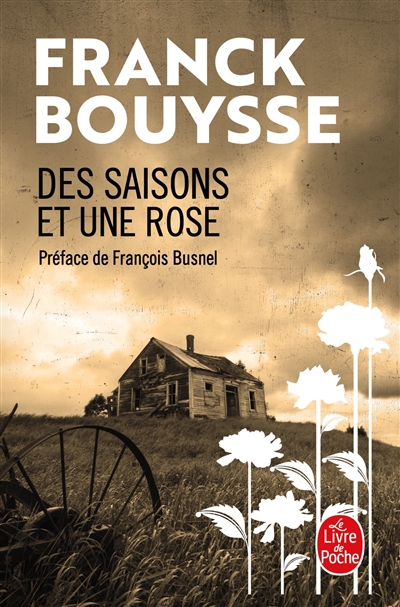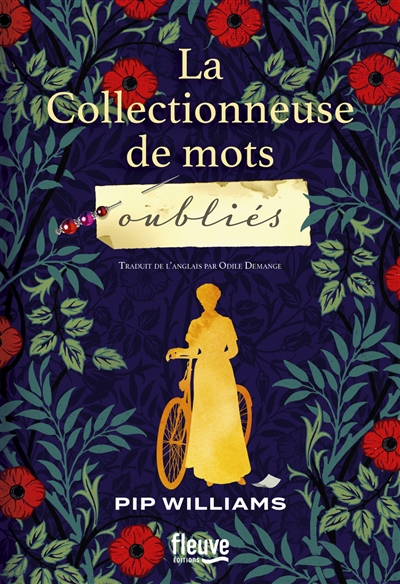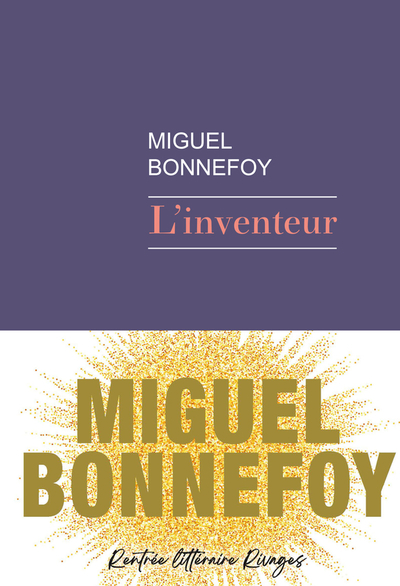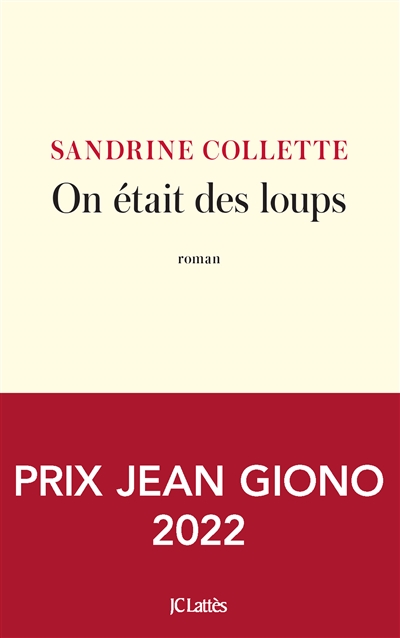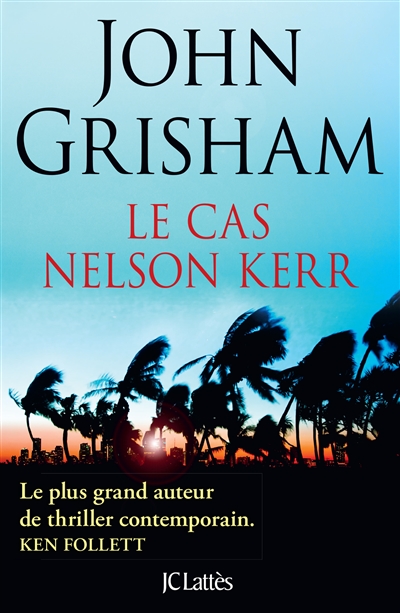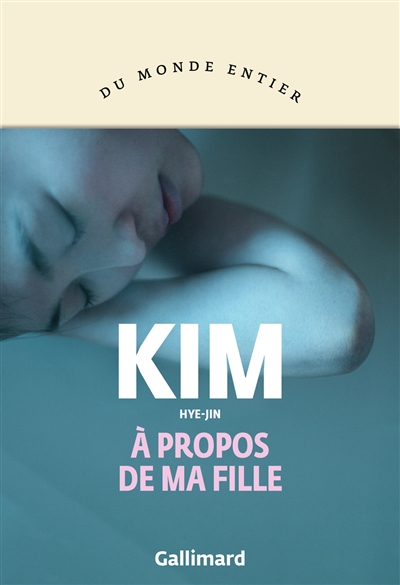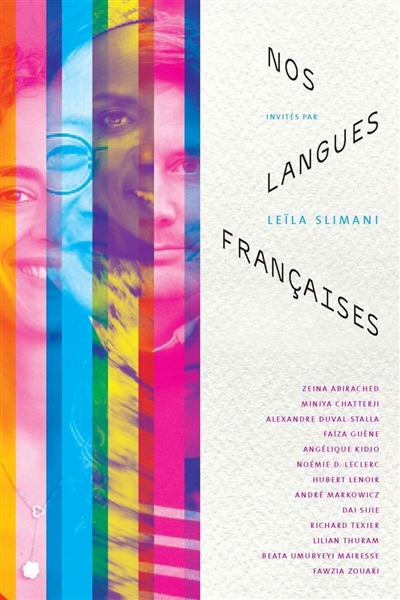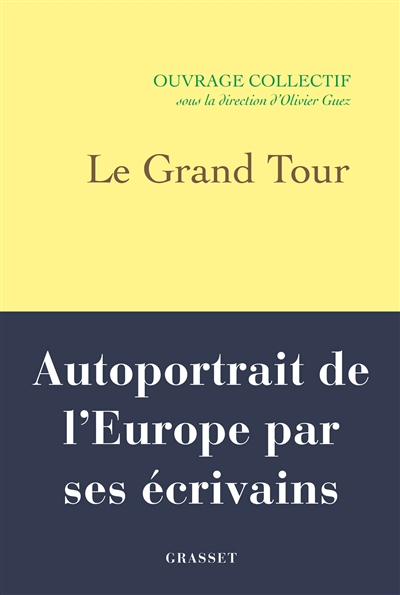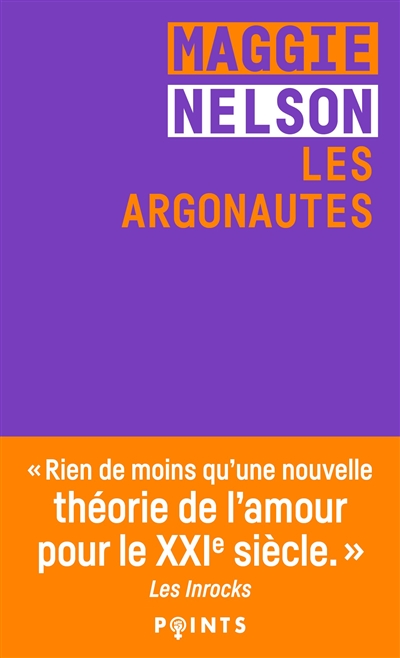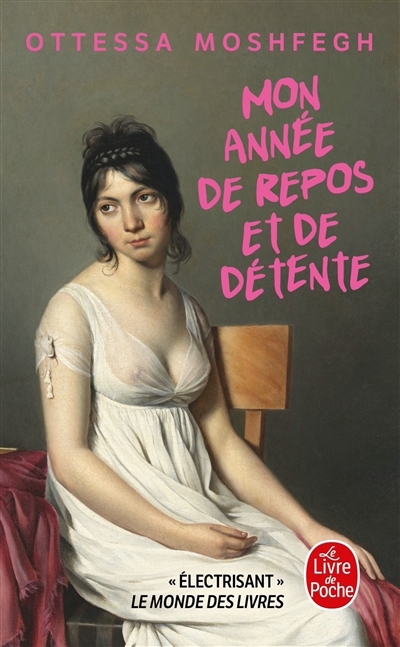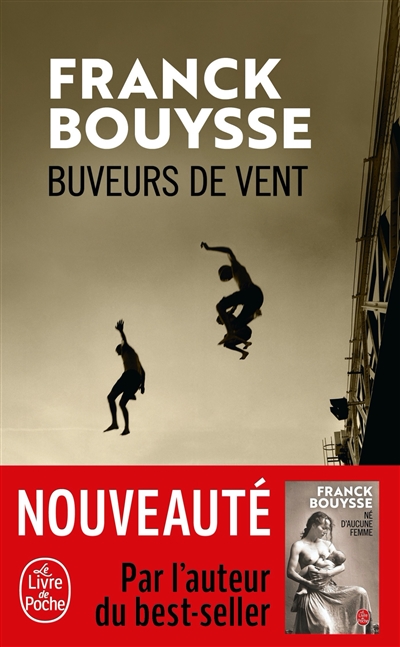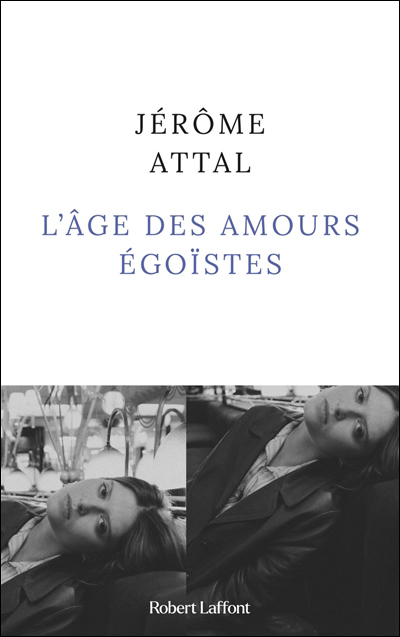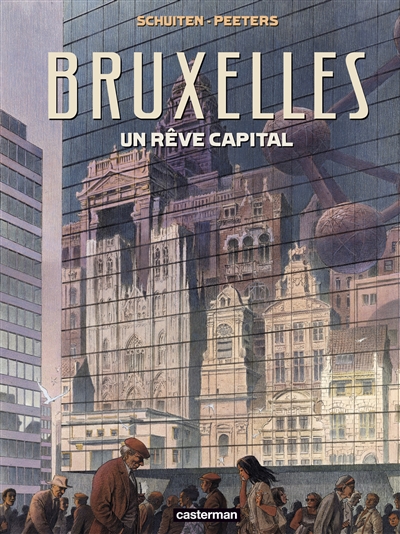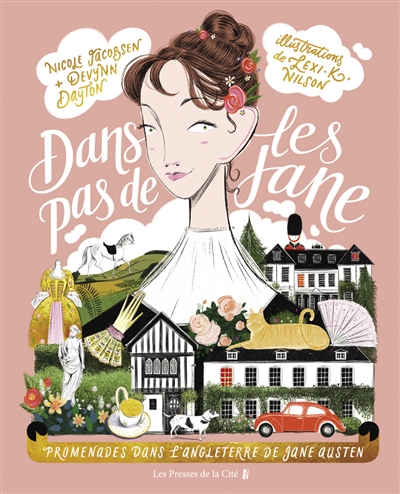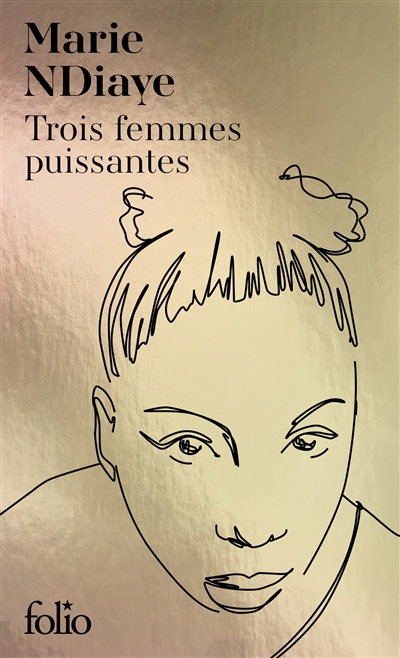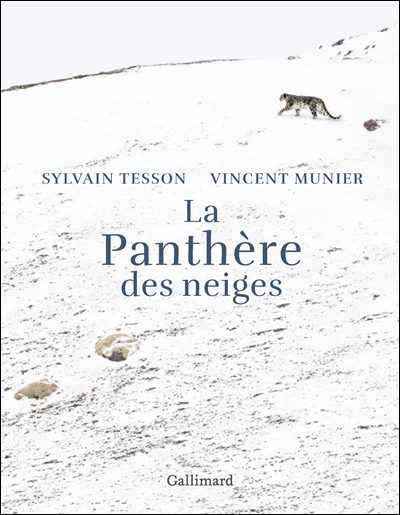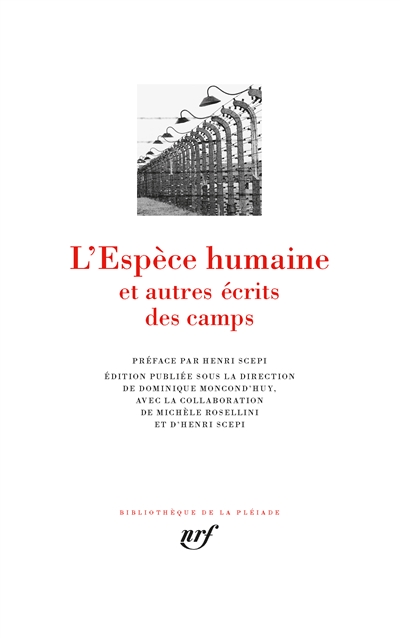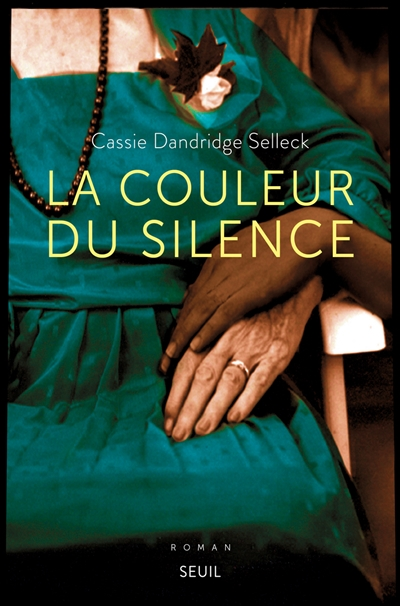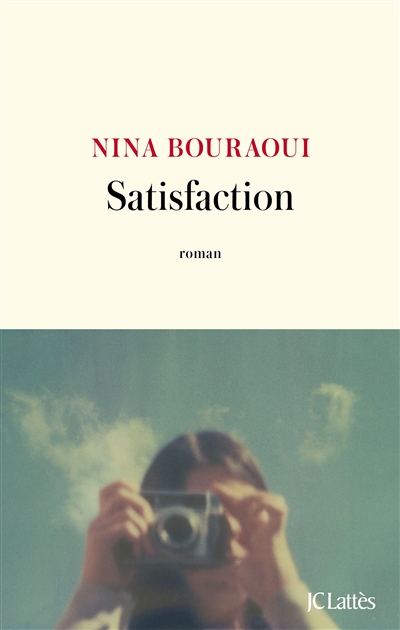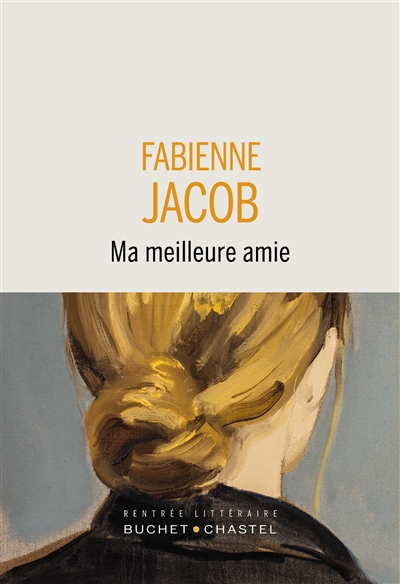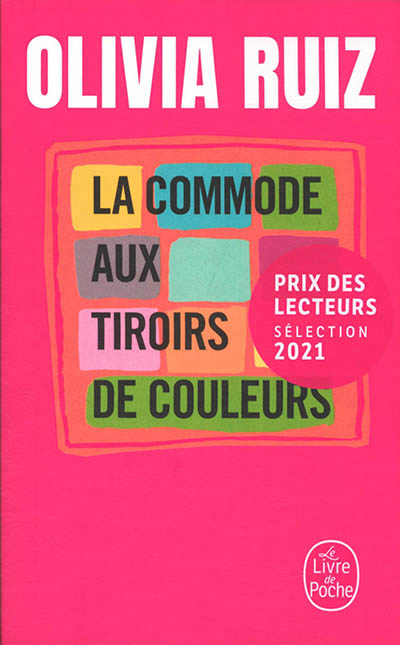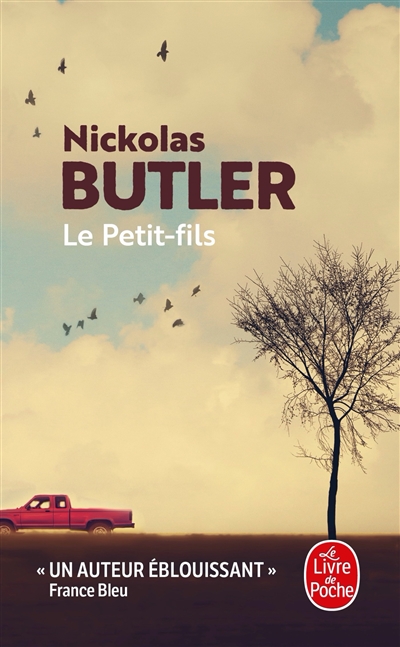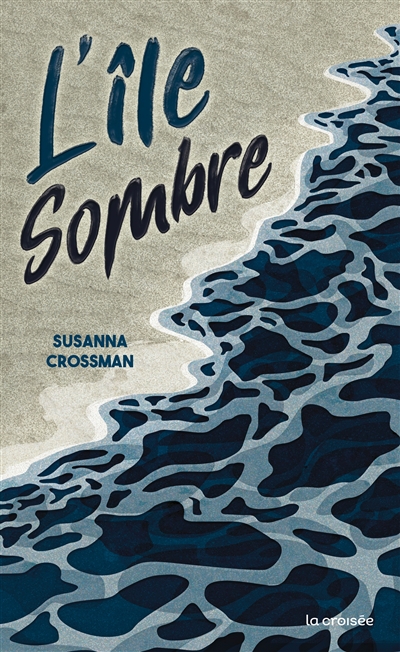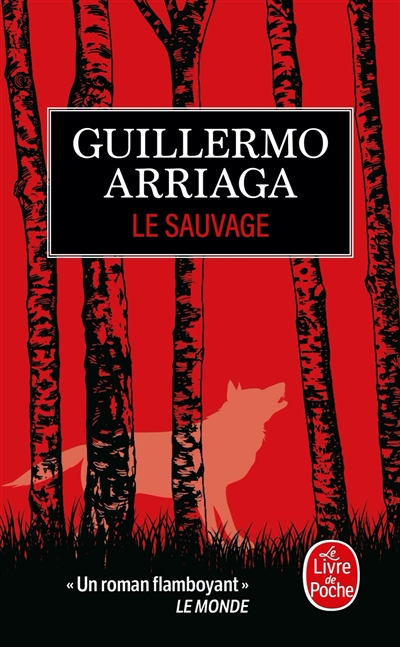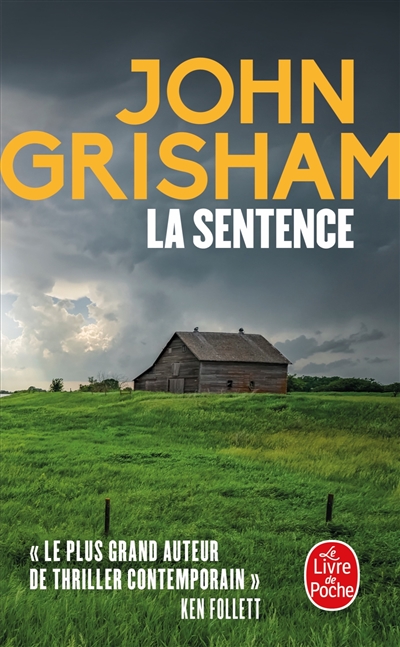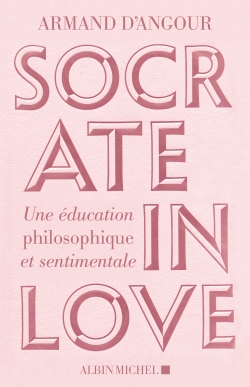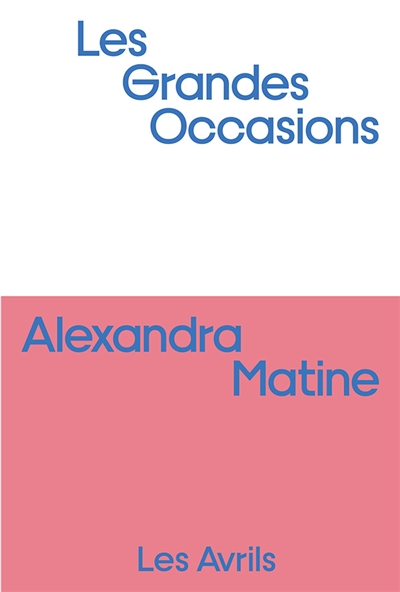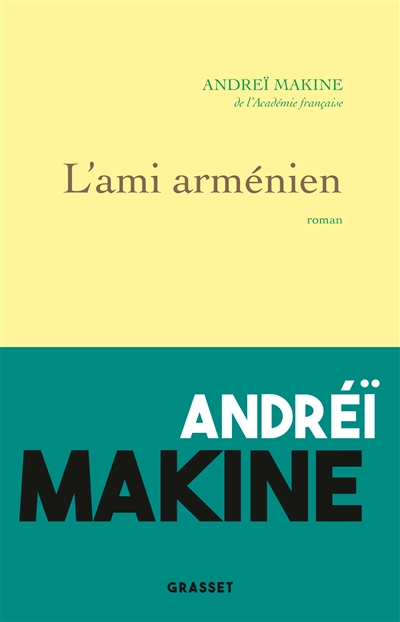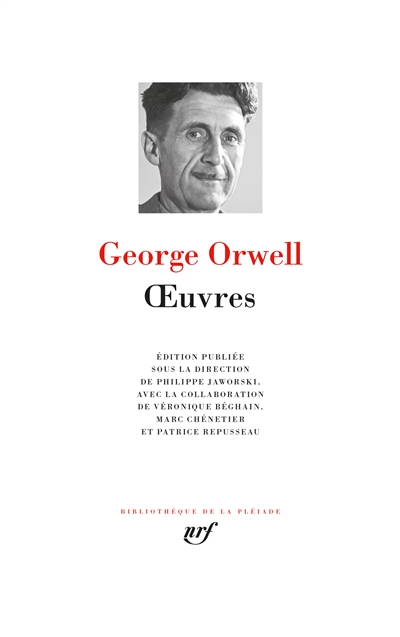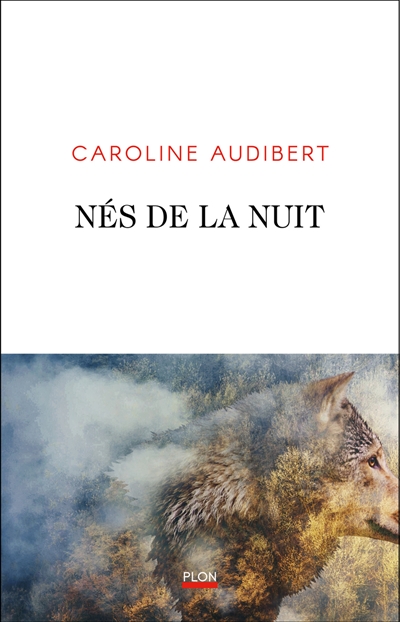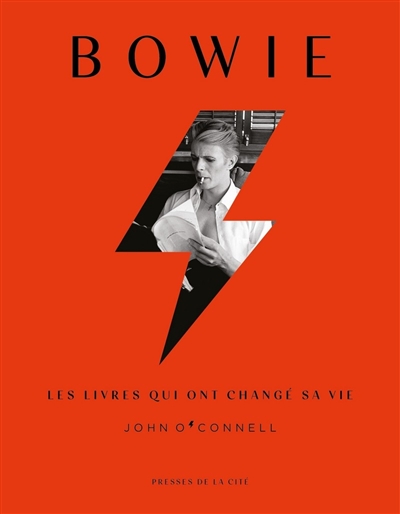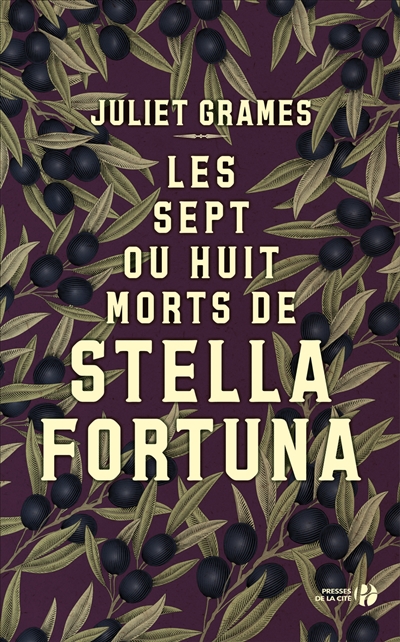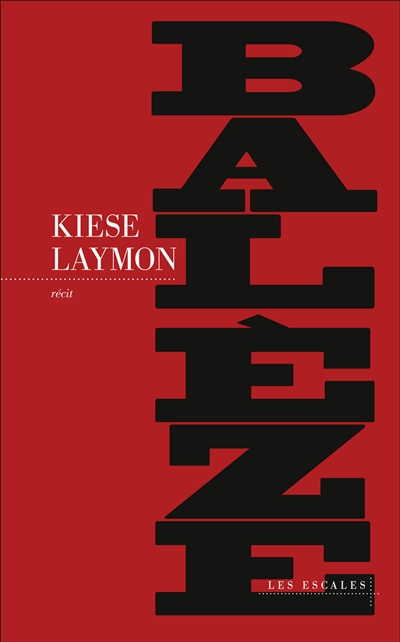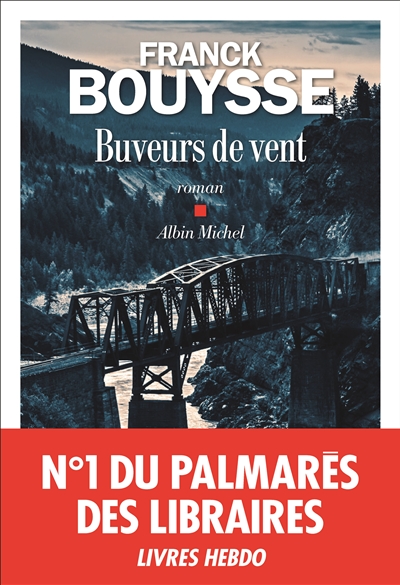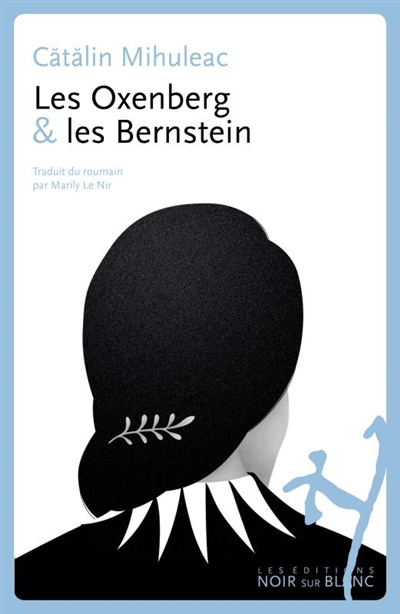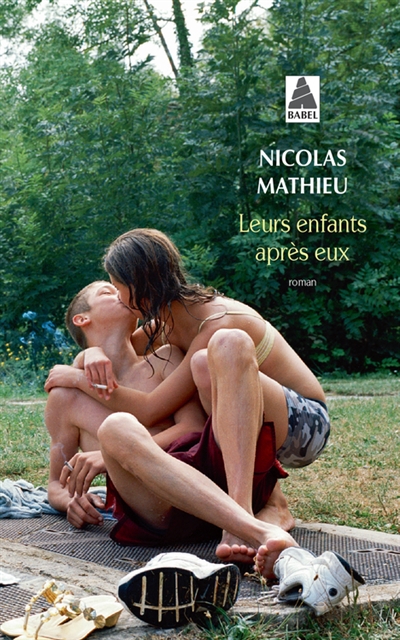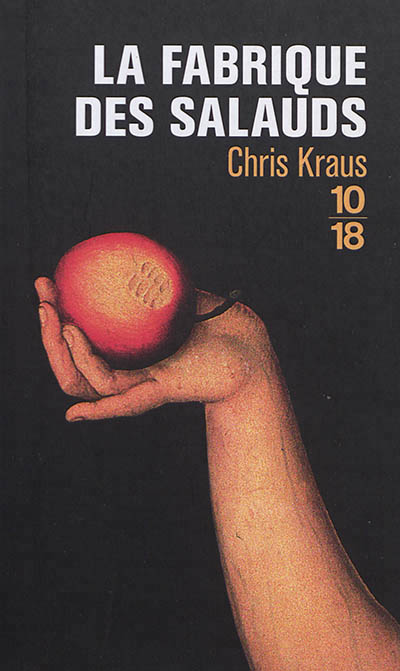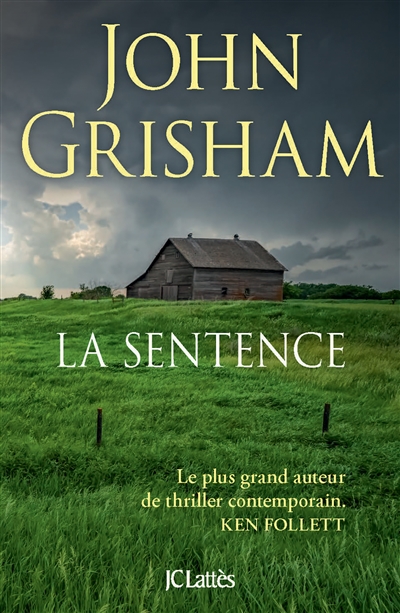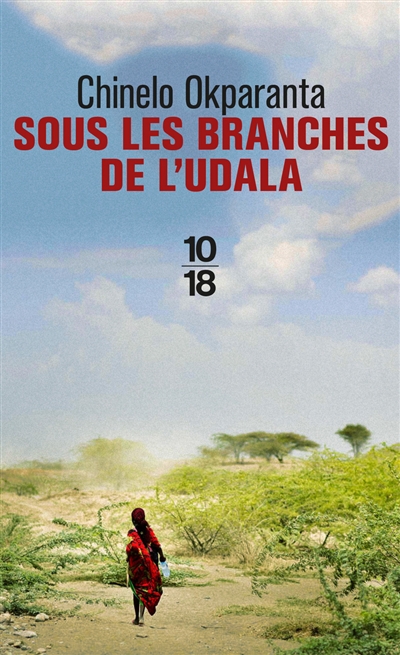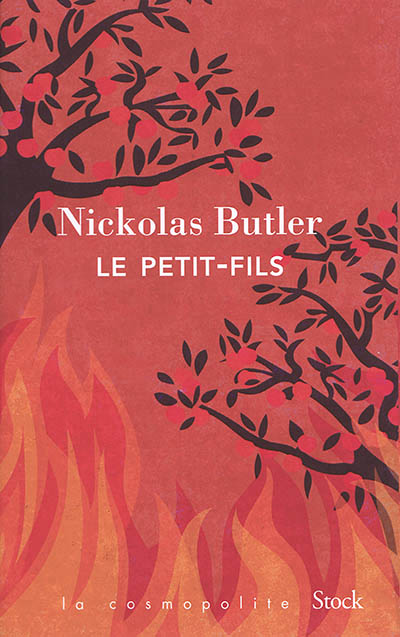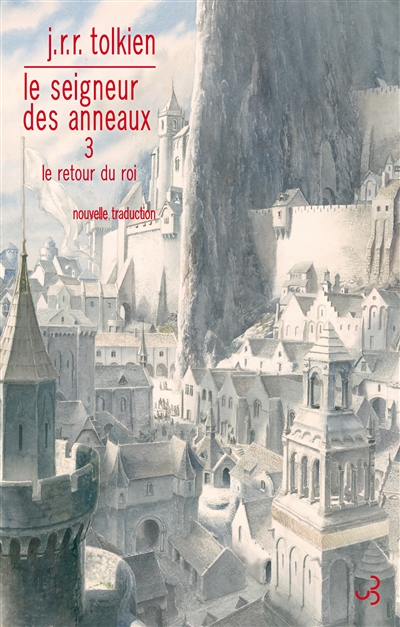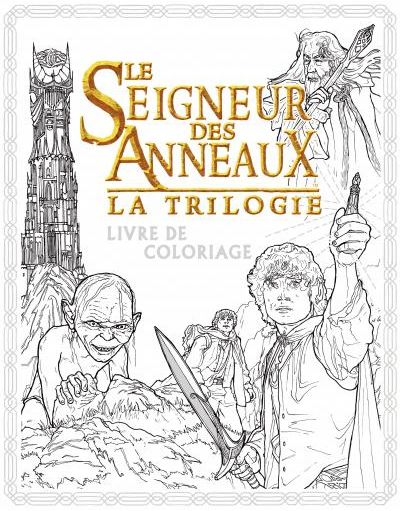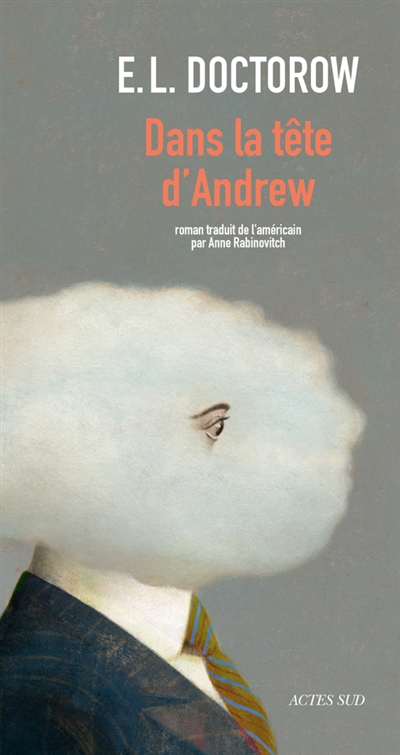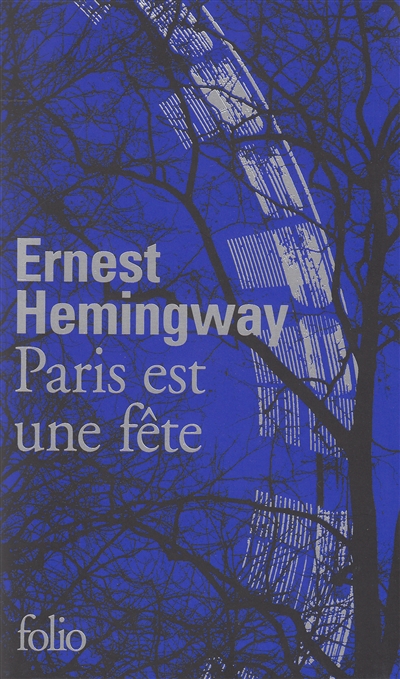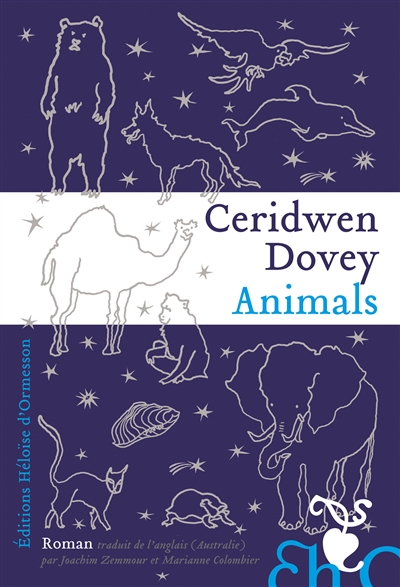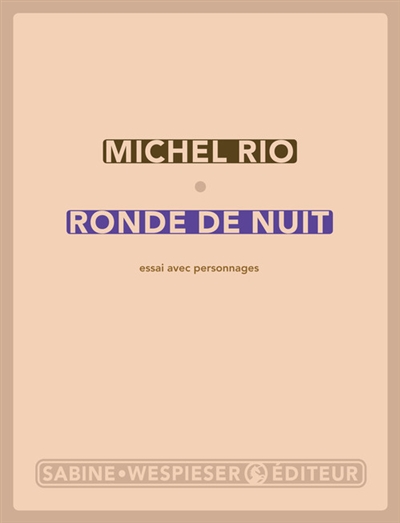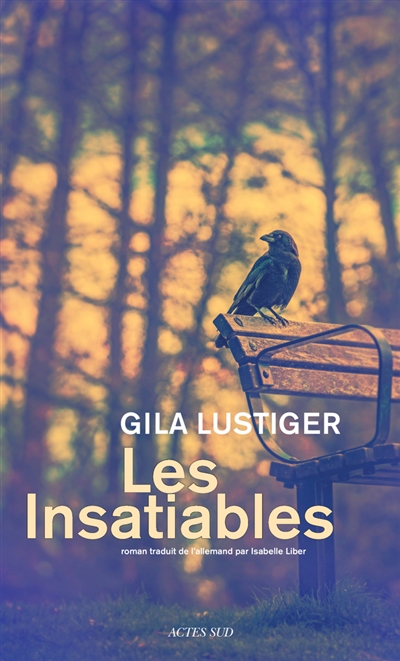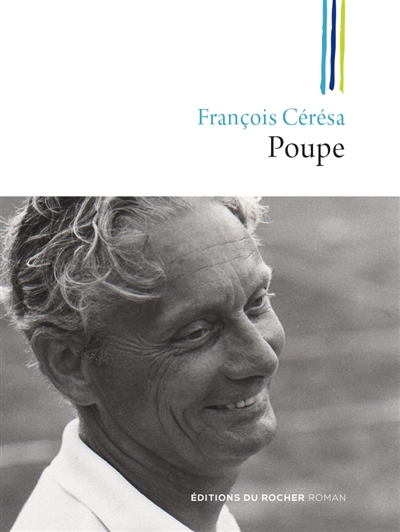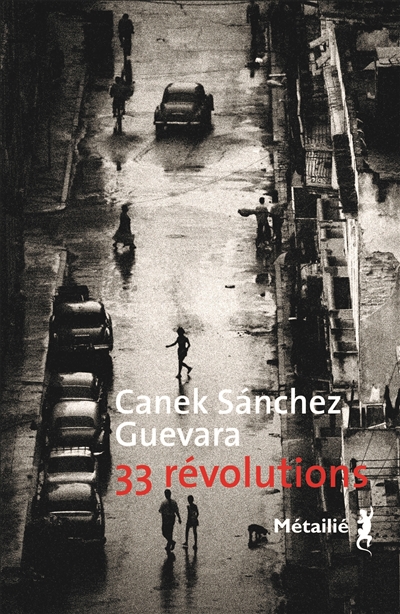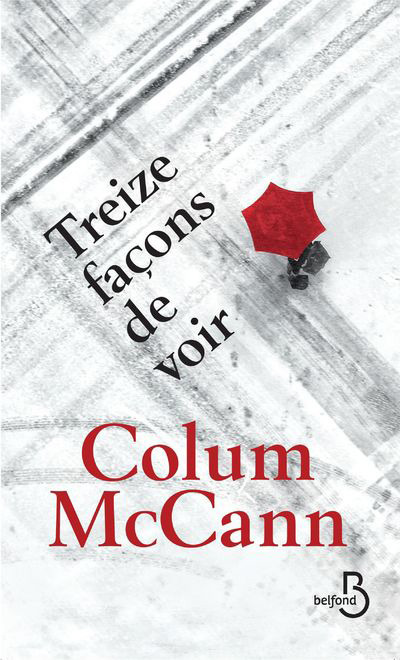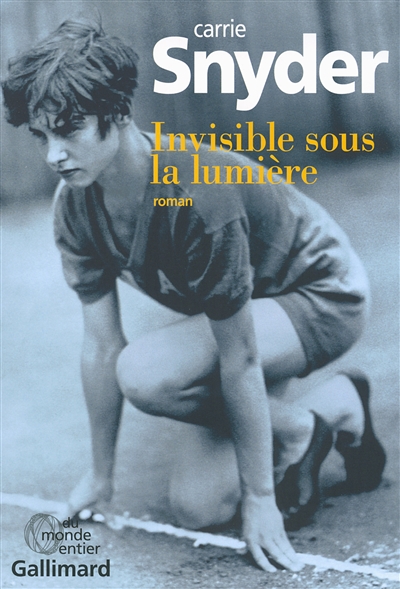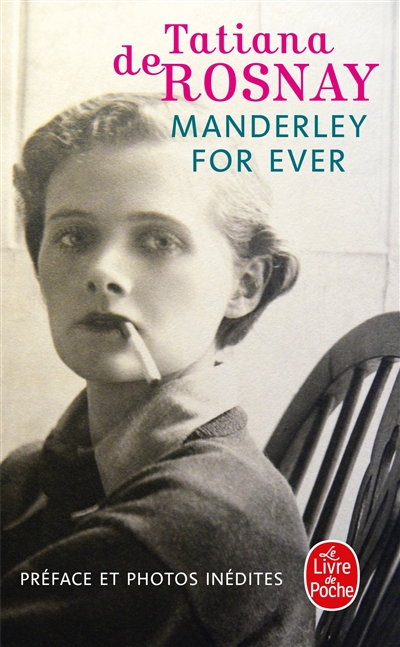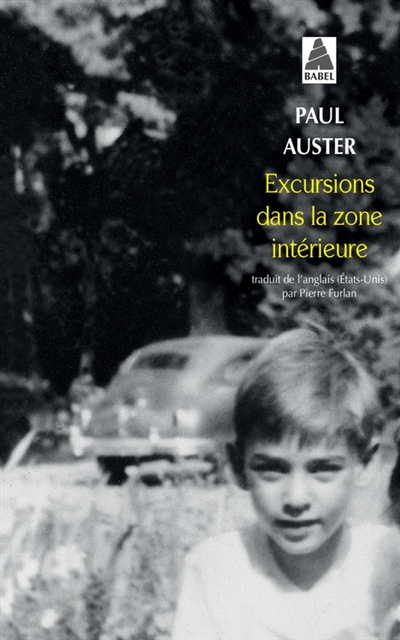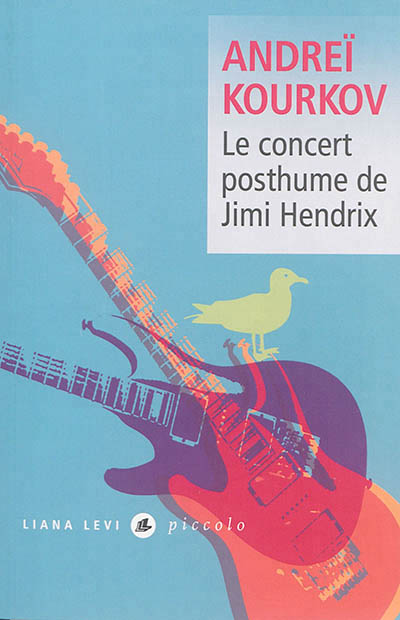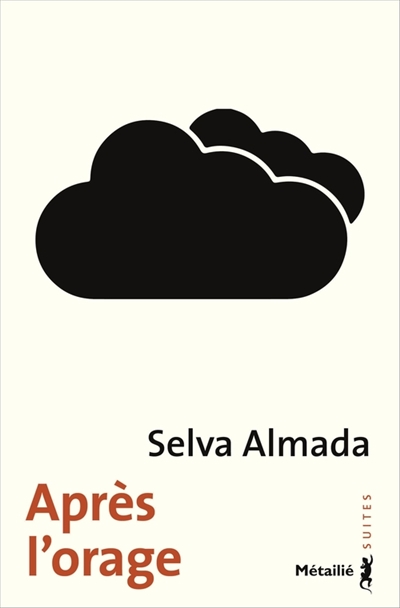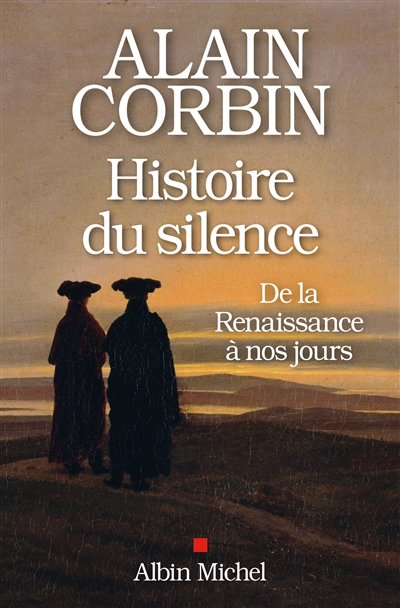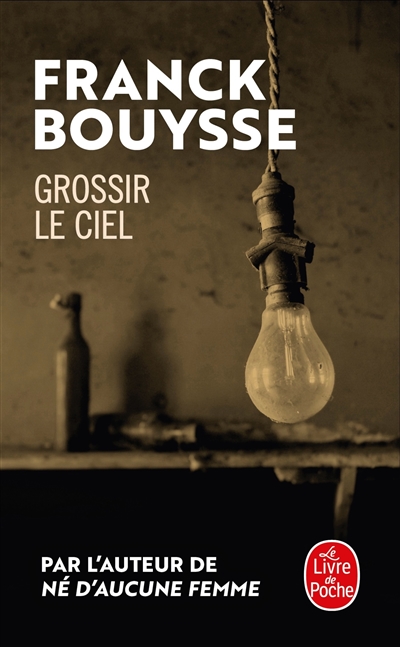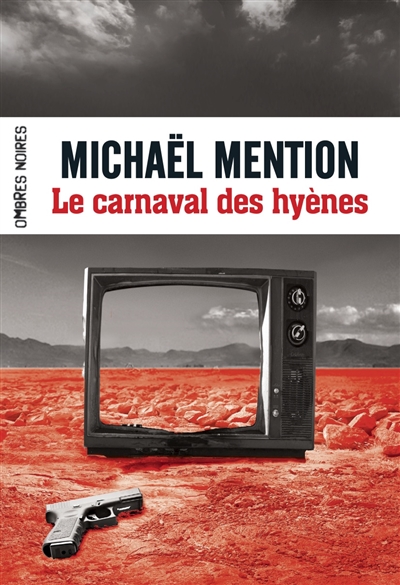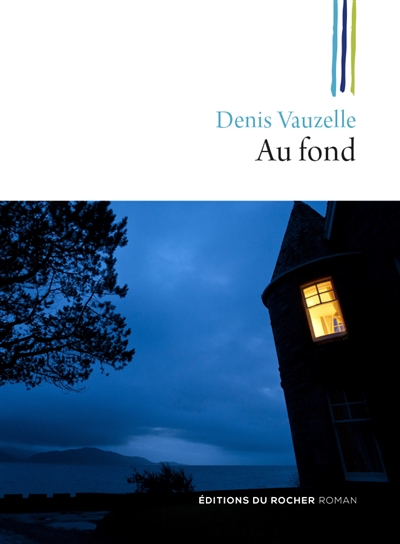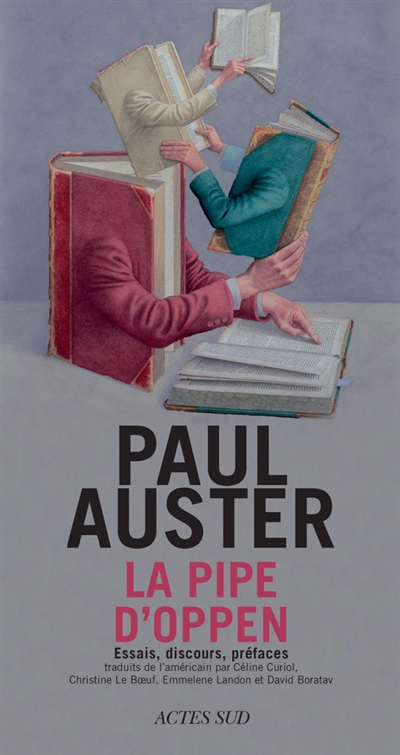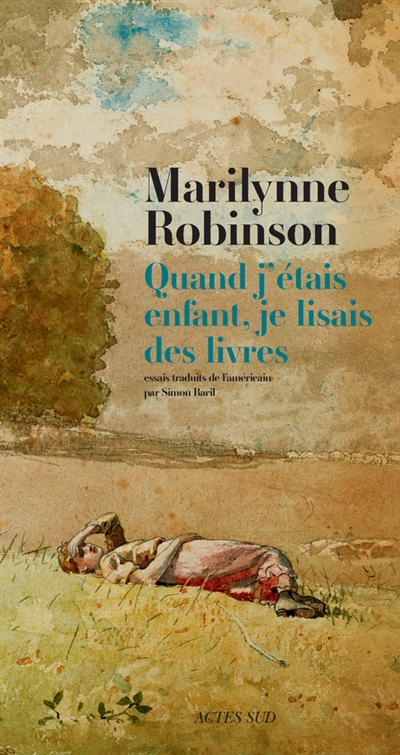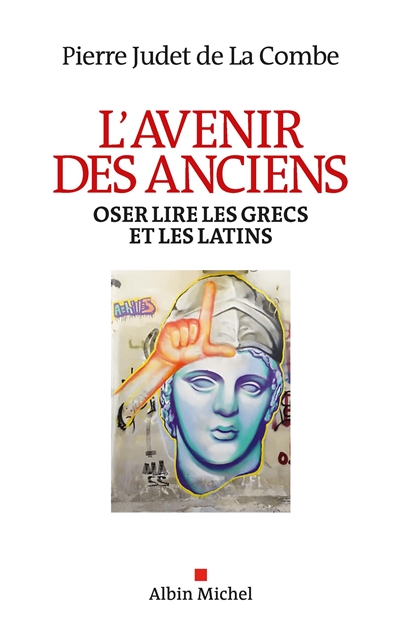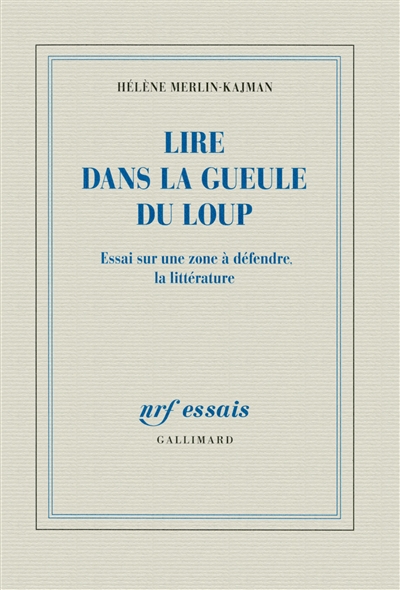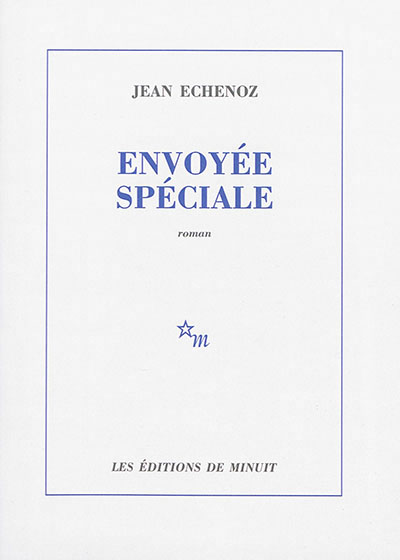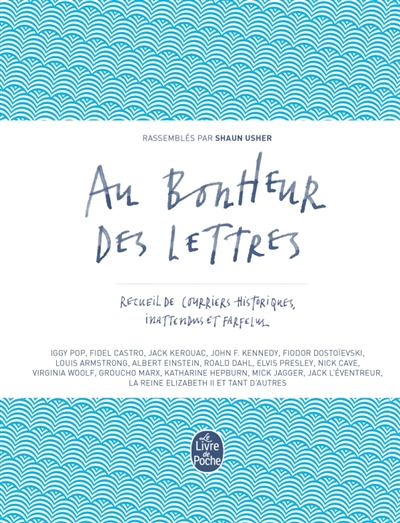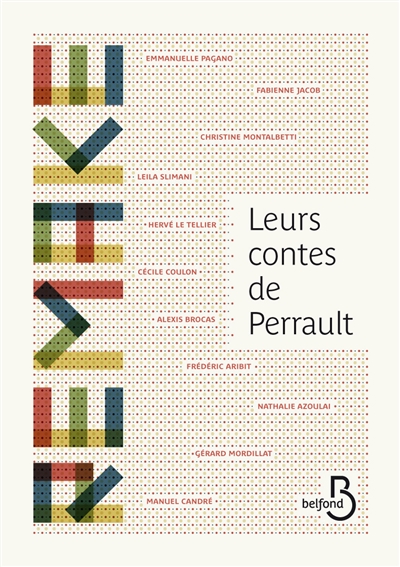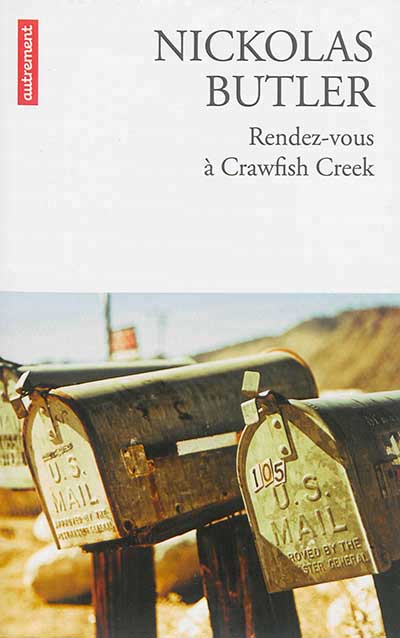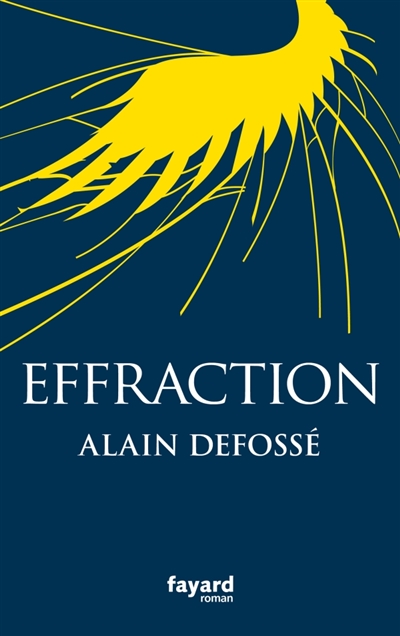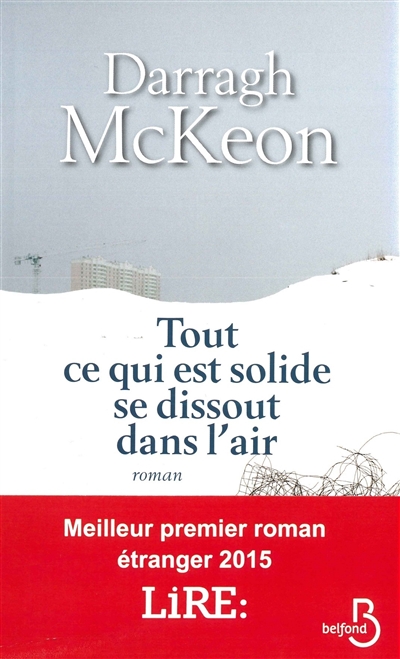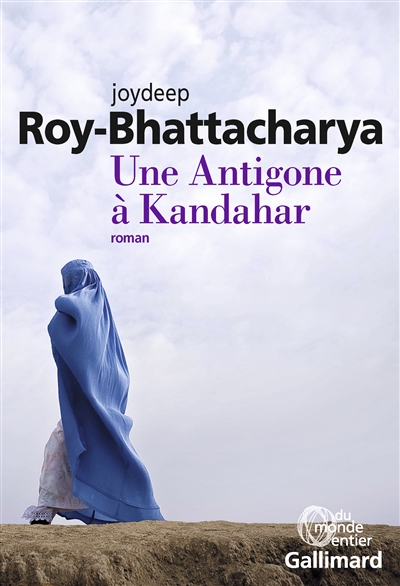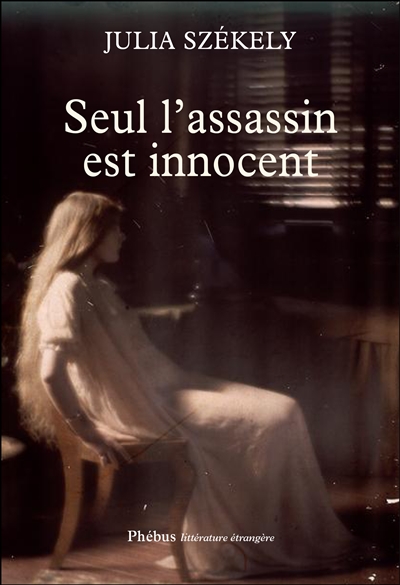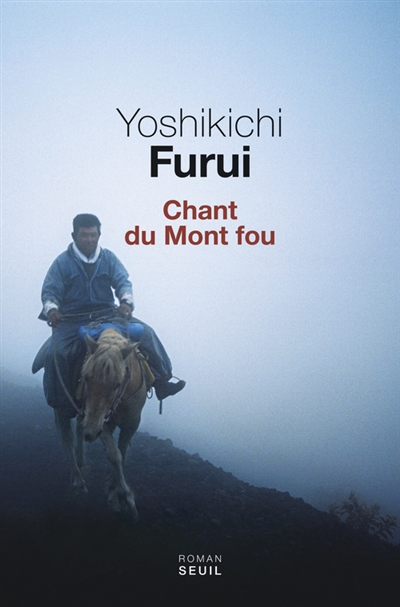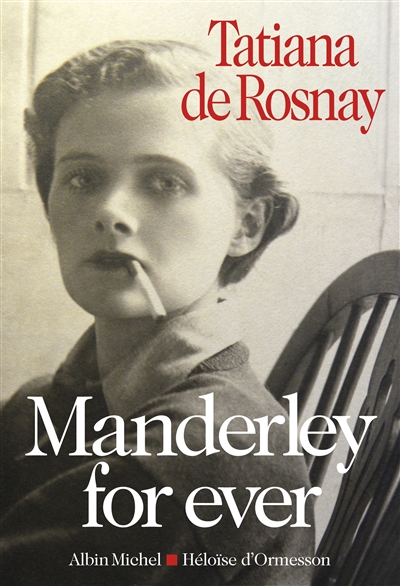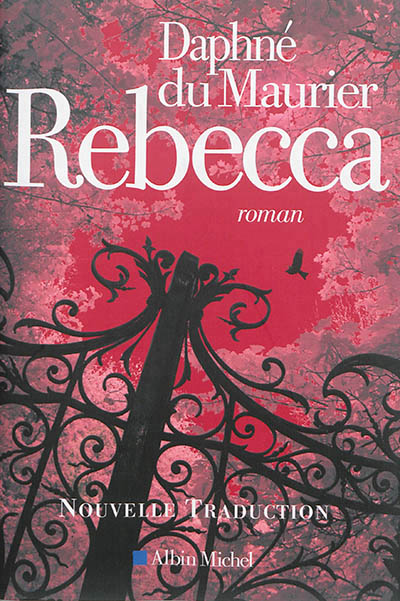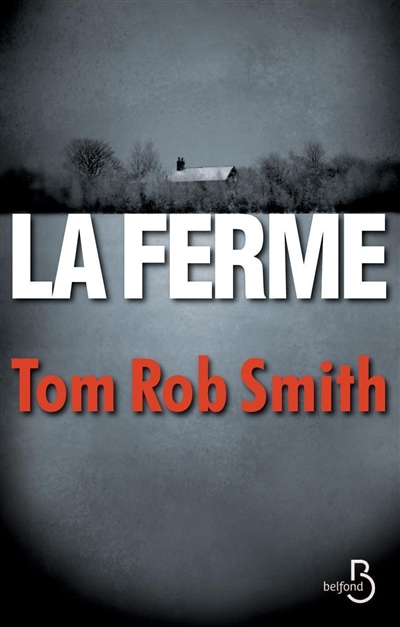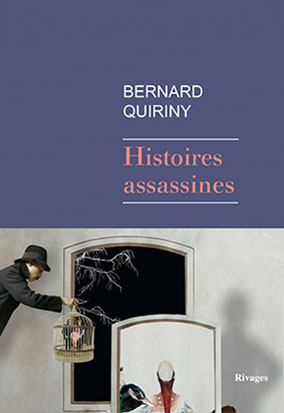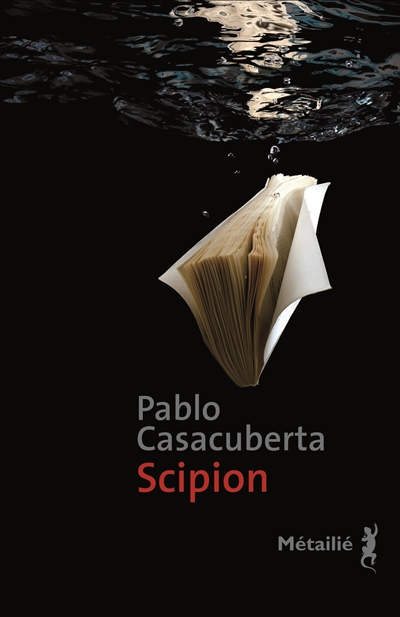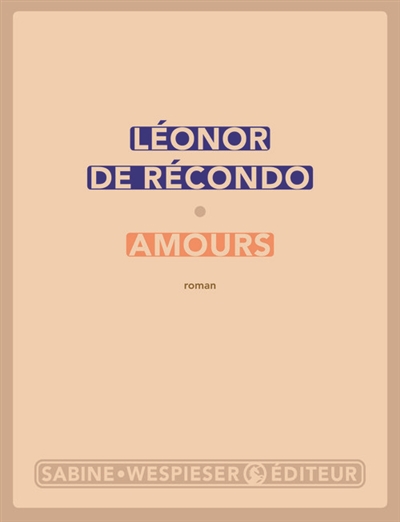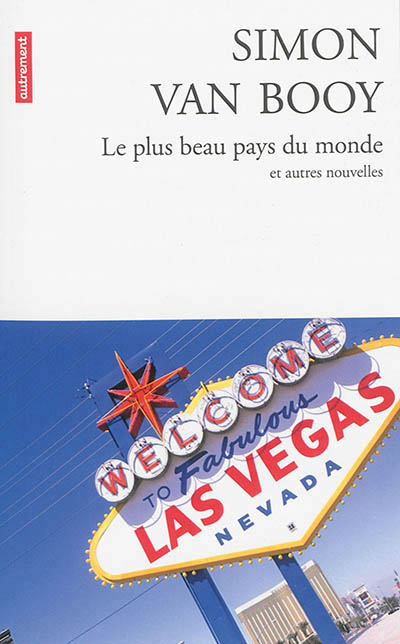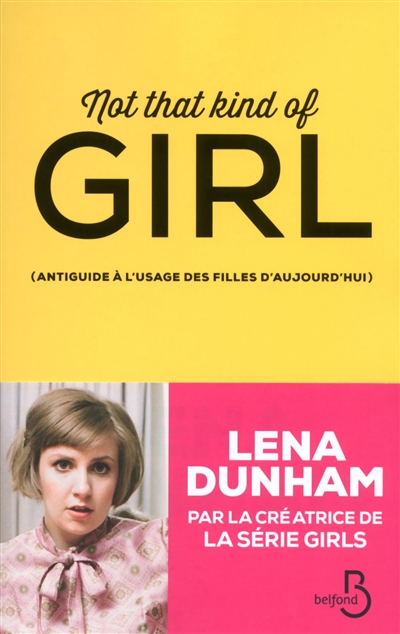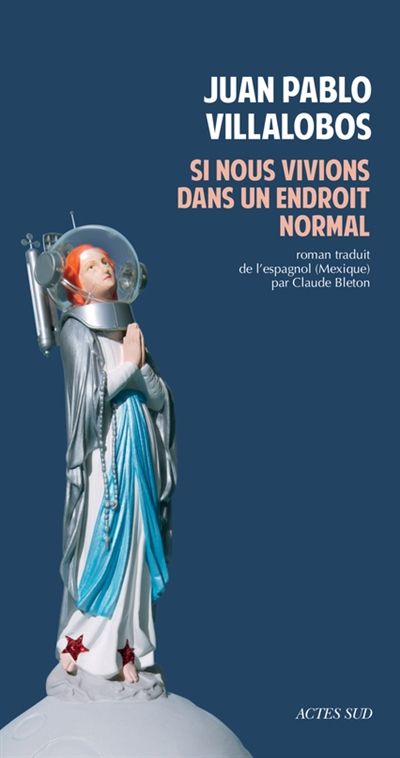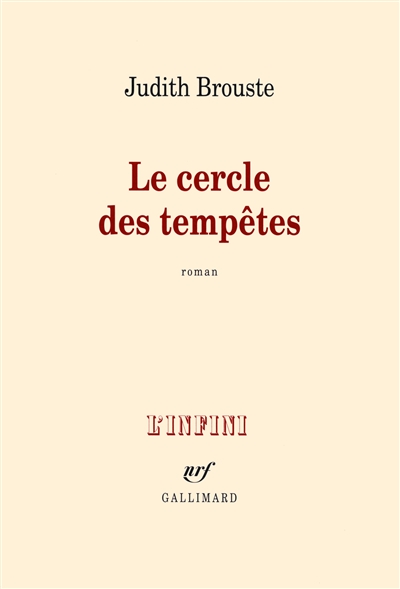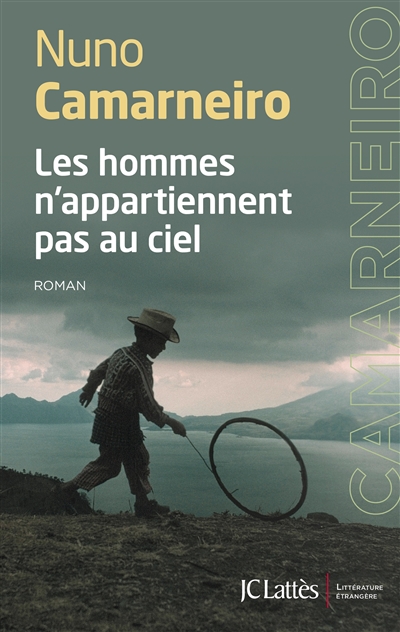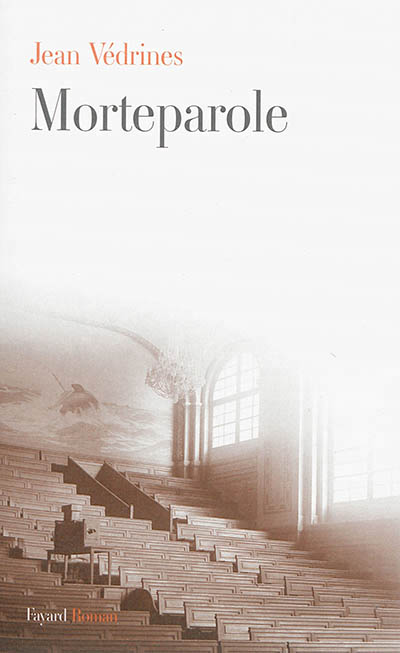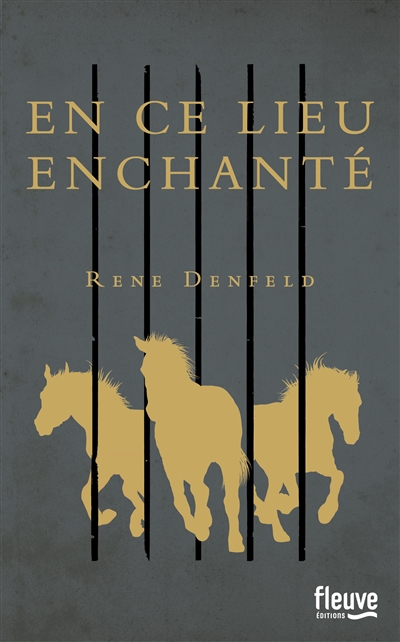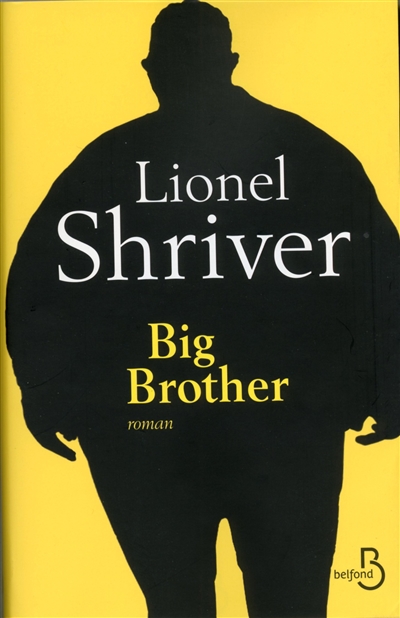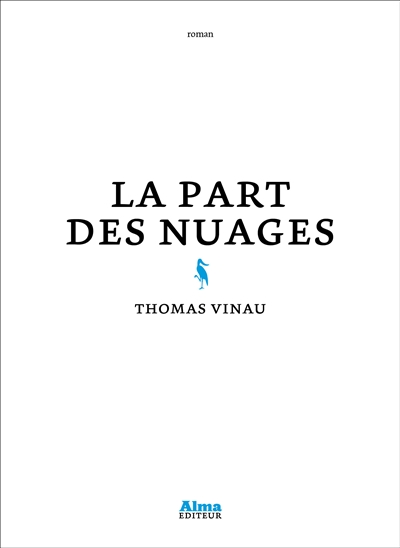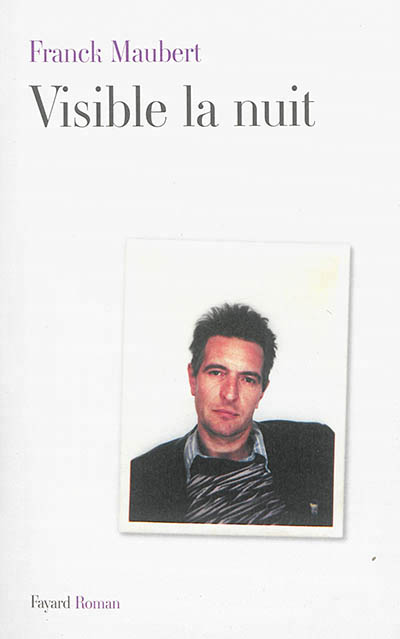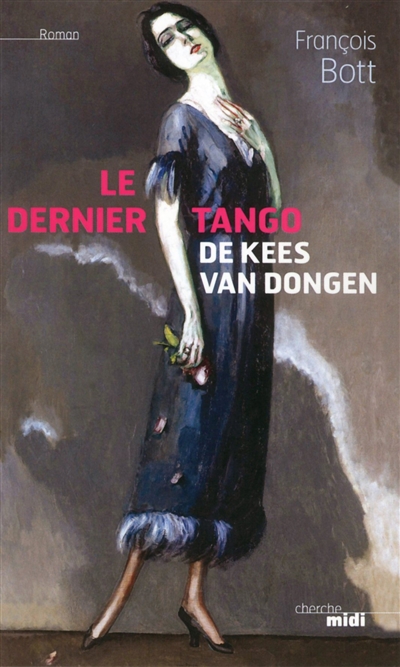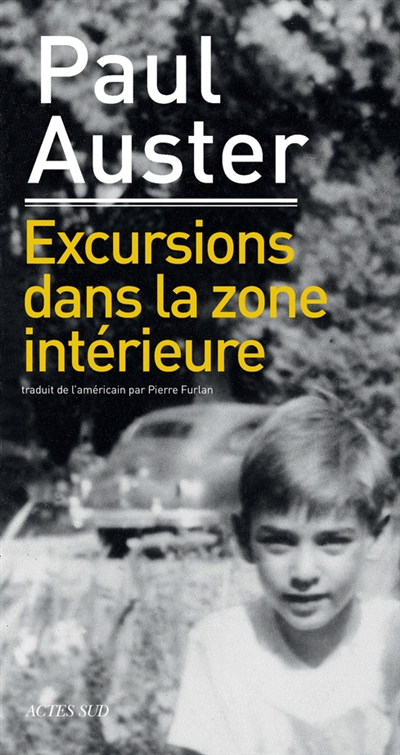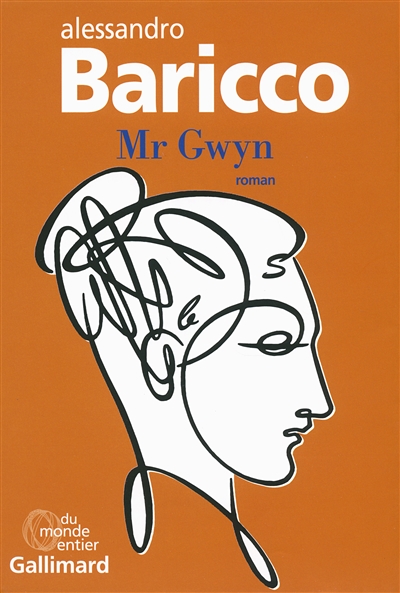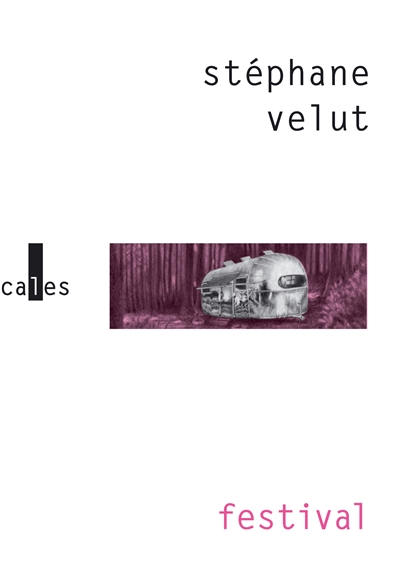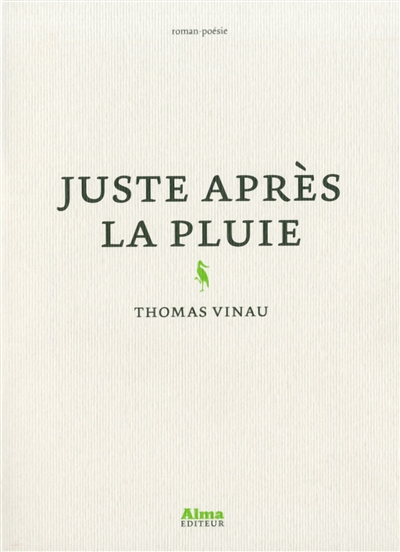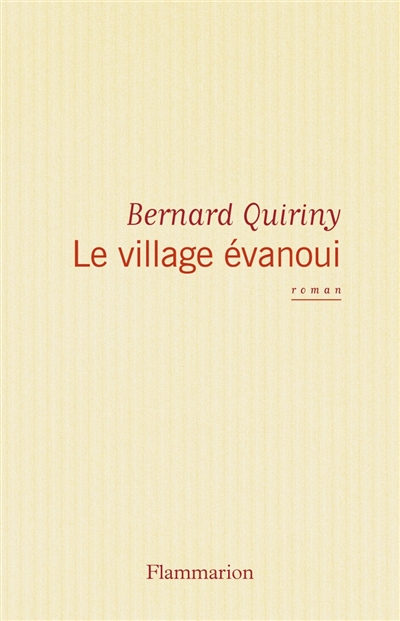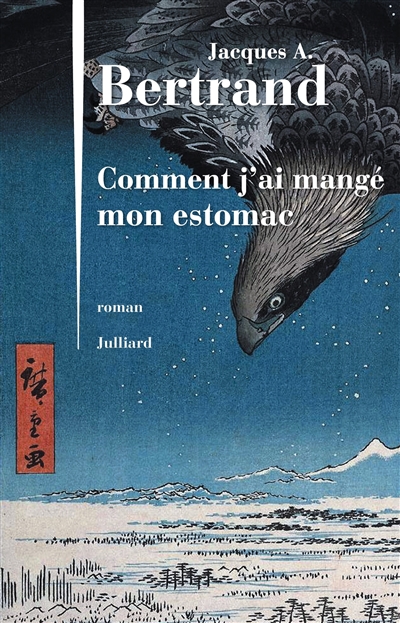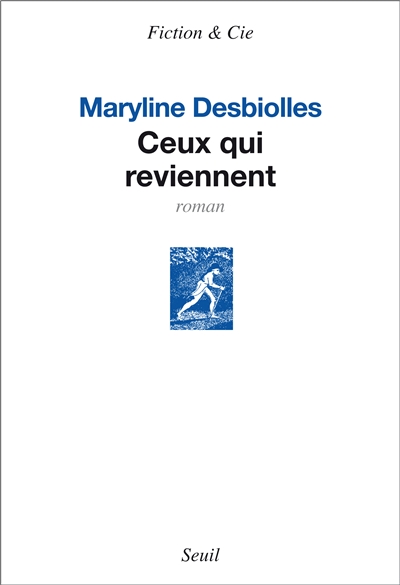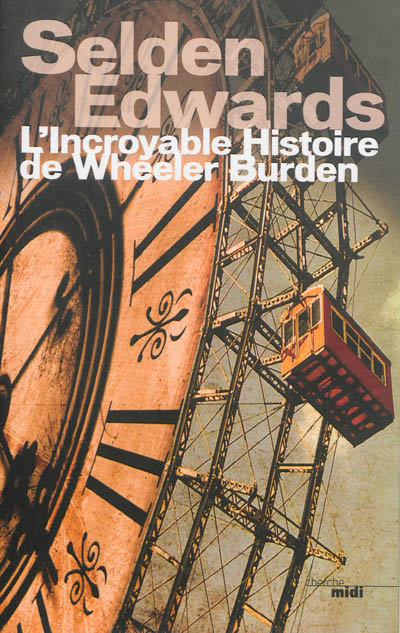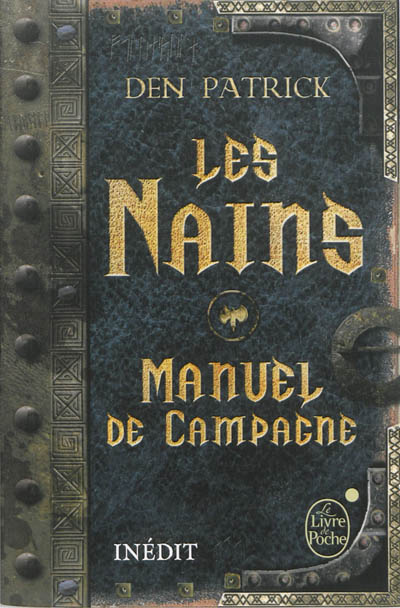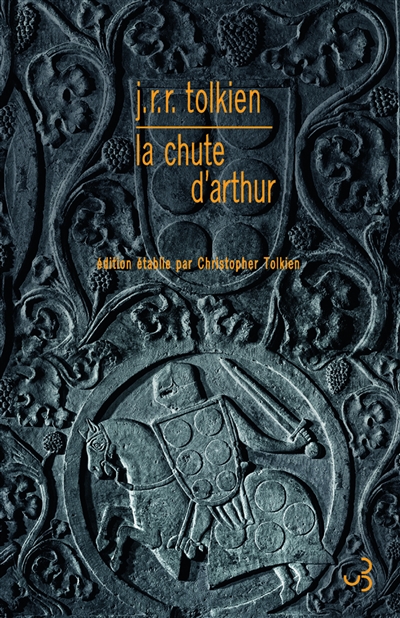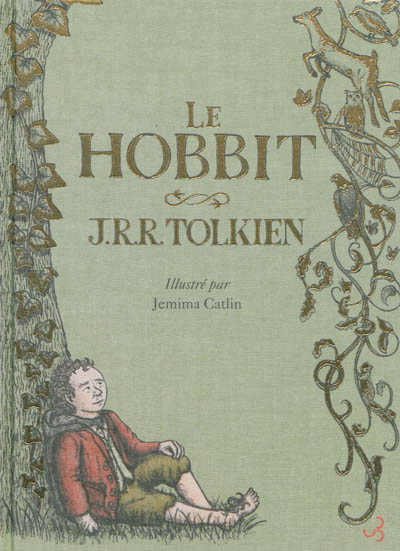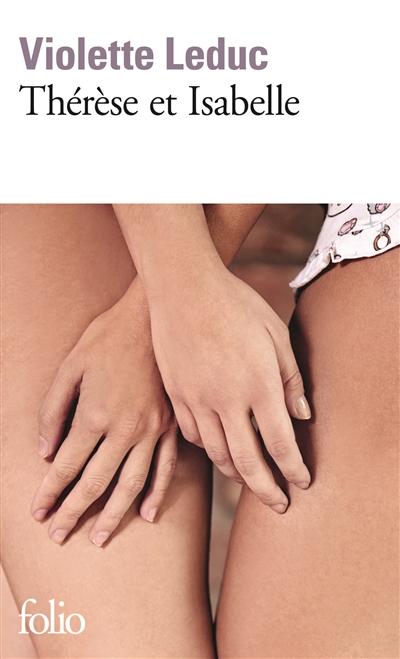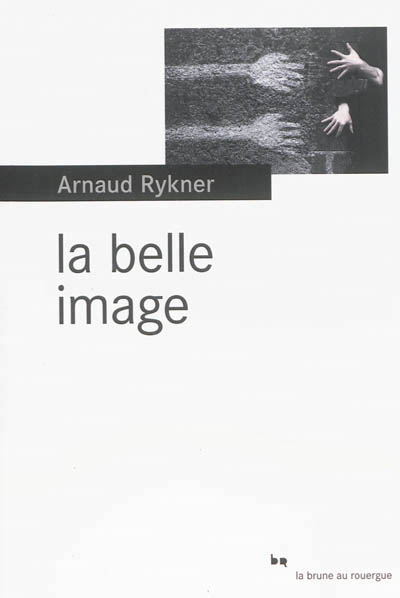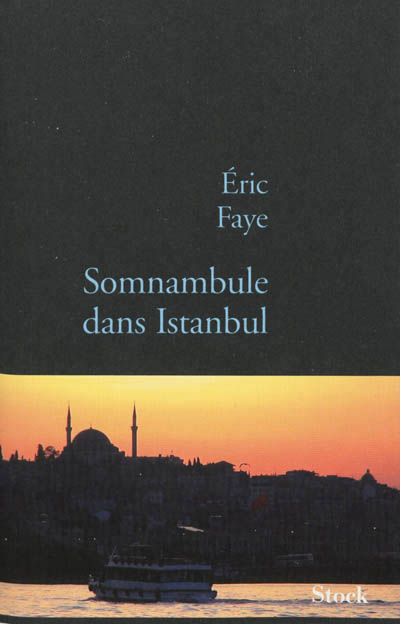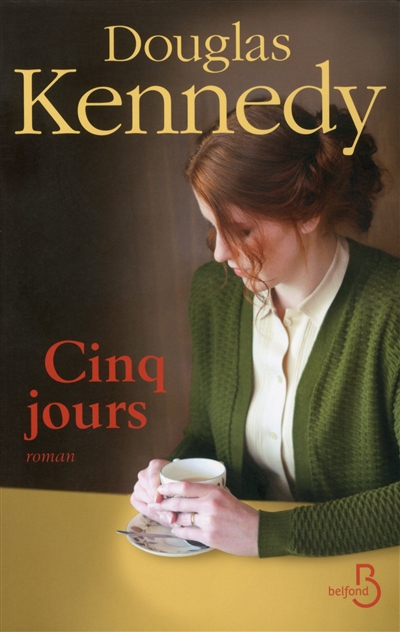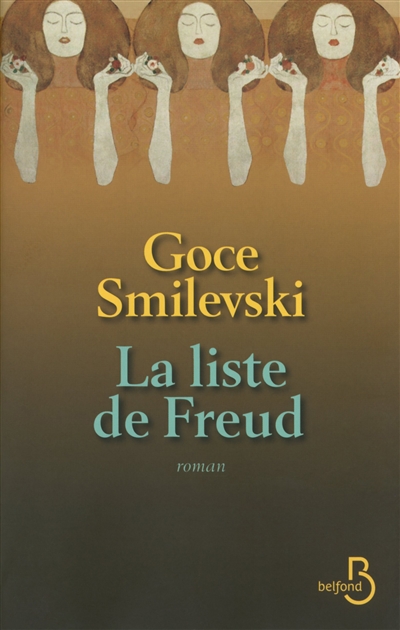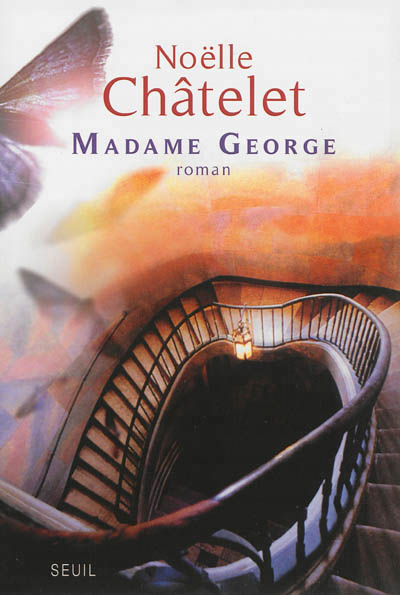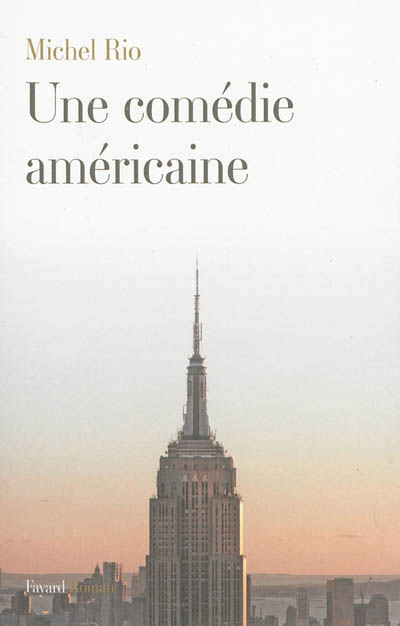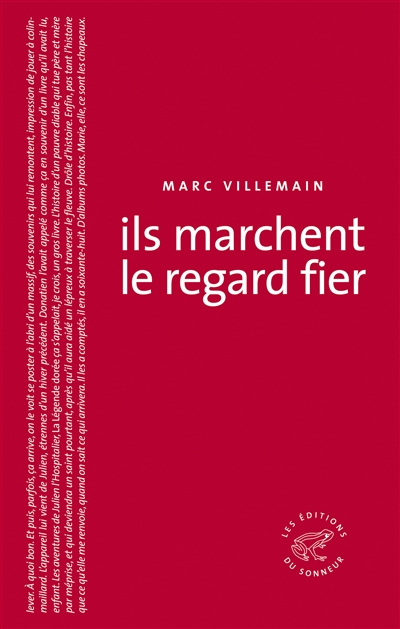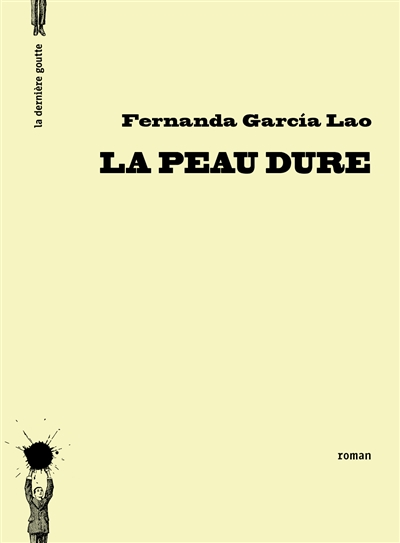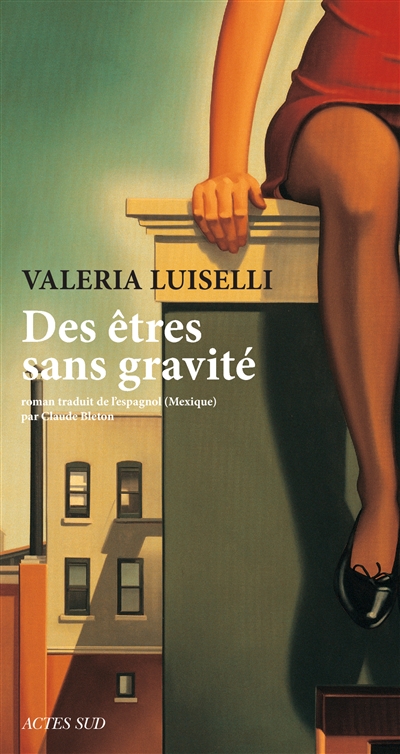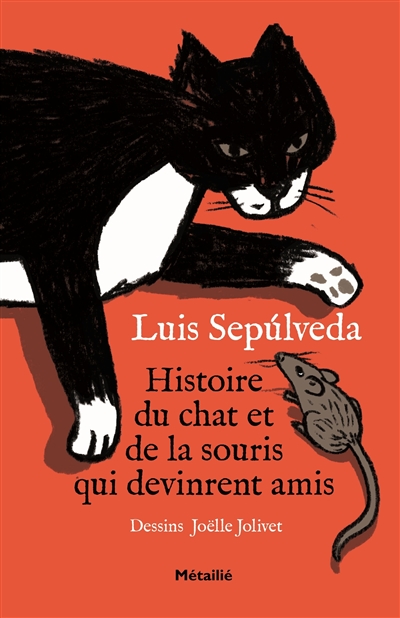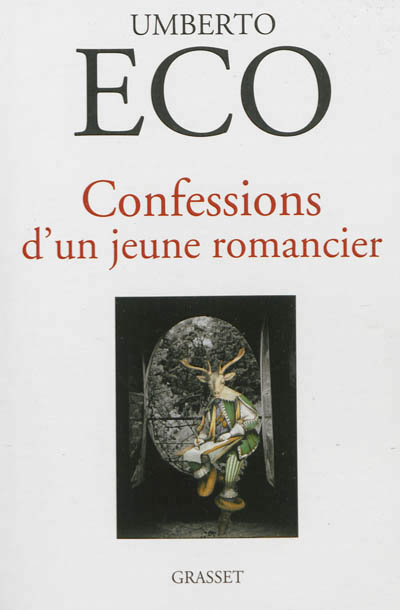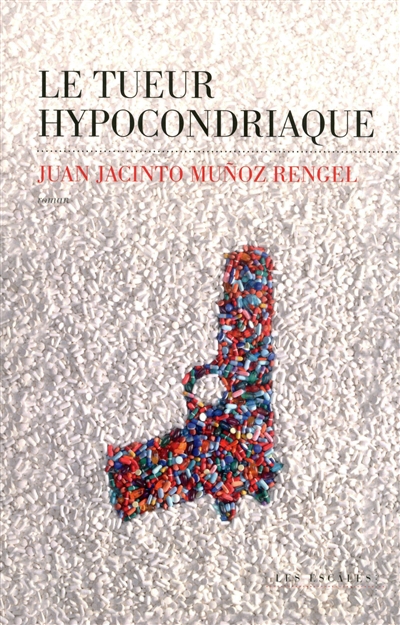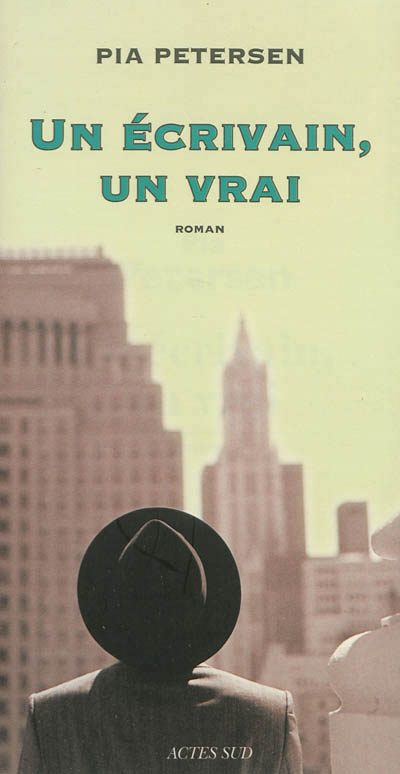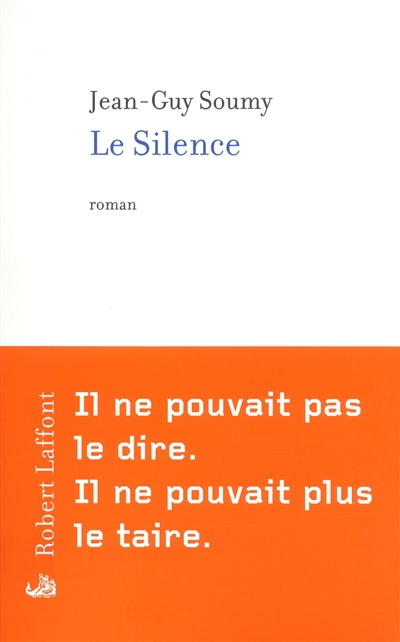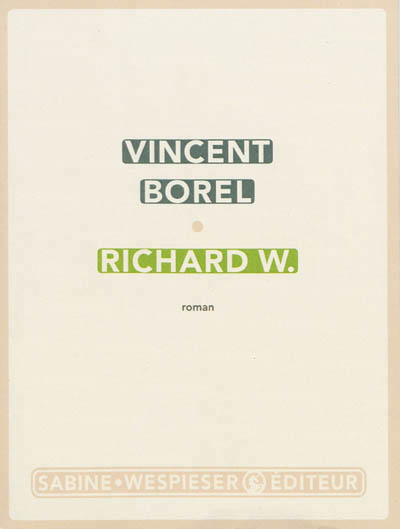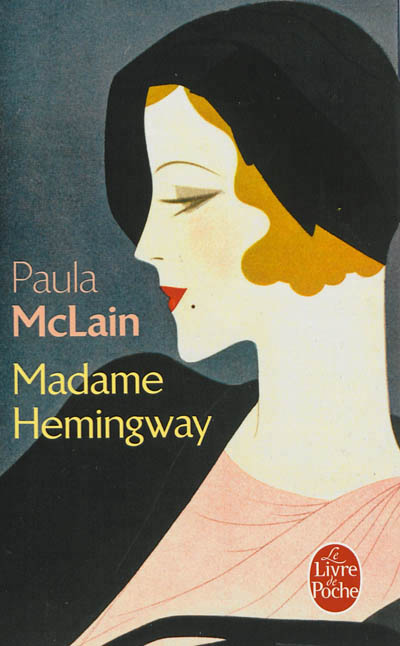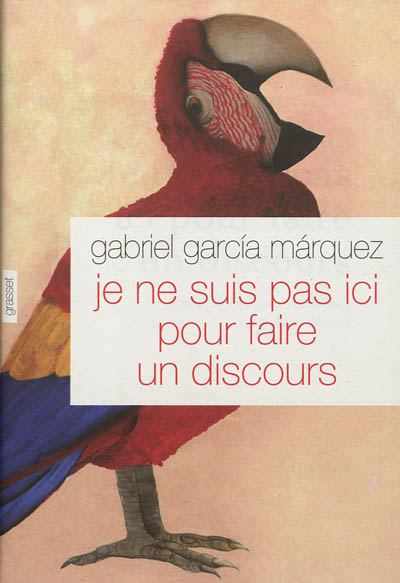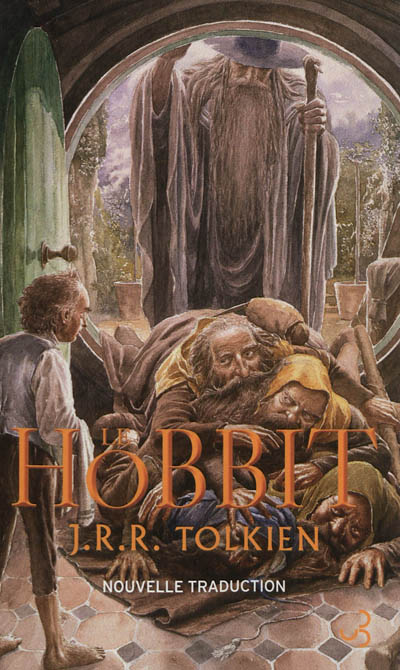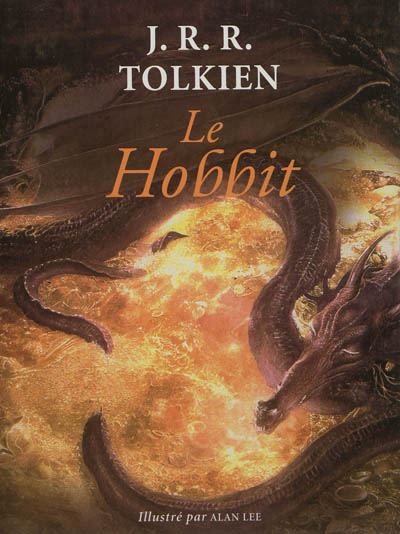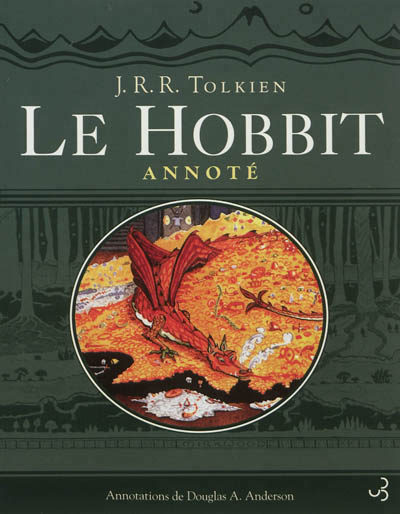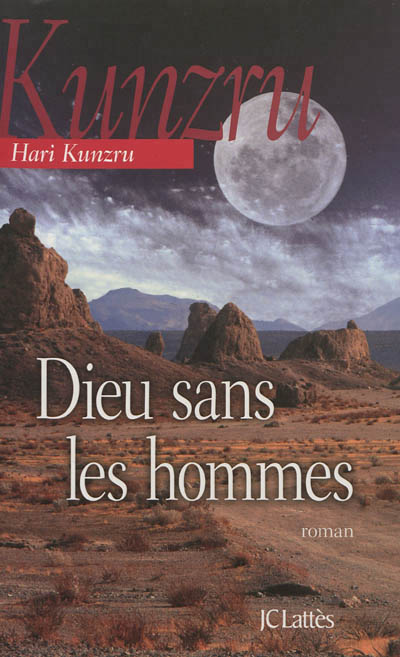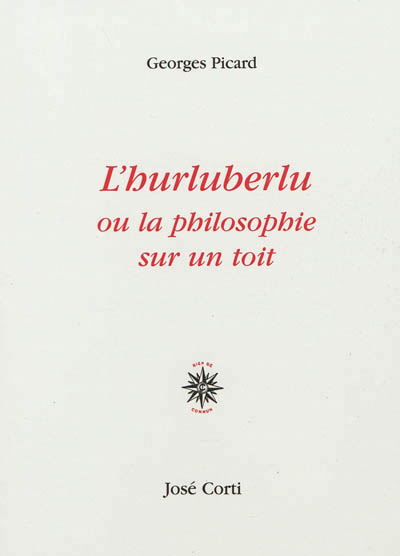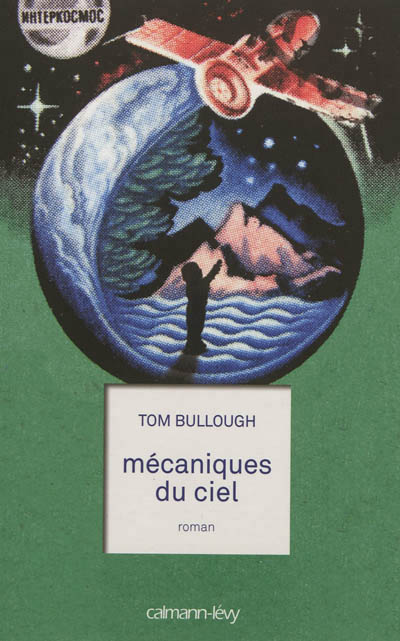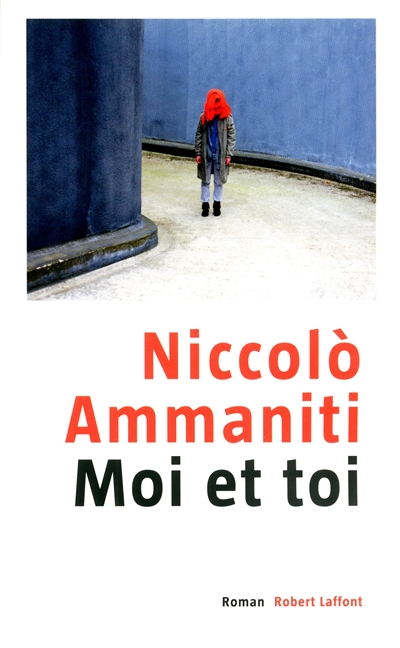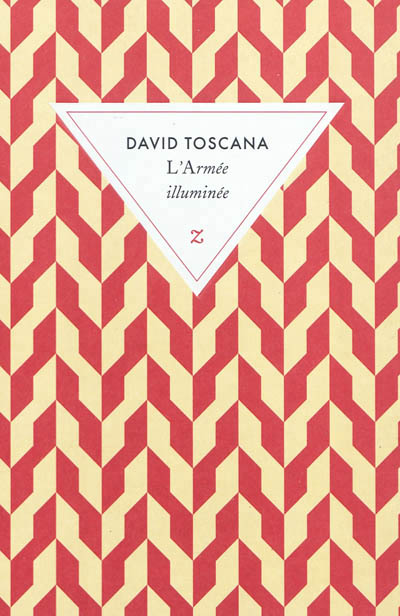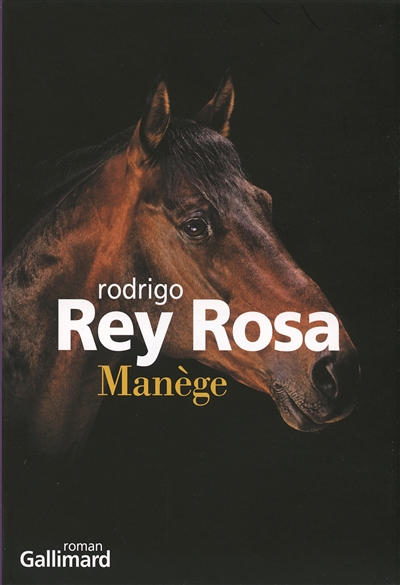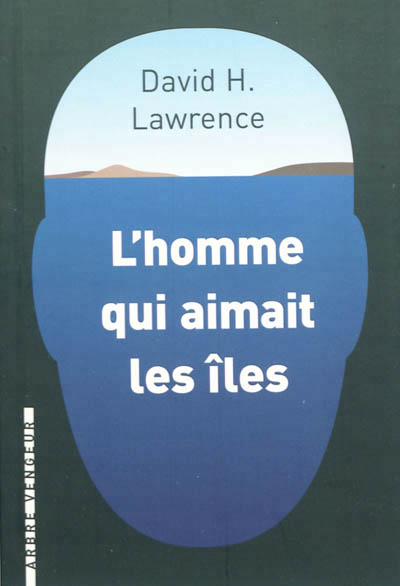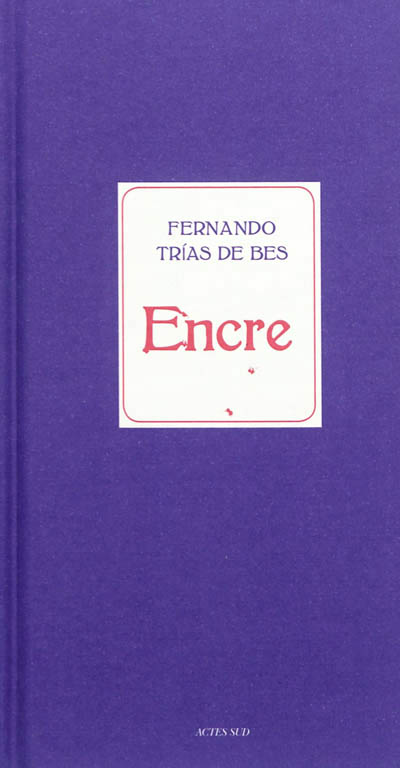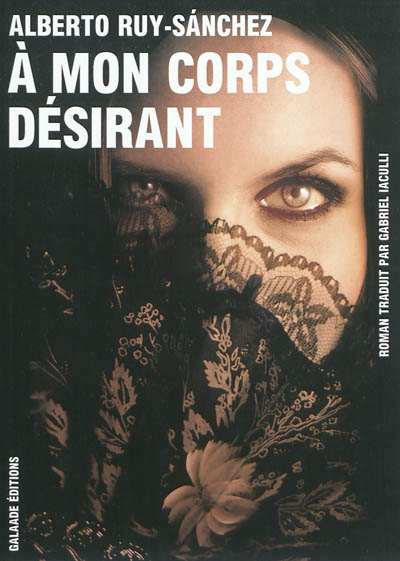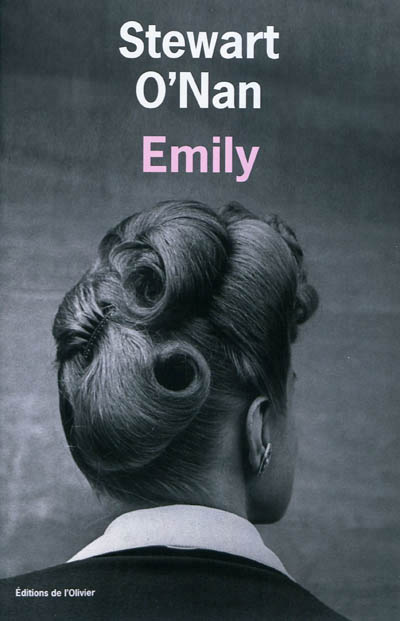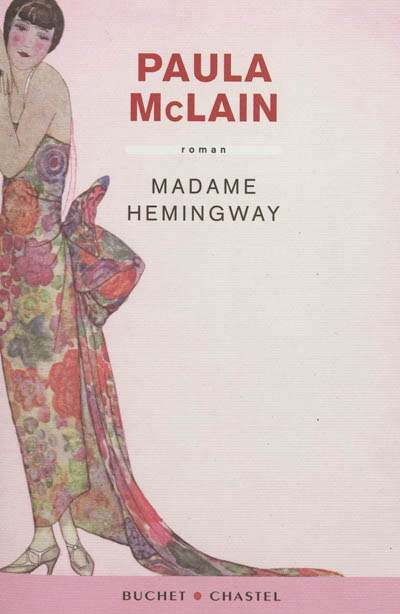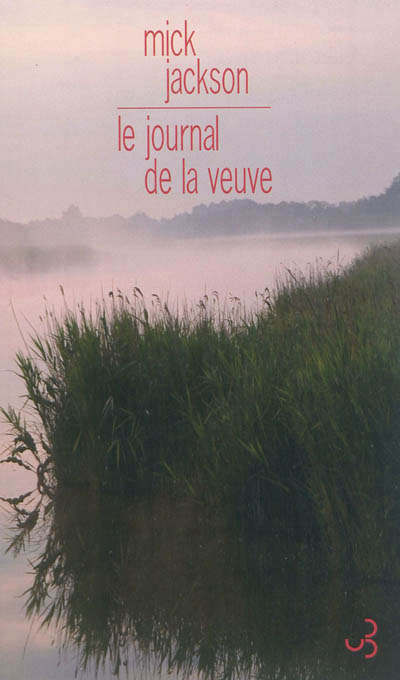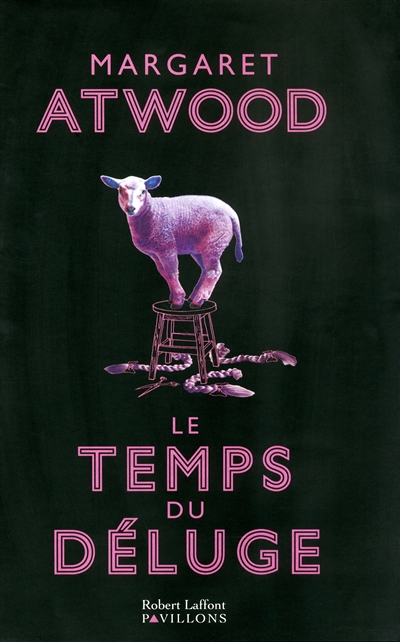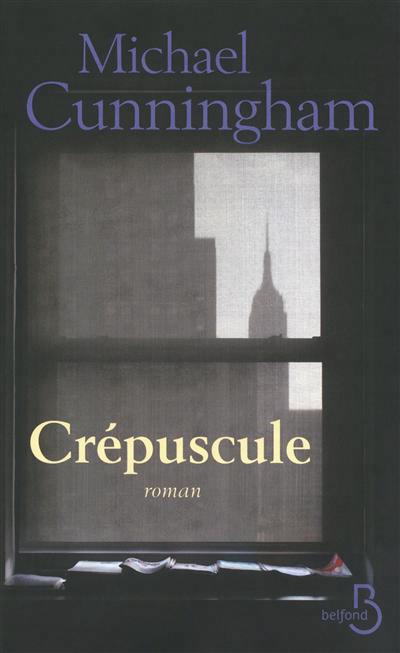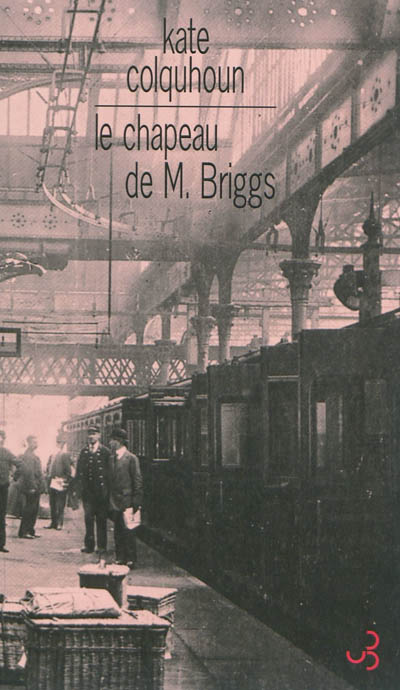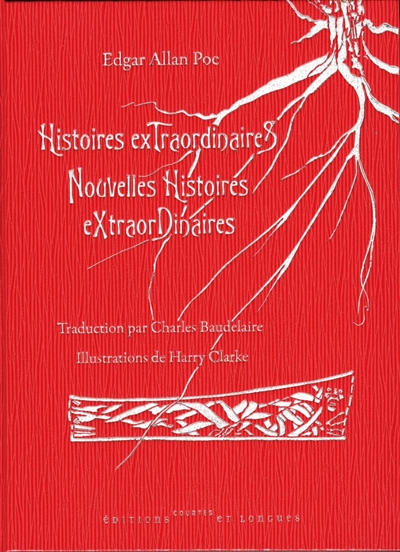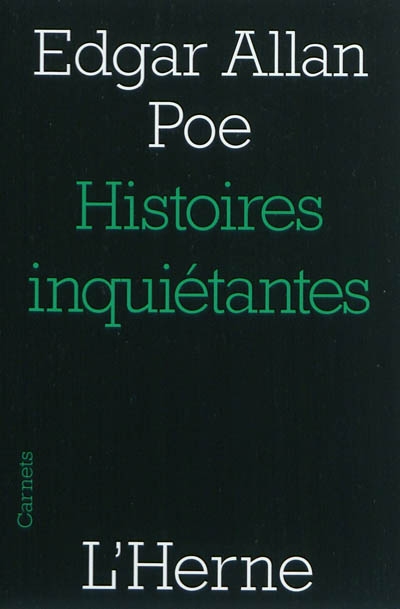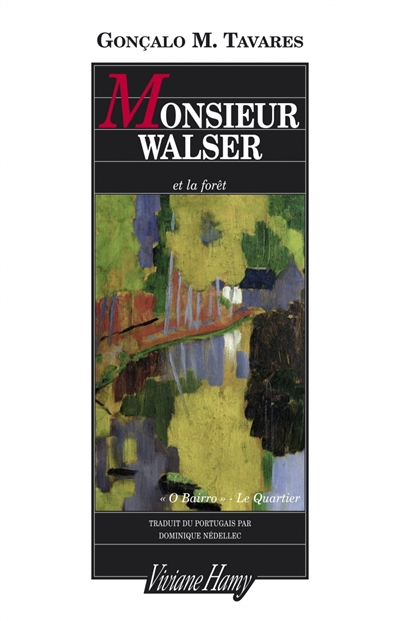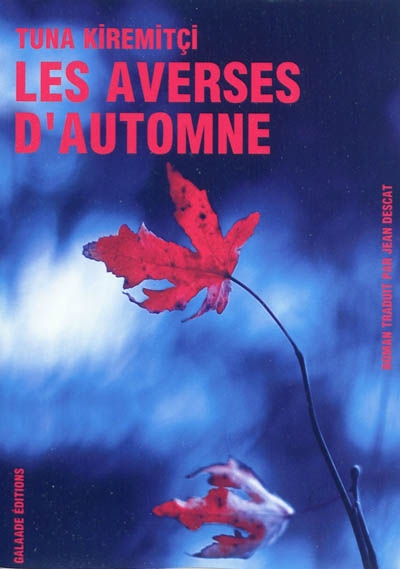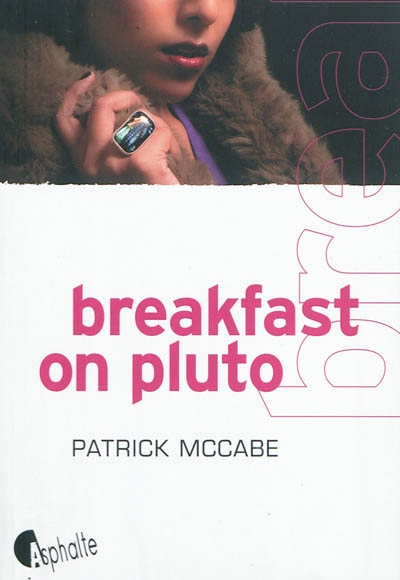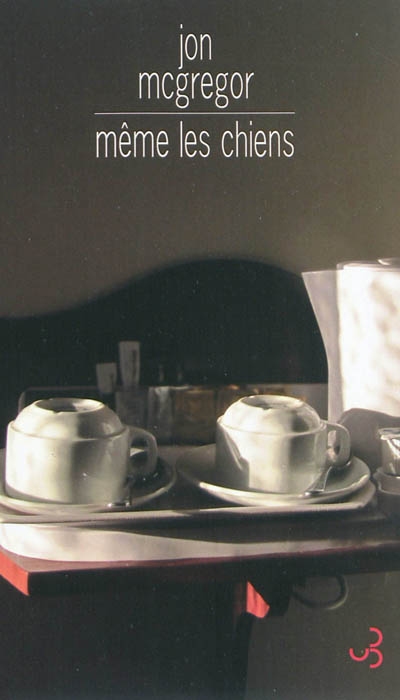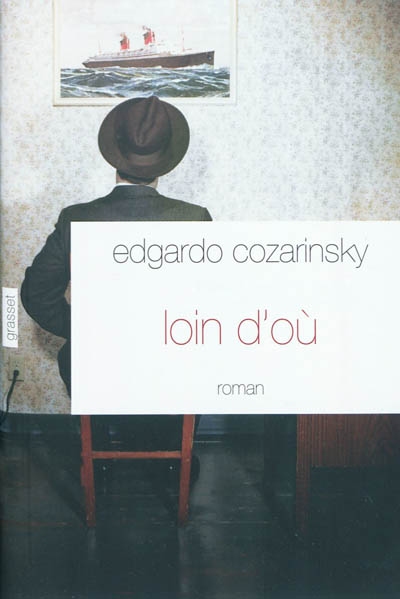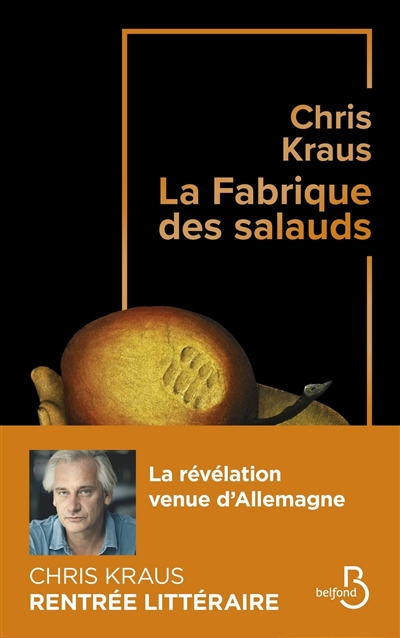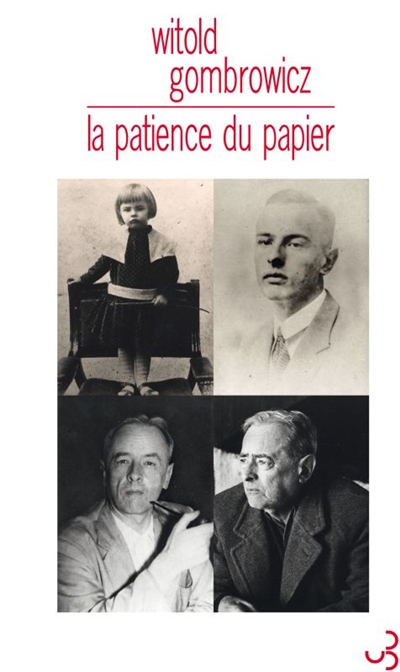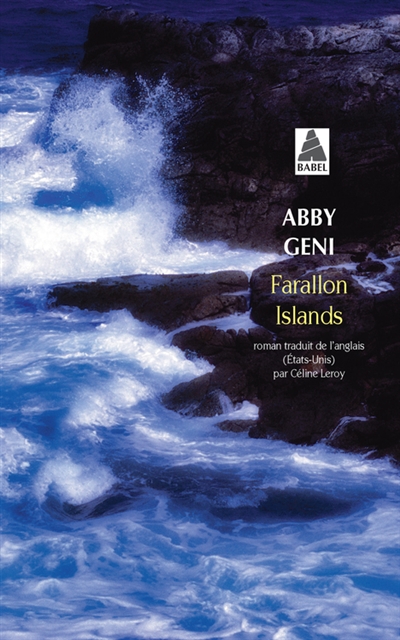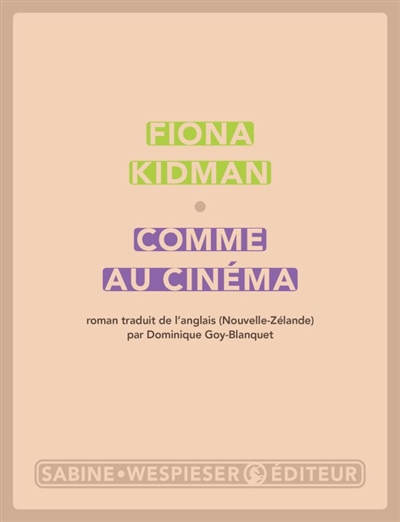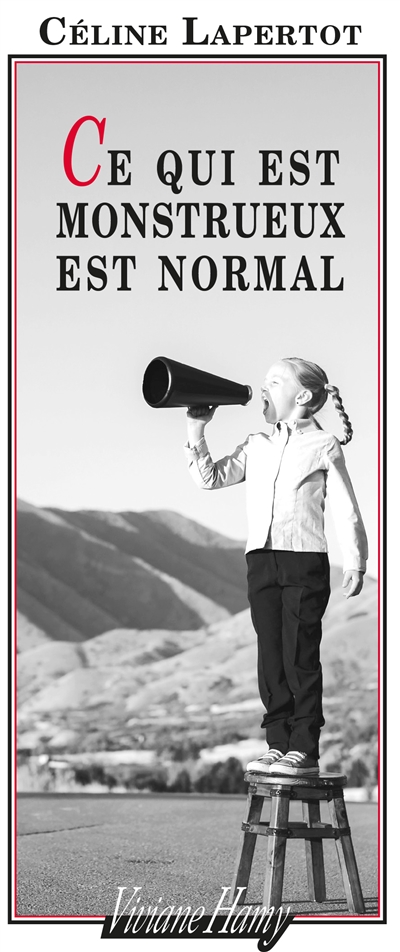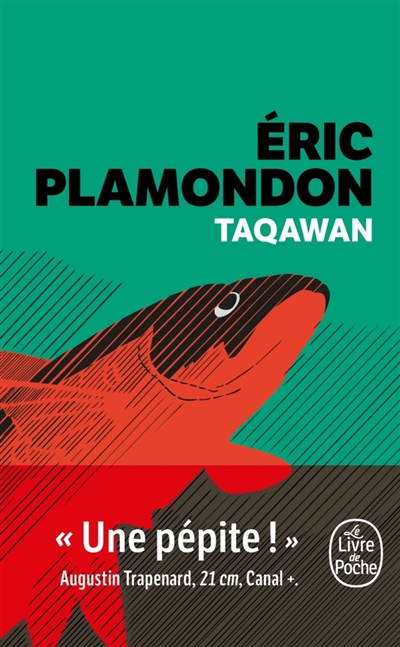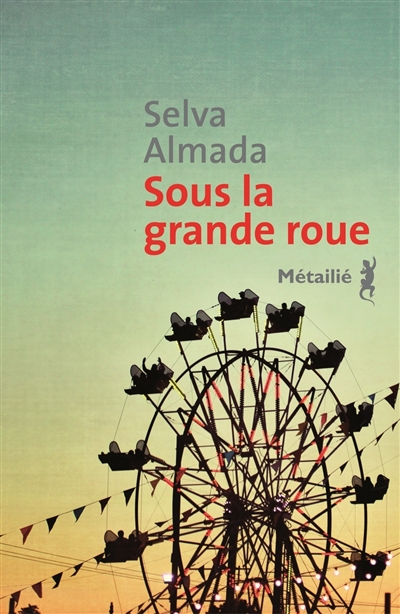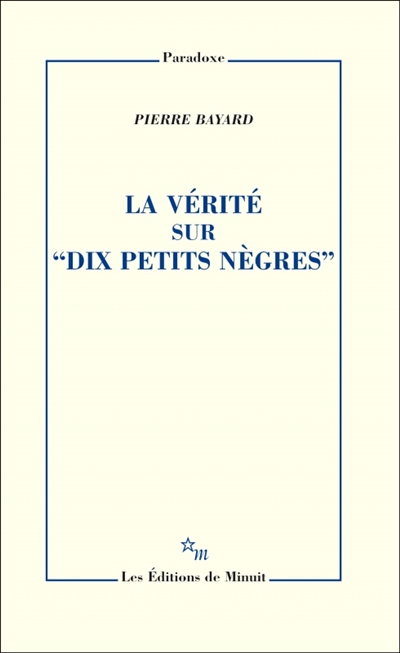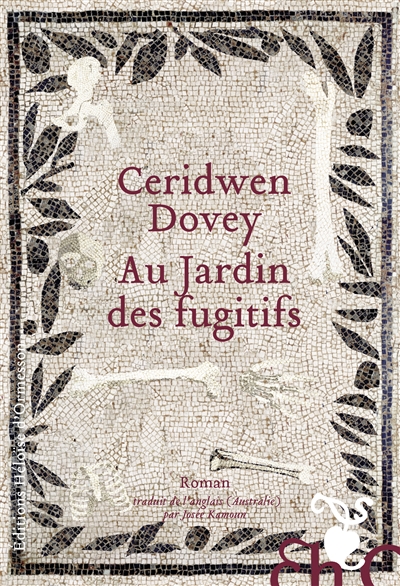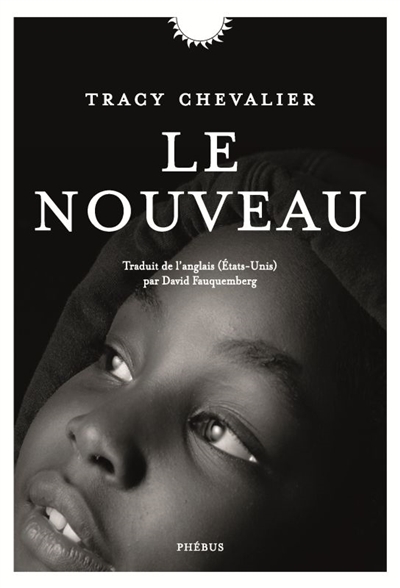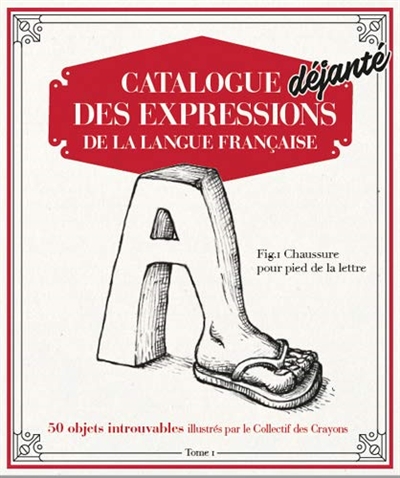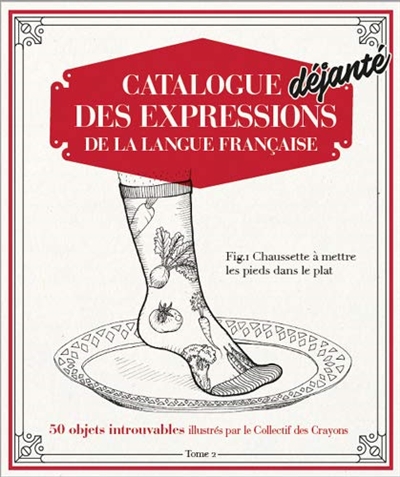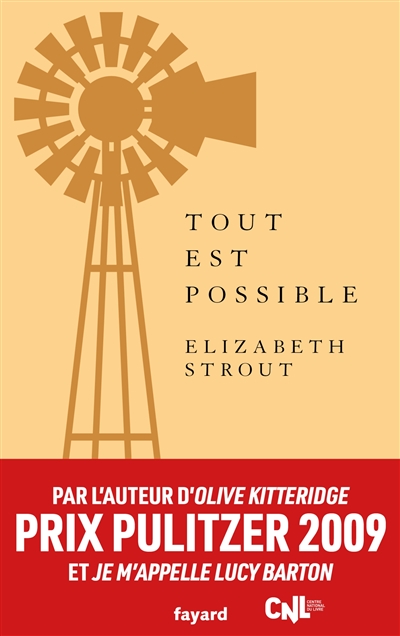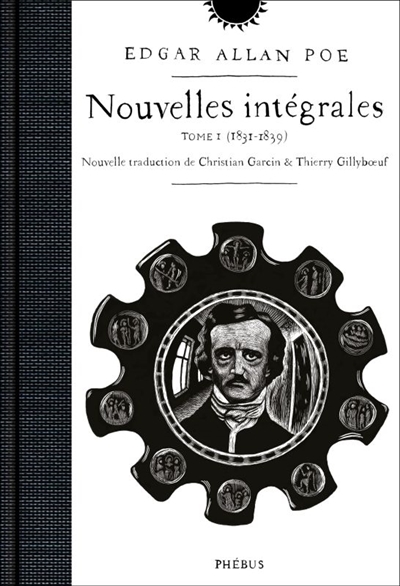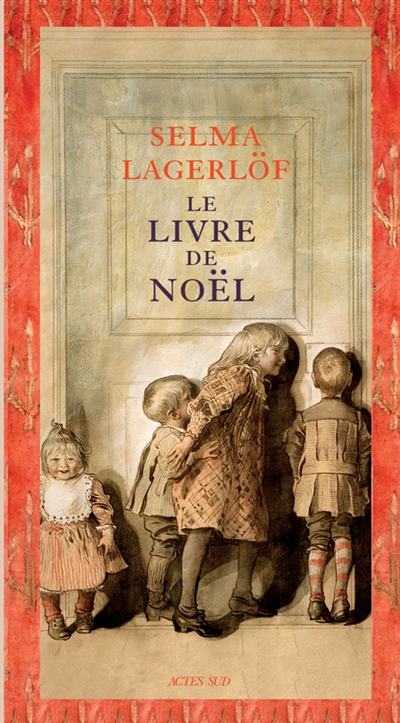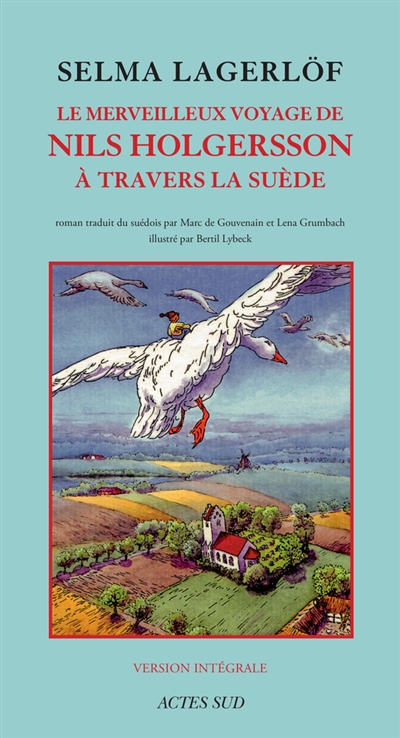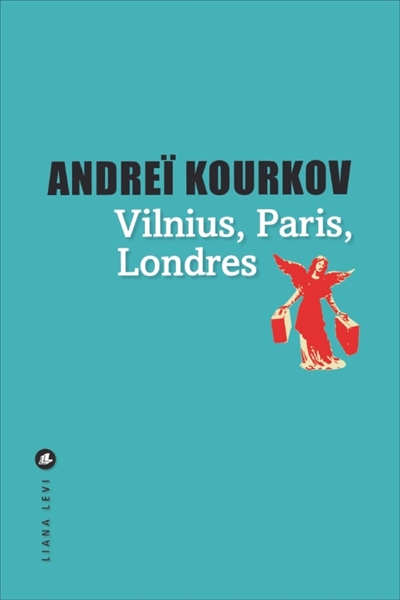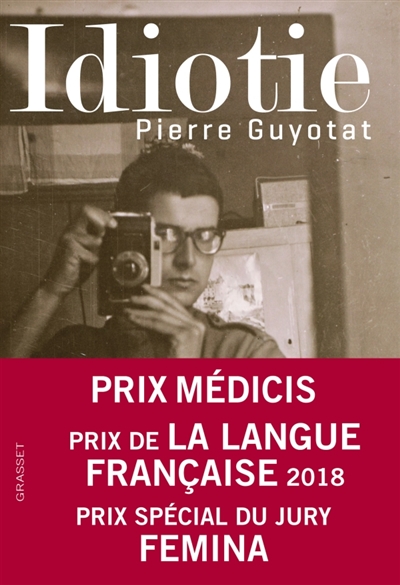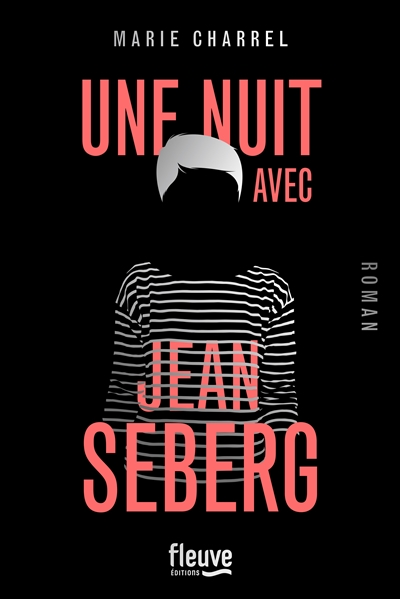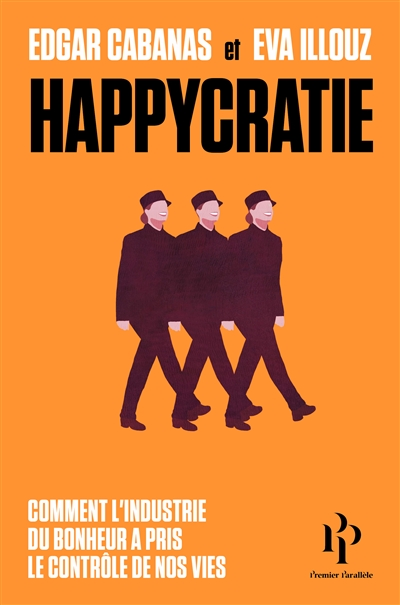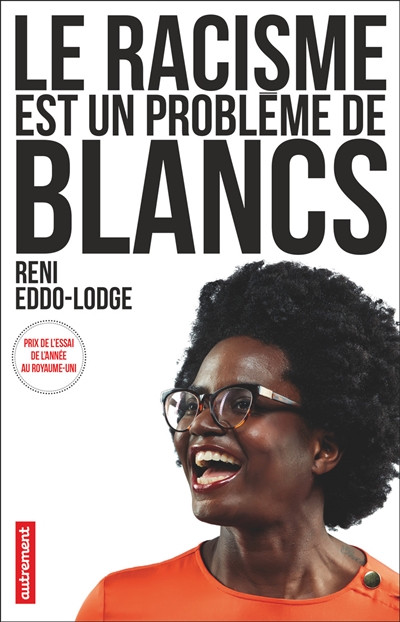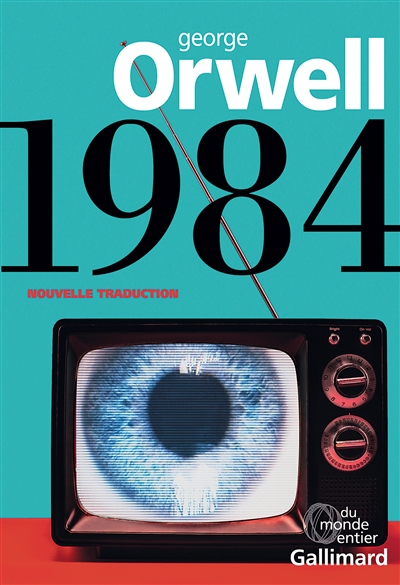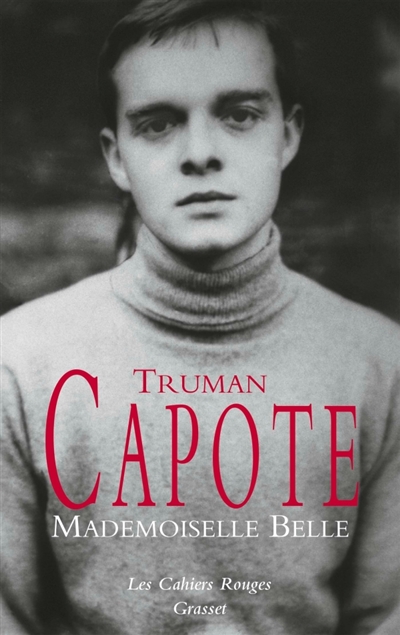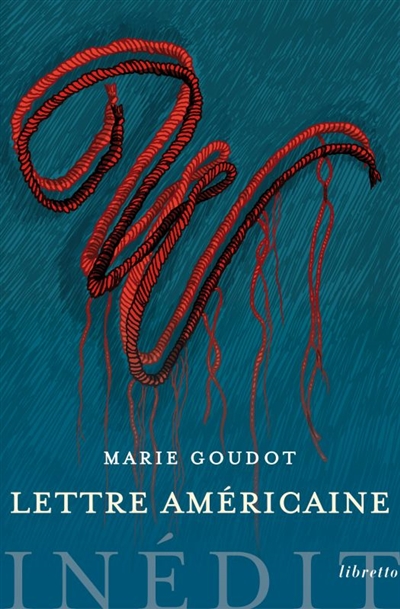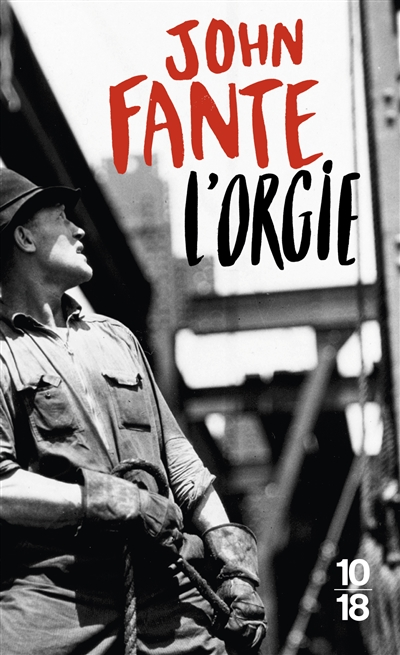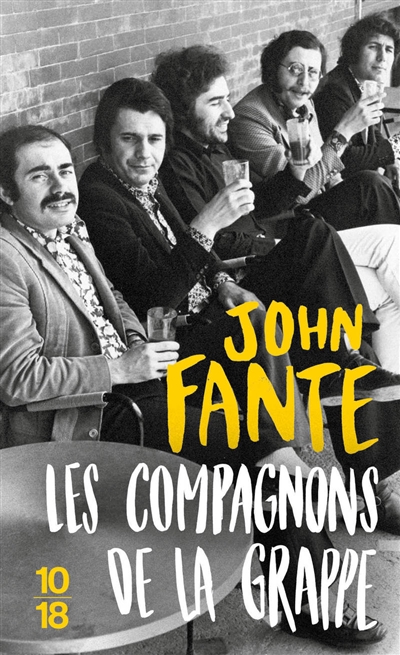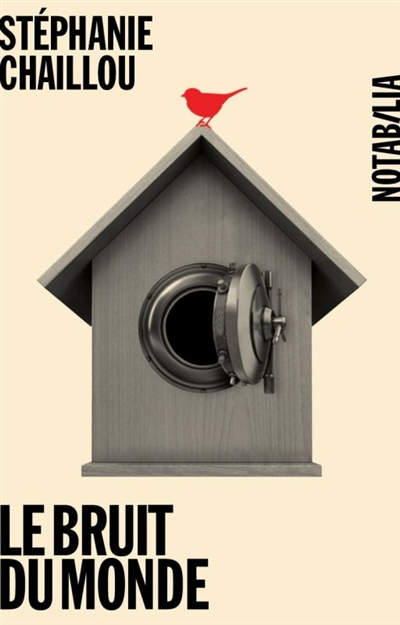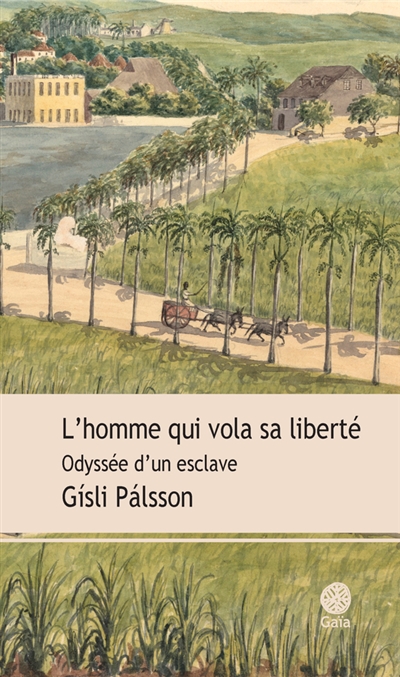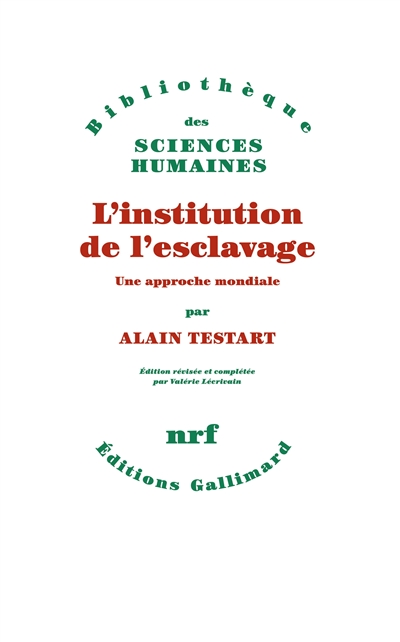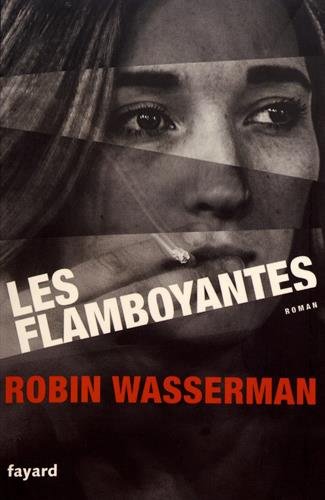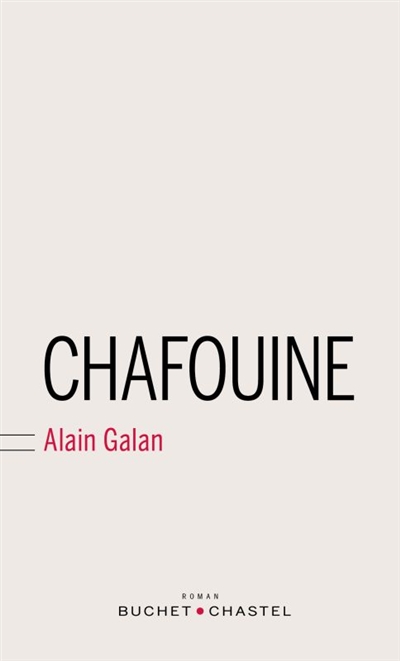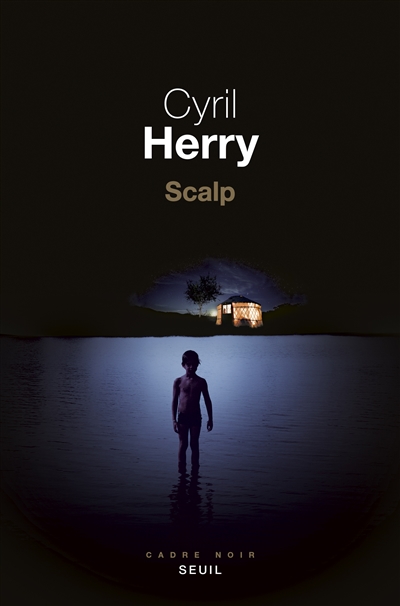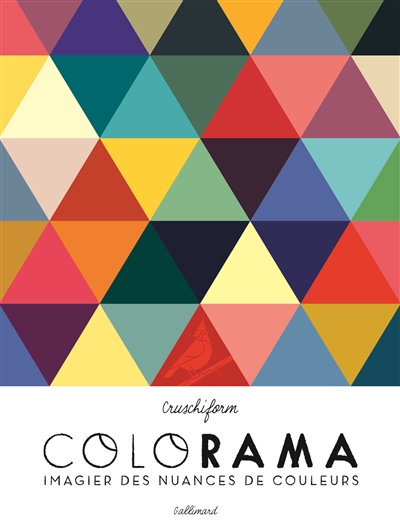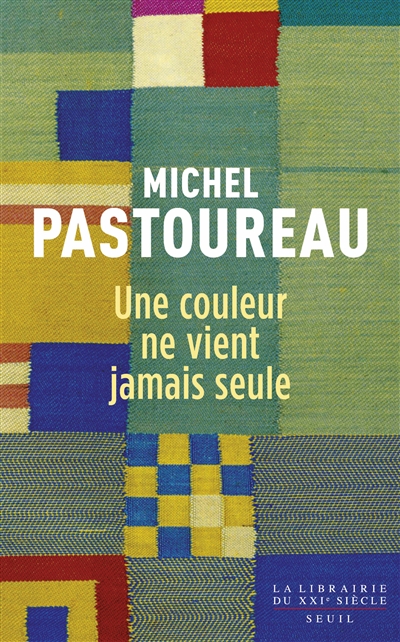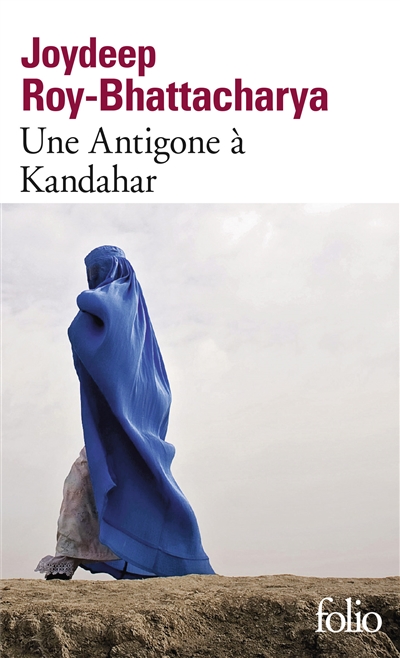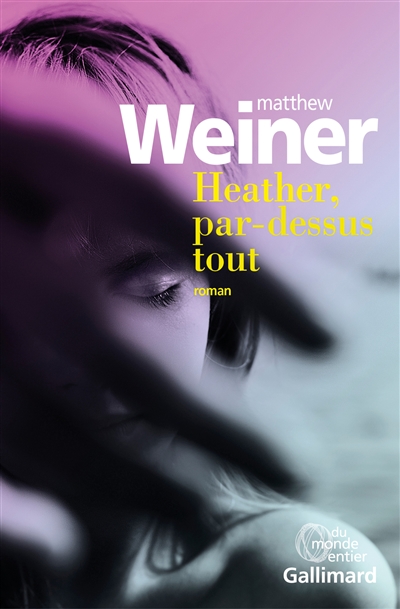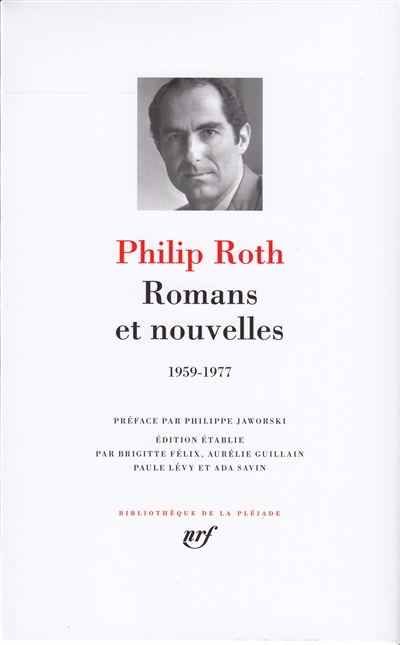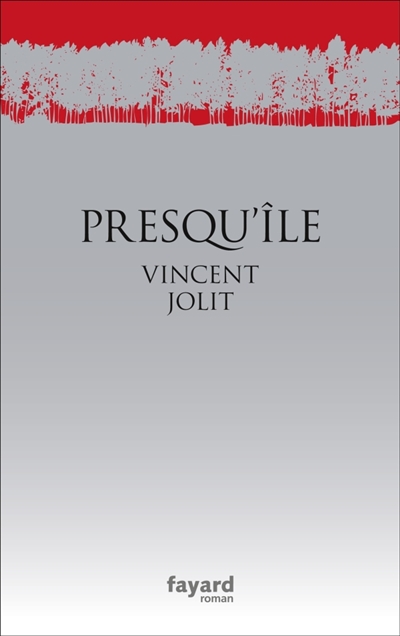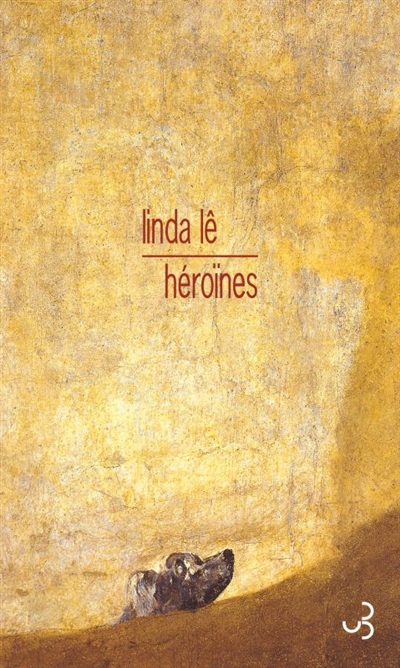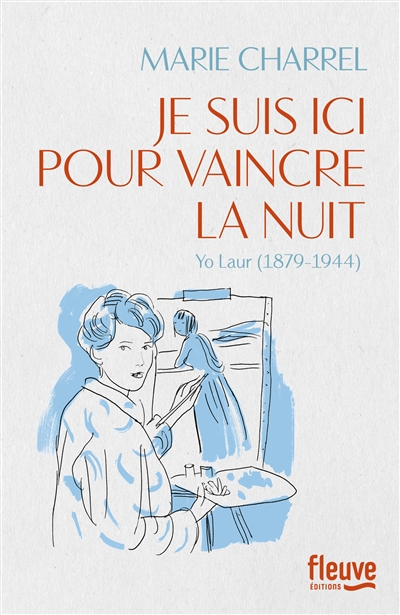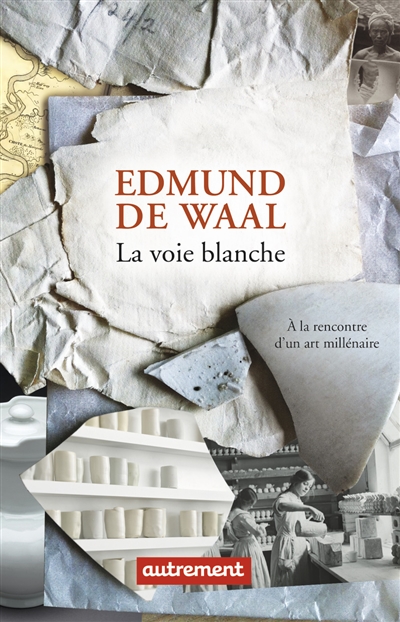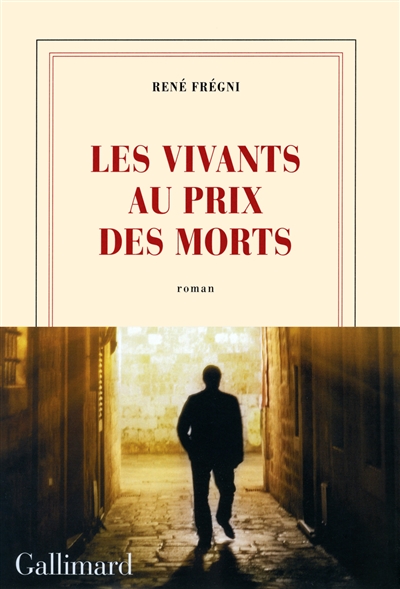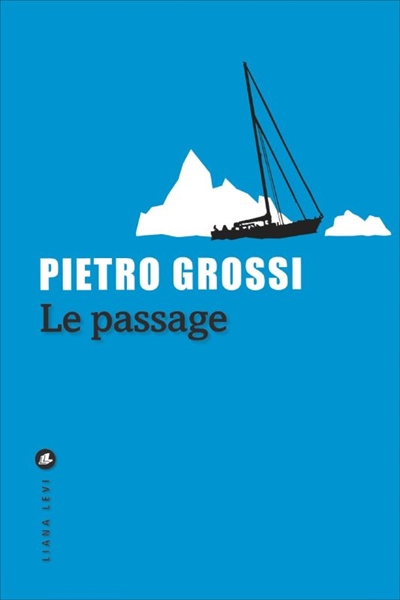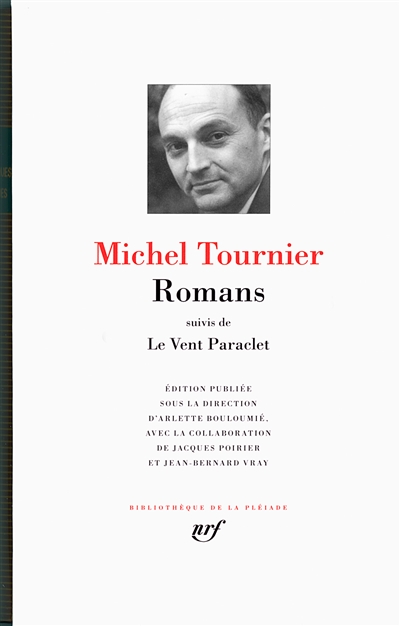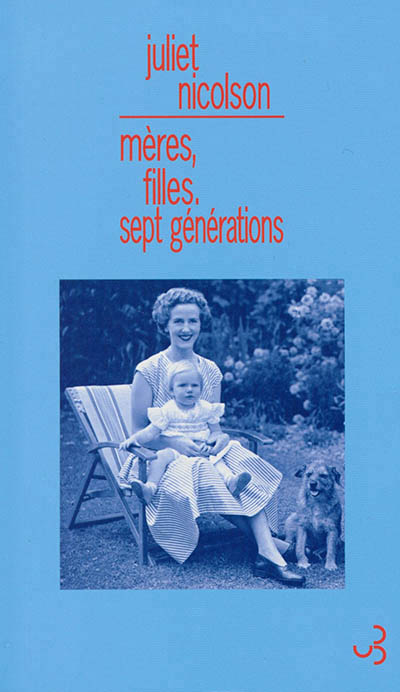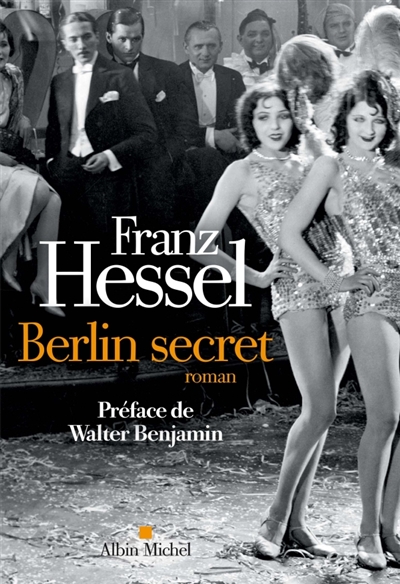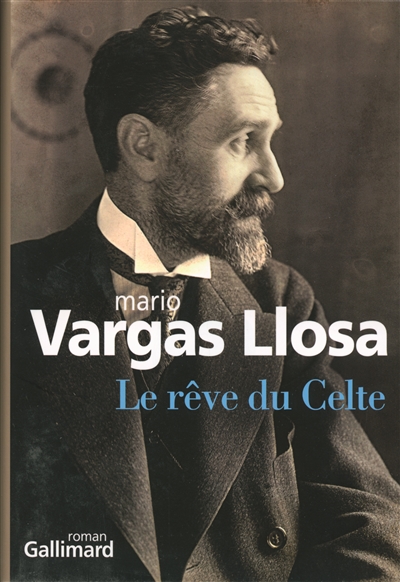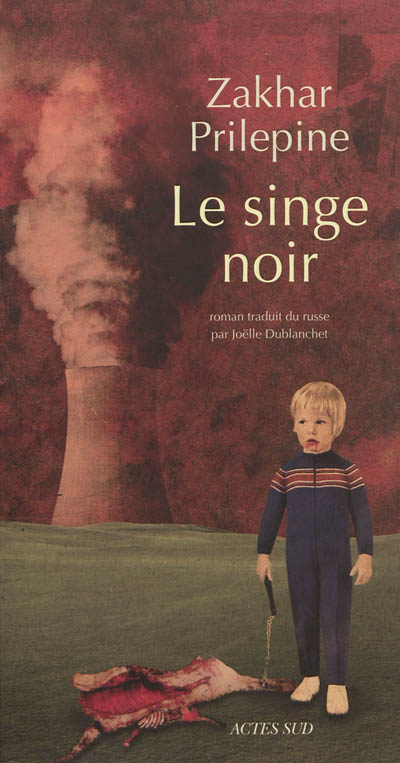Littérature étrangère
Jeroen Olyslaegers
Trouble
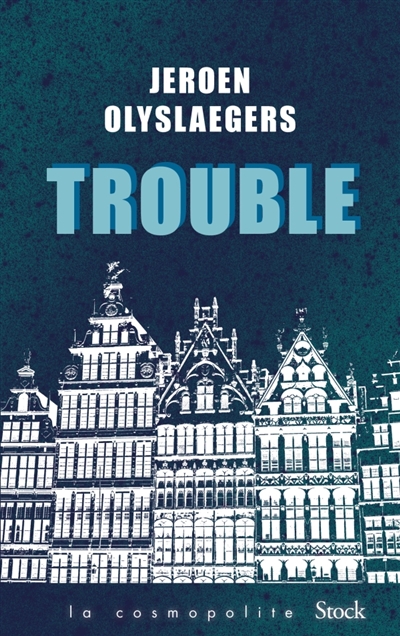
Partager la chronique
-
Jeroen Olyslaegers
Traduit du néerlandais par Françoise Antoine
Stock
09/01/2019
433 p., 22.50 €
-
Chronique de
Aurélie Janssens
Librairie Page et Plume (Limoges) -
Lu & conseillé par
6 libraire(s)- Aurélie Janssens de Page et Plume (Limoges)
- Anne-Sophie Rouveloux
- Sarah Gastel de Terre des livres (Lyon)
- Christophe Aimé de M'Lire Anjou (Château-Gontier)
- Sébastien Balidas de M'Lire (Laval)
- Véronique André de Baba-Yaga (Sanary-sur-Mer)


Chronique de Aurélie Janssens
Librairie Page et Plume (Limoges)
Il est des voix qui surgissent du passé pour nous raconter leur histoire troublante. Prisonnière d’un procès-verbal classé aux archives anversoises (un document à peine officiel), la voix de Wilfried Wils aurait pu rester muette, sans la curiosité d’un historien pour sa ville et le talent d’un romancier pour lui donner vie.
C’est un samedi de décembre, la Saint-Nicolas et Noël sont présents dans les vitrines. Pourtant, un quartier d’Anvers échappe à cette frénésie d’illuminations, de sapins, de bonhommes rouges et ventrus : le quartier juif. Il se déploie au sud de la Gare Centrale et ne se résume pas qu’à Vestingstraat, la rue des diamantaires, un commerce qui ne leur appartient quasiment plus depuis la Seconde Guerre mondiale. Jeroen Olyslaegers est l’un des habitants de ce quartier. Cet auteur flamand ressemble plus à un personnage de conte folklorique que l’on pourrait croiser au fond d’une antique bibliothèque ou d’une forêt, petites lunettes, cheveux et barbe fournis, qu’à l’un des nombreux juifs orthodoxes que l’on croisera lors de notre visite sur les traces du passé. Cet homme s’est néanmoins penché sur l’histoire de son quartier, une histoire peu reluisante, car si aujourd’hui des militaires armés protègent la sortie des écoles juives, il y a quatre-vingts ans, des policiers anversois ont participé activement aux rafles et à la déportation de 26000 juifs. De nos jours, dans les rues enneigées, un vieil homme se promène. Chaque pas le ramène dans un passé encore bien présent. Comme on capte sur une station de radio une voix chevrotante qui émerge parmi les grésillements, Wilfried Wils raconte son histoire, se livre, se confie. Si la ville d’Anvers n’est pas citée dans le roman, chaque rue, chaque maison, constitue ce personnage à part entière. Ce roman nous ramène en 1940. Wil, 22 ans, vient d’entrer dans la police au moment où les Allemands envahissent la Belgique. Certains de ses camarades tombent les masques et peuvent laisser libre cours à un antisémitisme assumé, d’autres tentent tant bien que mal de se soustraire aux ordres, de sauver ceux qui peuvent encore l’être. Et Wilfried dans tout ça ? Si l’on en croit le récit du vieil homme, il n’aurait pas grand-chose à se reprocher. Si on lit entre les lignes, si l’on explore les zones grises, si l’on ose frayer dans les eaux troubles de l’Histoire, alors on sent qu’on tient dans les mains ce genre de roman indispensable qui nous hantera longtemps, qui bouscule les certitudes et permet de comprendre toutes les facettes d’une réalité, qu’elle soit passée ou présente.
PAGE — Vous rappelez que les Anversois n’ont pas eu besoin des Allemands pour être antisémites. Les échos avec le présent et la montée des nationalismes sont forts. Pensez-vous que ce soit dans ces moments-là que les bas instincts se réveillent, que les masques tombent ?
Jeroen Olyslaegers – Une crise peut obliger les gens à se dévoiler, à montrer leur vrai caractère. Mais elle peut aussi avoir l’effet inverse sur certaines personnes. Ils préfèrent vivre cachés, s’abstenir de prendre des décisions, ne pas être présents à leur époque. Face à des problèmes si sérieux, si apocalyptiques, si confrontants, on peut être tenté de s’extraire du monde. On peut ressentir face à une urgence, le besoin d’être stoïque et de mettre de la distance entre soi et les faits. L’Occupation a pu agir comme révélateur chez certains qui ont senti le besoin de pouvoir être enfin aux yeux de tous comme ils se sentaient être intérieurement, fascistes ou résistants, mais la plupart ont préféré rester cachés, en retrait.
P. — Wilfried s’adresse à son arrière-petit-fils dans une sorte de confession. On aurait tendance à apporter du crédit à son récit. Mais, petit à petit, des éléments nous montrent que les souvenirs peuvent aussi se révéler inexacts. Mettez-vous en garde contre la véracité des récits ?
J. O. – Les récits sont pleins d’ambiguïtés car ils sont subjectifs. L’objectivité n’existe pas. Nous sommes aujourd’hui dans une situation réellement postmoderne. On est amené à se méfier de tous les récits, à devenir paranoïaque, entre les fake news, les discours des dirigeants qui servent leurs propres intérêts, les sites Internet qui publient tout sans vérification. Dans Trouble, il y a cette mise en garde contre le discours. Est-ce que le récit de Wilfried est la réalité ? Non, pas forcément.
P. — Il y a une scène où Wilfried dit que lorsqu’on se projette dans le passé, dans un conflit, on s’identifie toujours aux victimes. Cela fait écho au livre de Pierre Bayard, Aurais-je été résistant ou bourreau ?, publié chez Minuit en 2013. Qu’est-ce qui motive des écrivains nés après-guerre à continuer à se questionner sur le sujet ?
J. O. – Cette scène est pour moi cruciale dans le roman. Elle dit presque tout. Aujourd’hui, nous sommes entourés d’écrans et nous ne sommes pas acteurs de cette vie que nous observons. On ne se sent pas prêt à faire face à l’expression directe d’une certaine violence. Notre capacité morale ne peut concevoir l’horreur. Nous sommes obsédés par les victimes. Nous avons une forme de curiosité malsaine à recueillir leur témoignage, quelle que soit la violence subie. En revanche, personne ne veut comprendre la parole des bourreaux. Or, recueillir cette parole est aussi important pour comprendre les mécanismes de la violence. On ne peut avancer si l’on se base seulement sur les mots des victimes, on a besoin aussi de ceux des bourreaux. Il ne faut pas être hypocrite. Tout le monde peut devenir bourreau. Si on ne l’accepte pas, comment peut-on réfléchir sur la violence ?
P. — Le titre original du livre est Wil, jeu de mots avec le verbe « vouloir » en flamand et le nom de Wilfried. On pourrait lui reprocher de ne pas avoir su s’engager clairement, de « vouloir ». Est-ce que vous déplorez ce manque d’engagement, cette zone grise où les gens se laissent porter ?
J. O. – L’ambiguïté du titre était importante. Elle fait référence à Nietzsche « Wille zur macht », la volonté de puissance. Or, il y a une certaine ironie car Wilfried Wils est l’antithèse du « vouloir ». Sa seule volonté est artistique, elle se place dans la création, ses poèmes. Mais le titre français est très intéressant aussi et peut-être plus proche de l’intention de mon roman. D’ailleurs, je pense que le lectorat français sera plus à même de saisir l’ambiguïté morale de mon roman que le lectorat hollandais par exemple où le calvinisme est encore fortement présent et les différences entre le Bien et le Mal fondamentales. Les Français, comme les Belges, savent mieux comprendre ces zones grises, ces zones troubles.