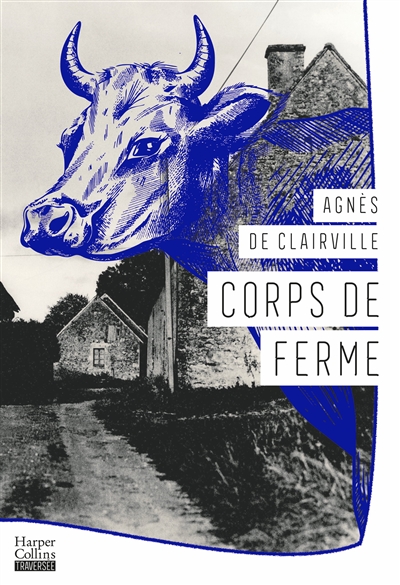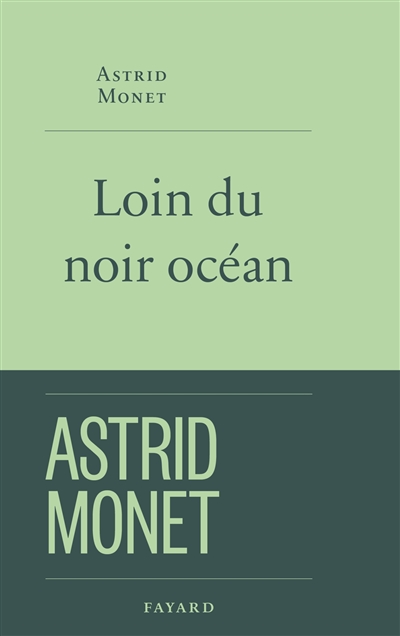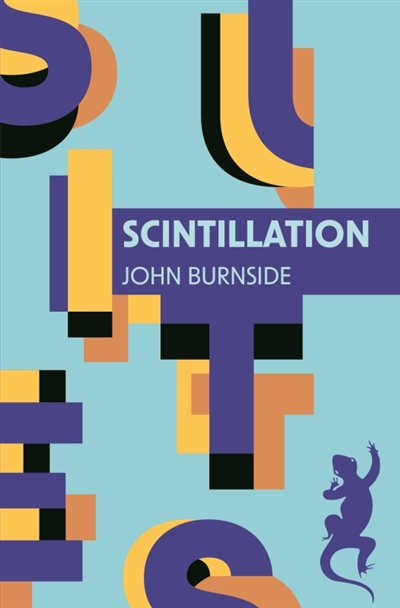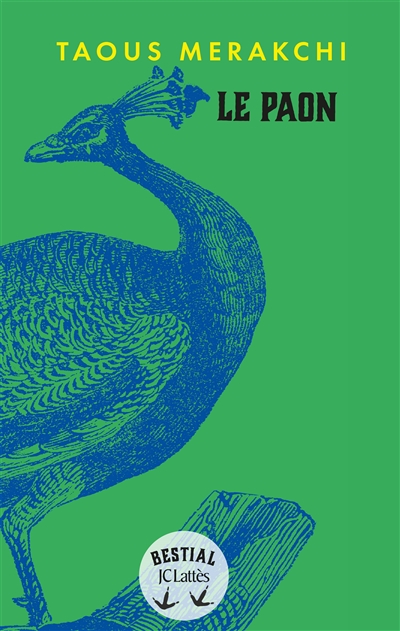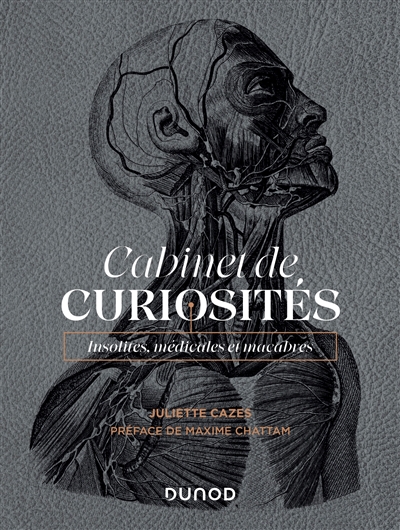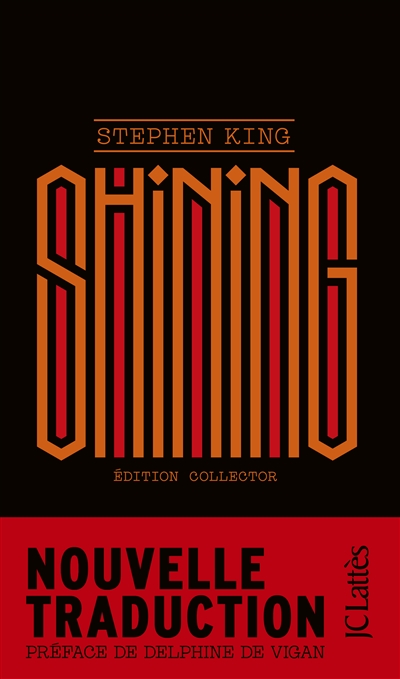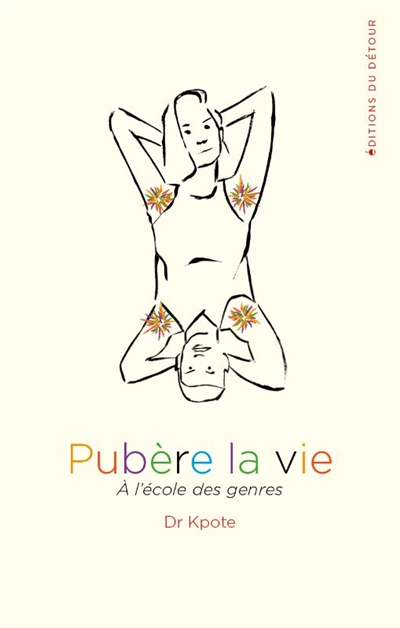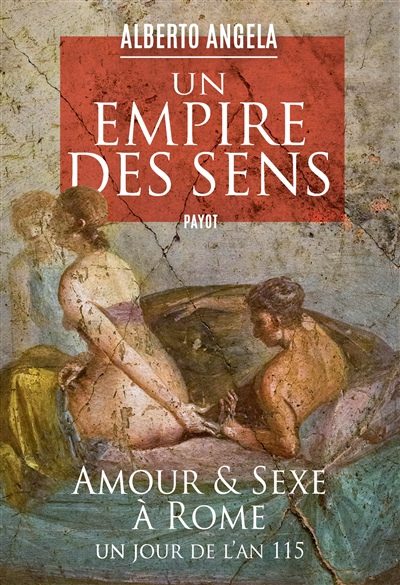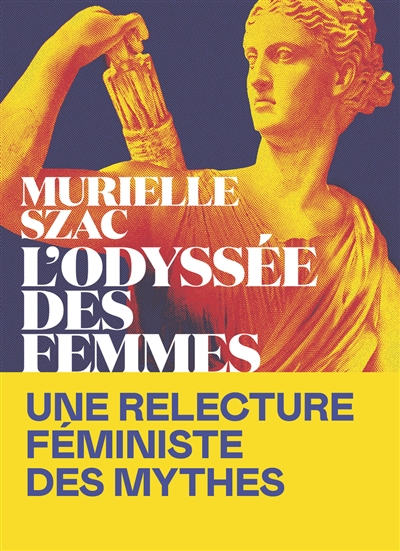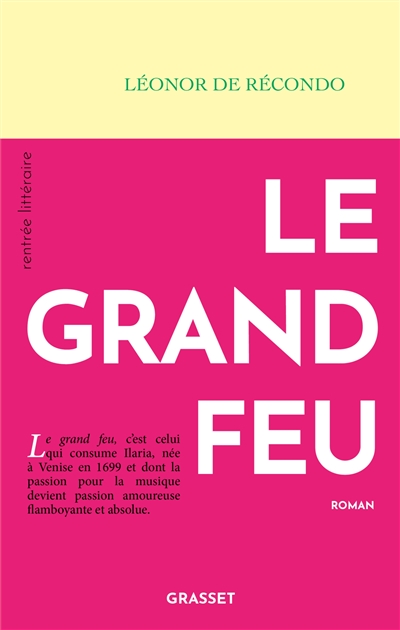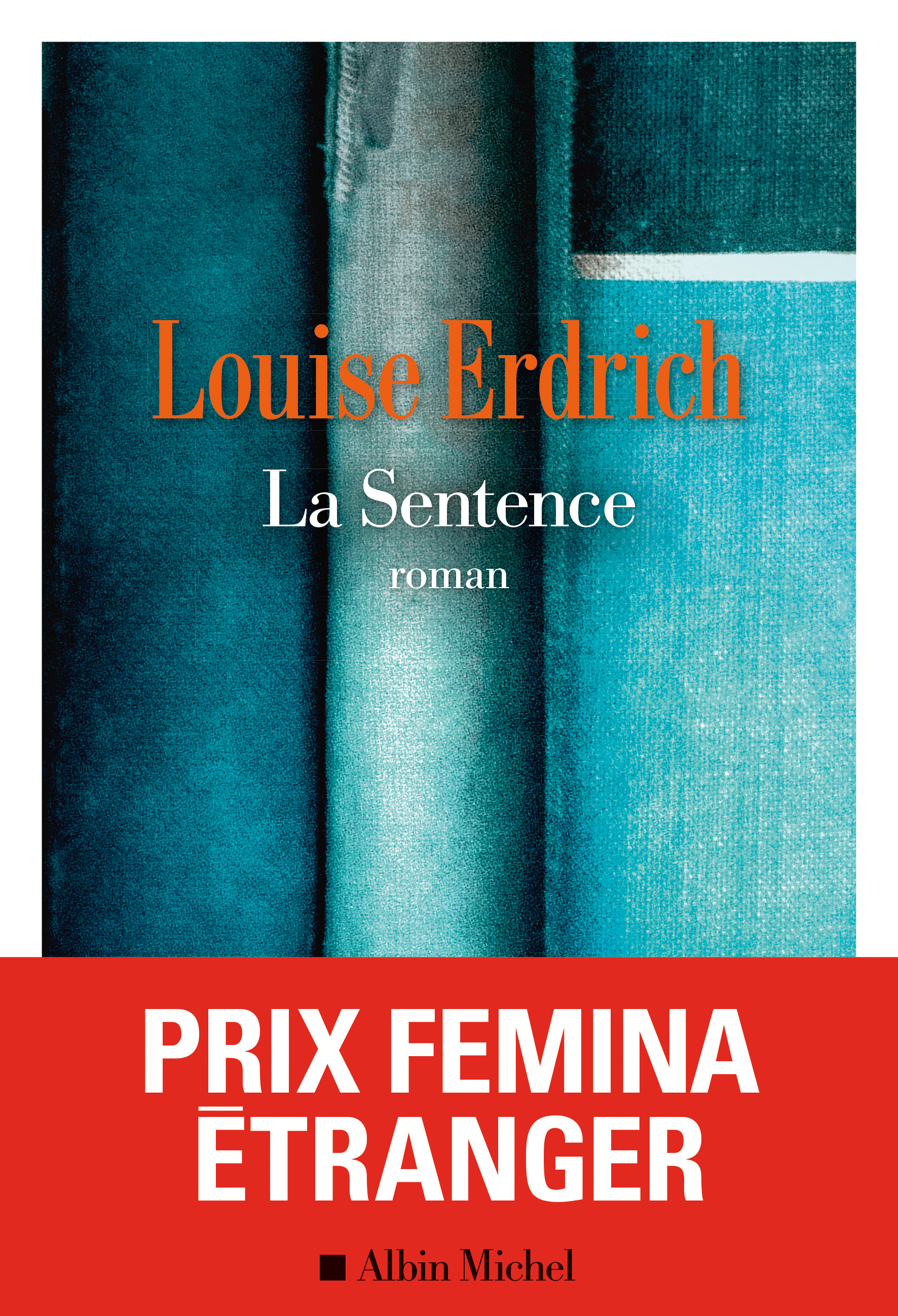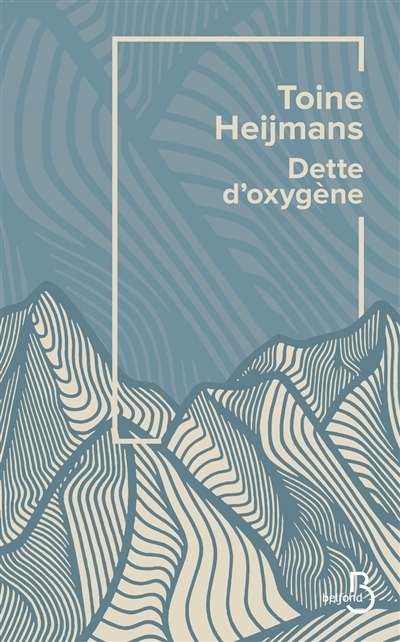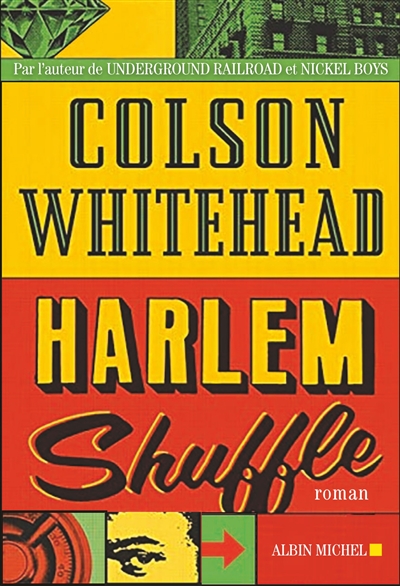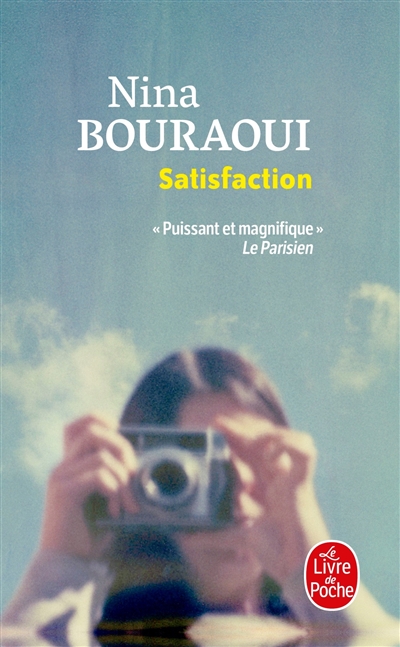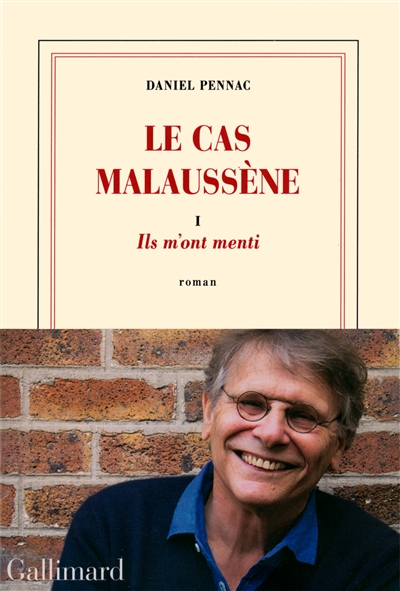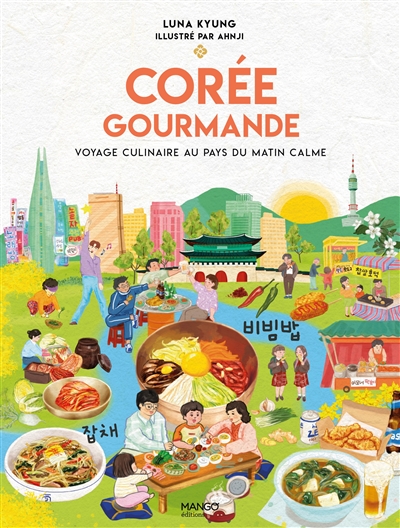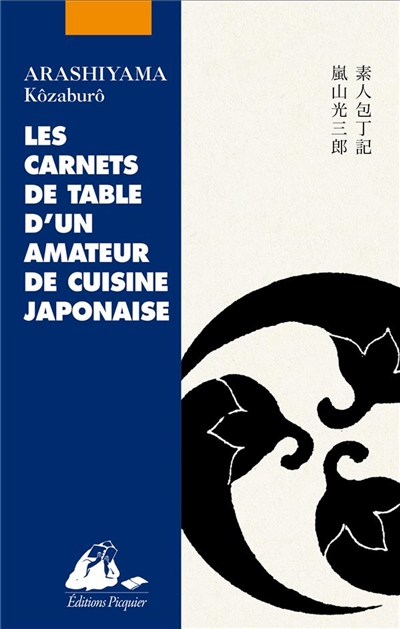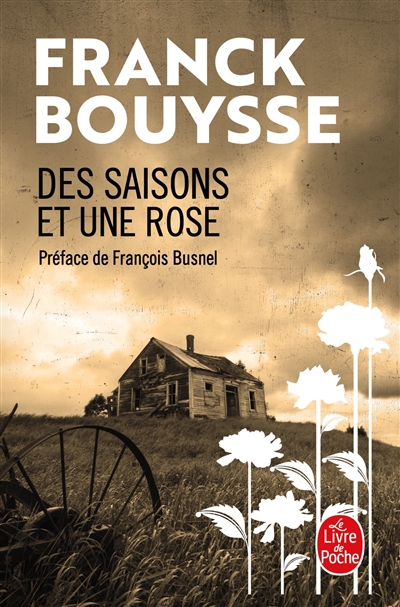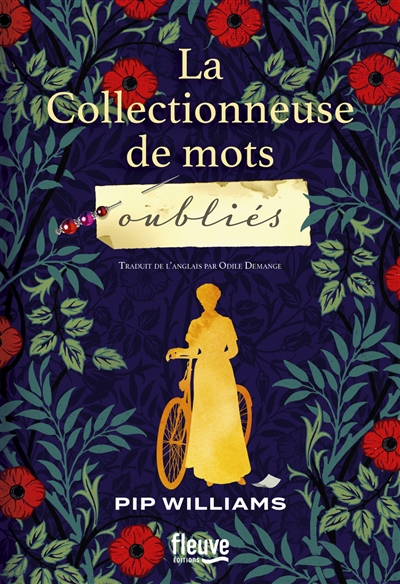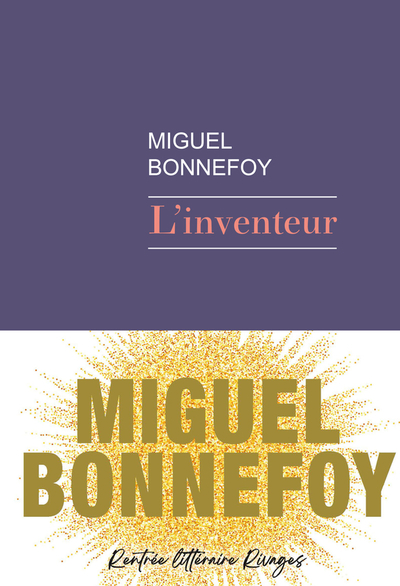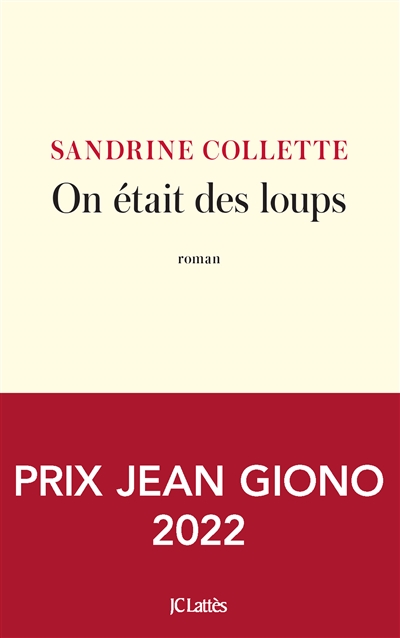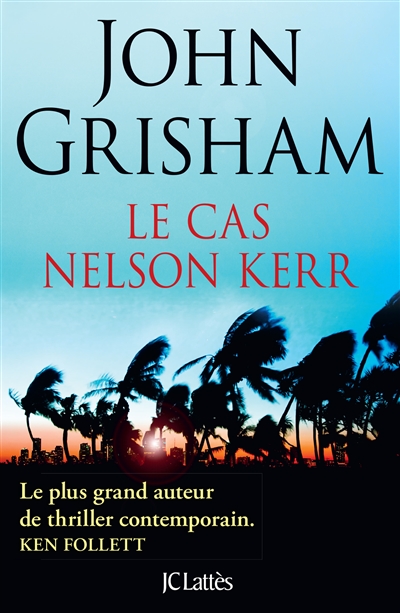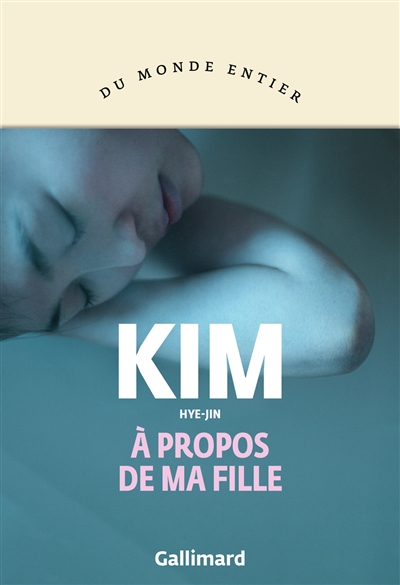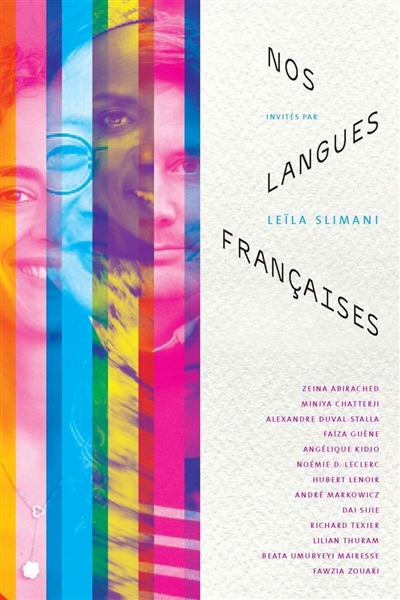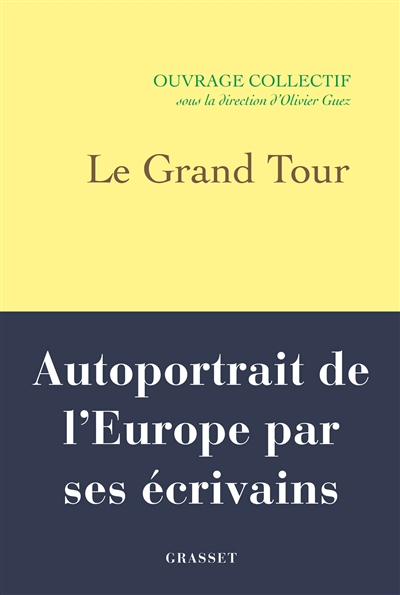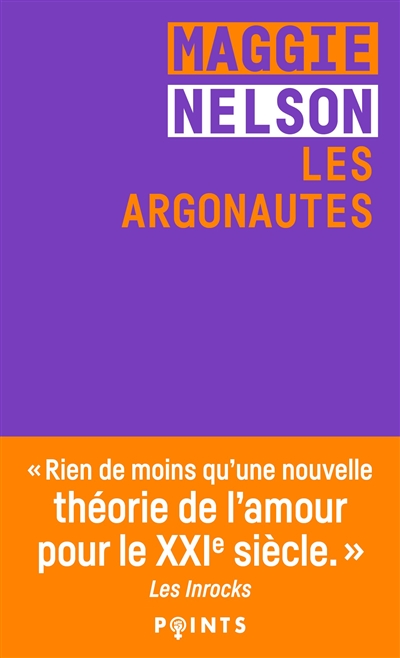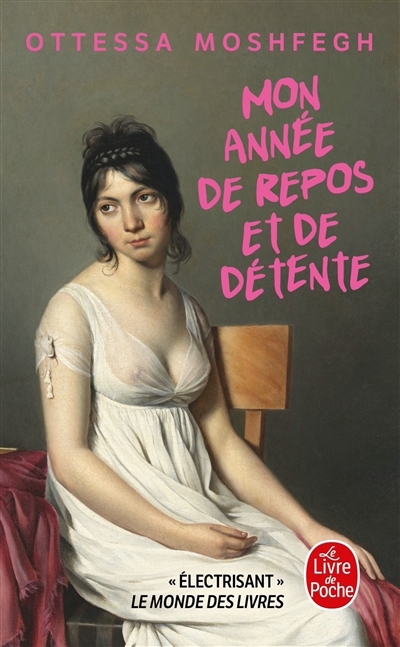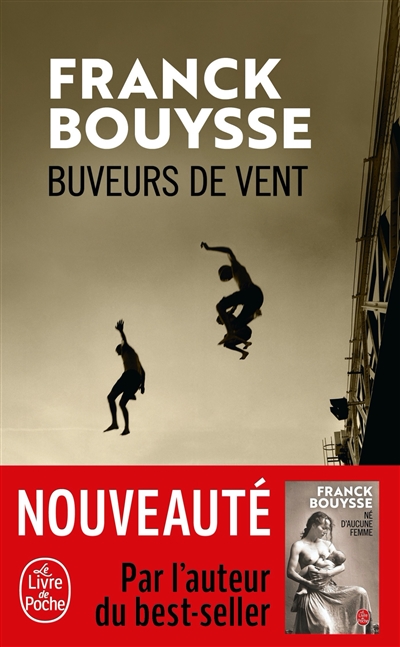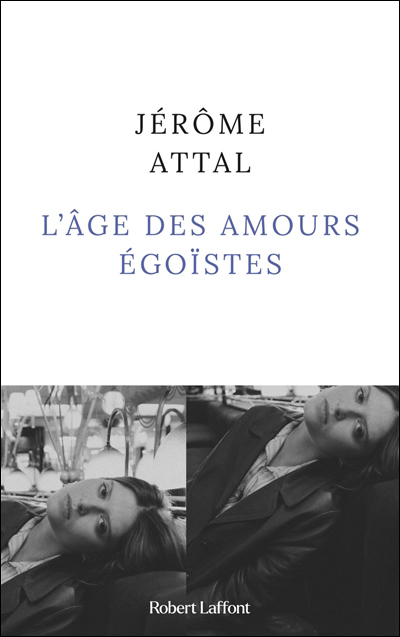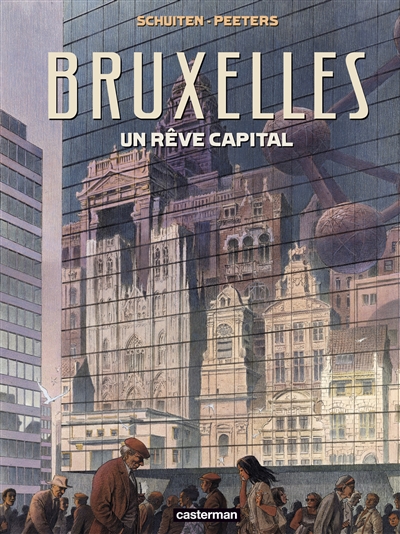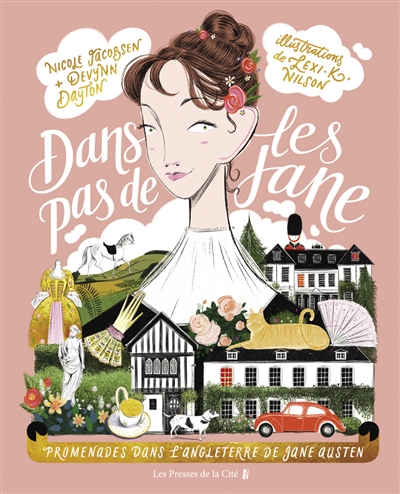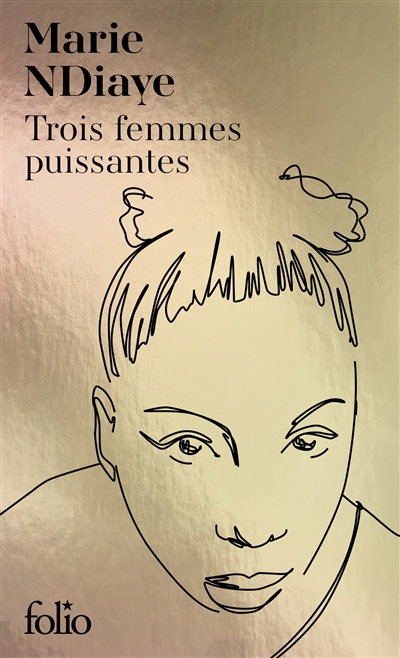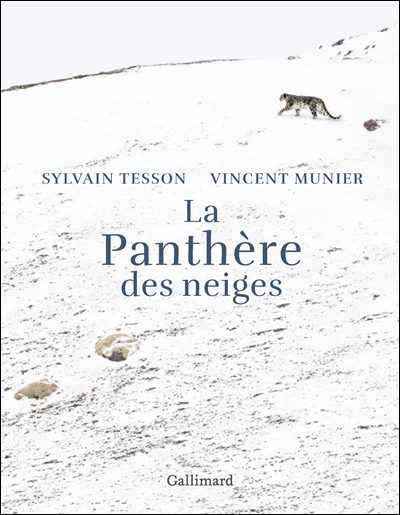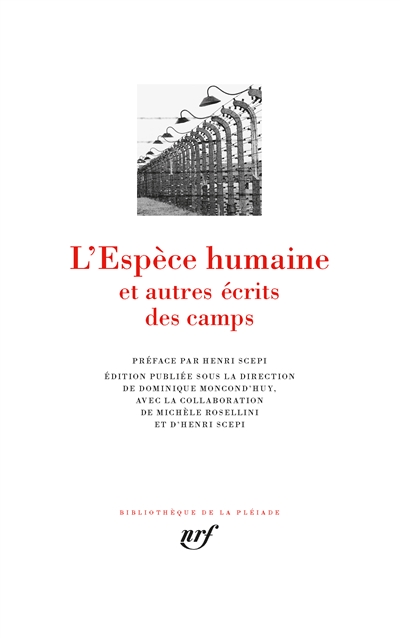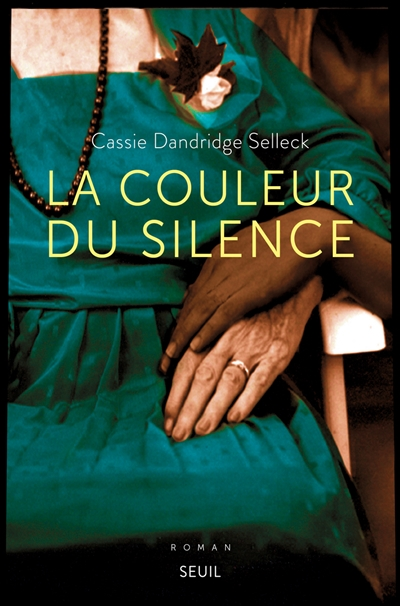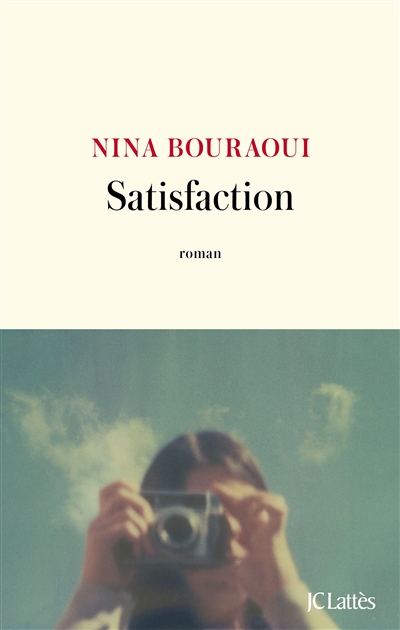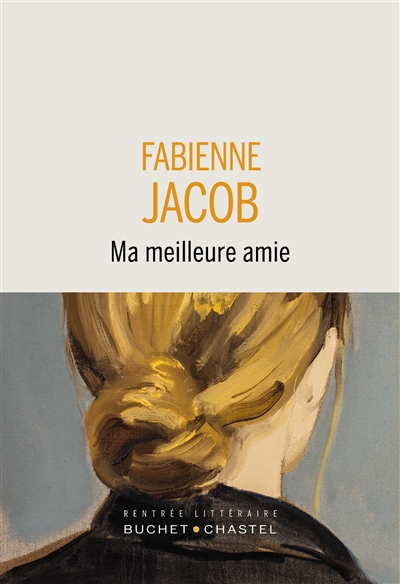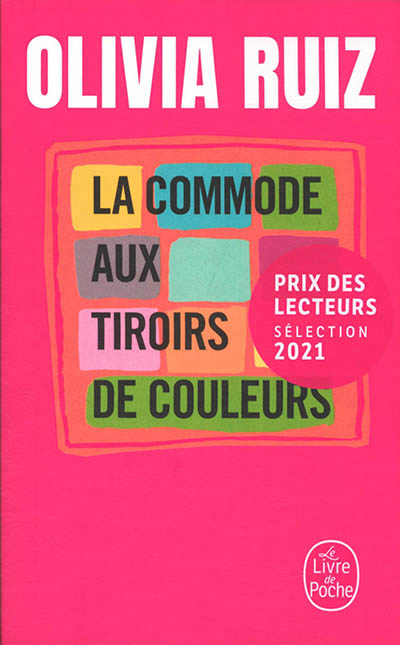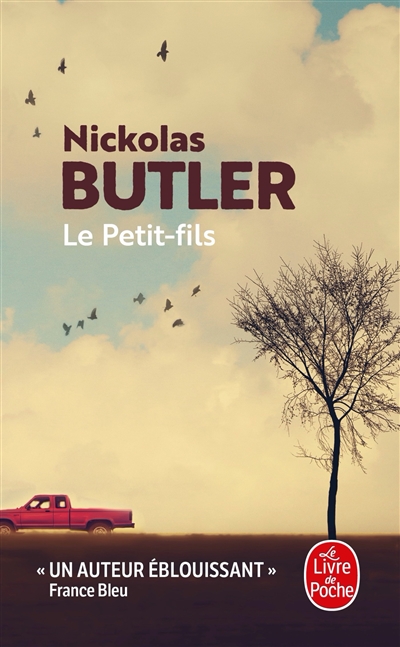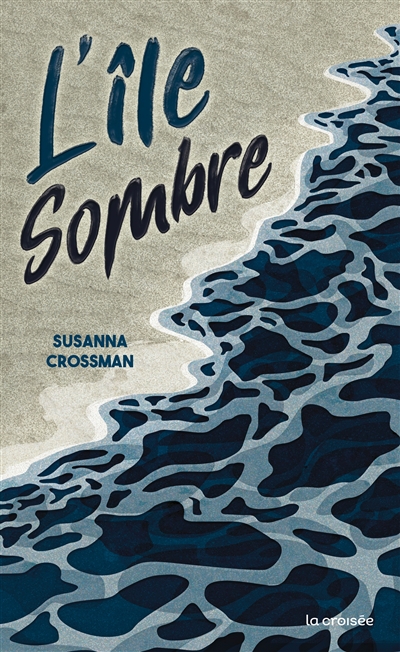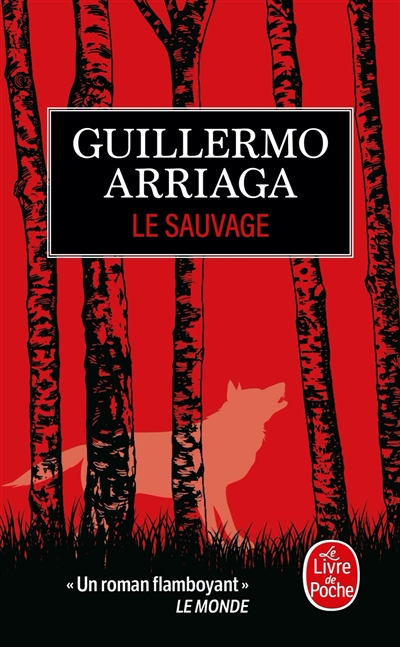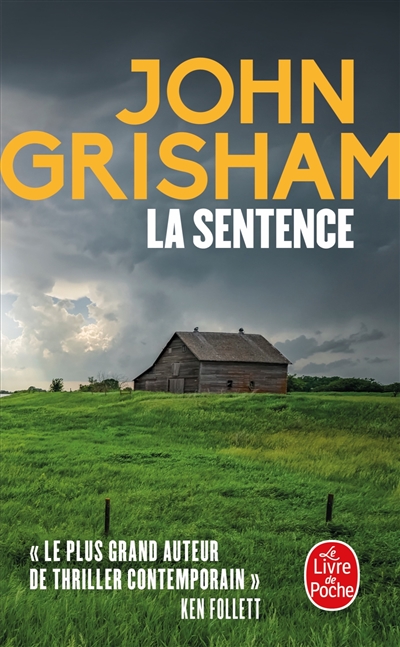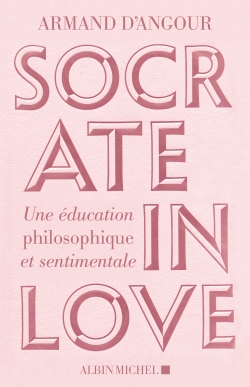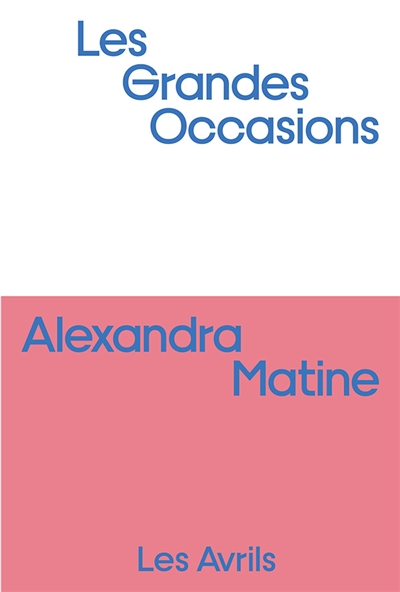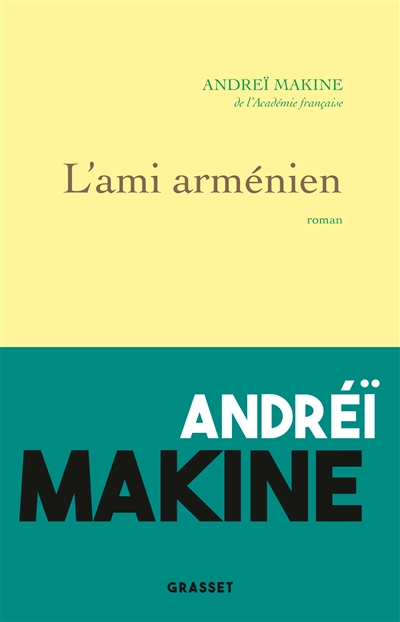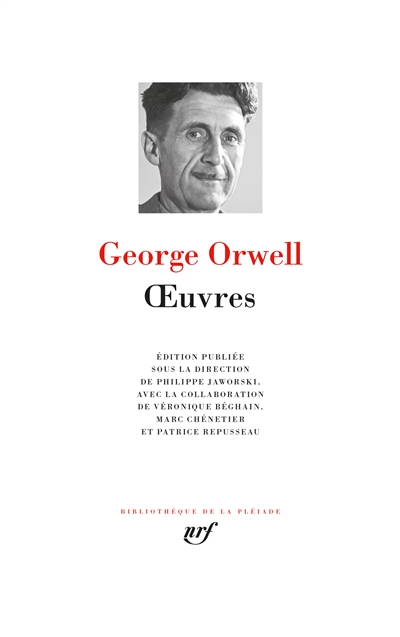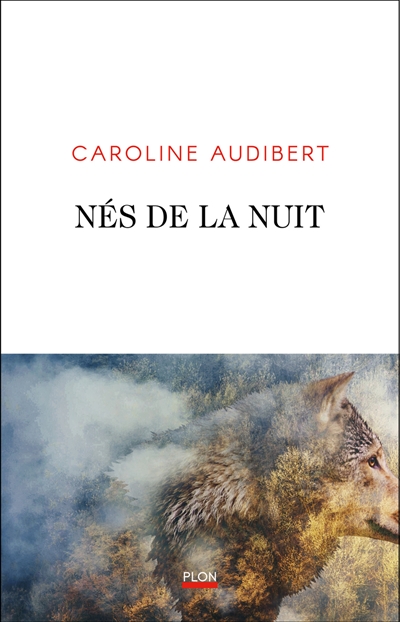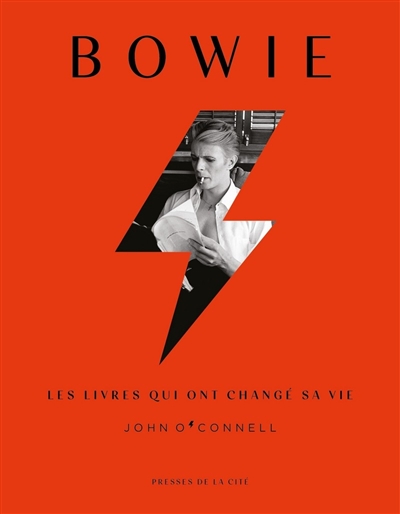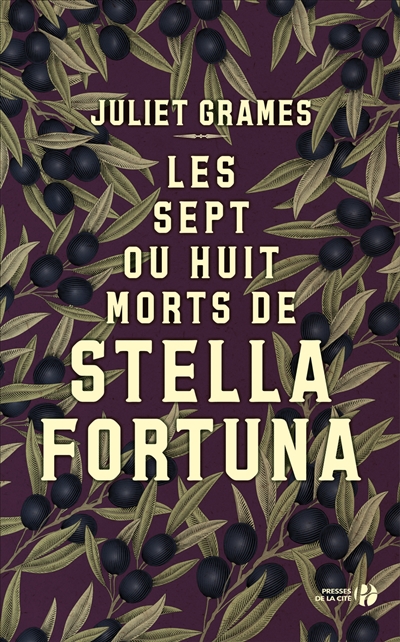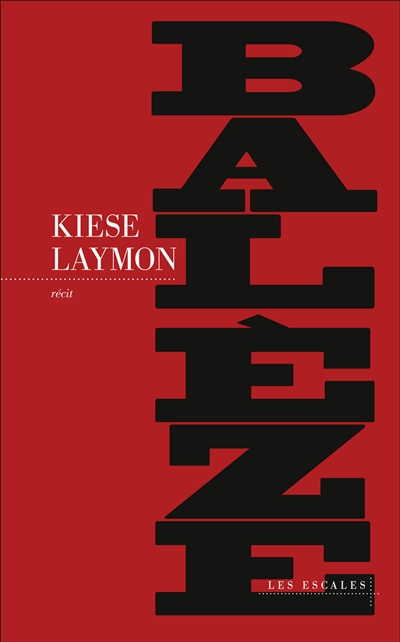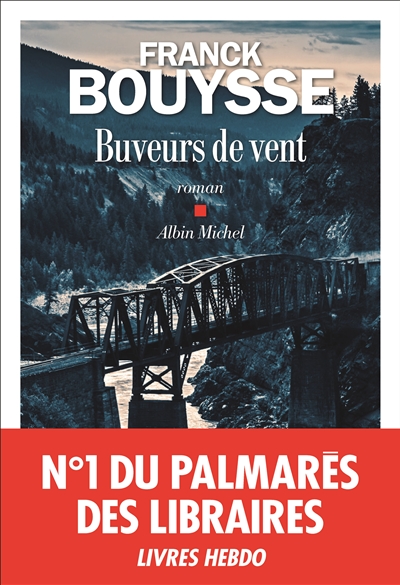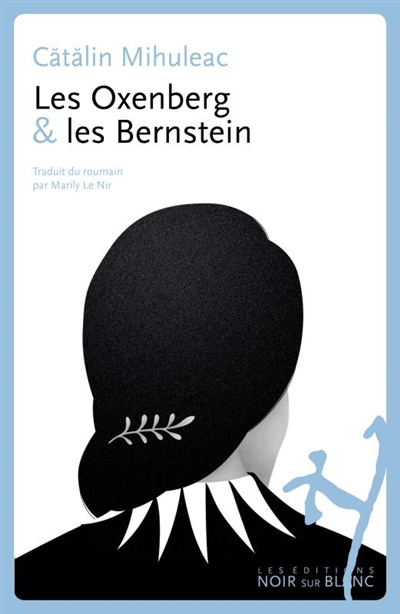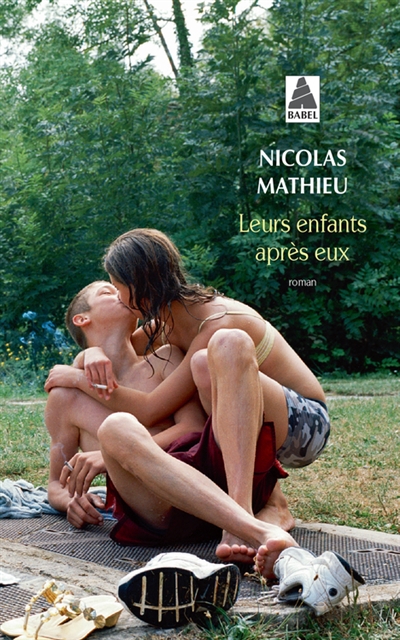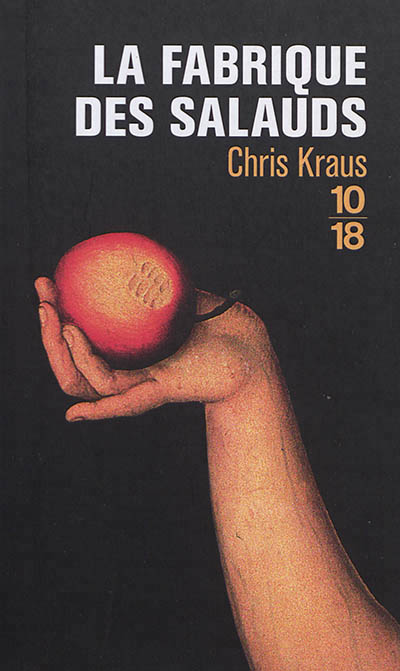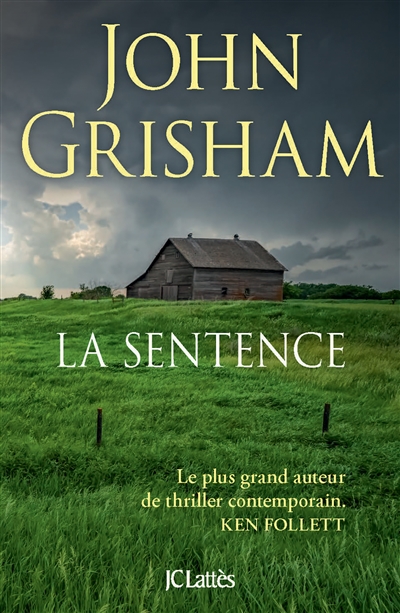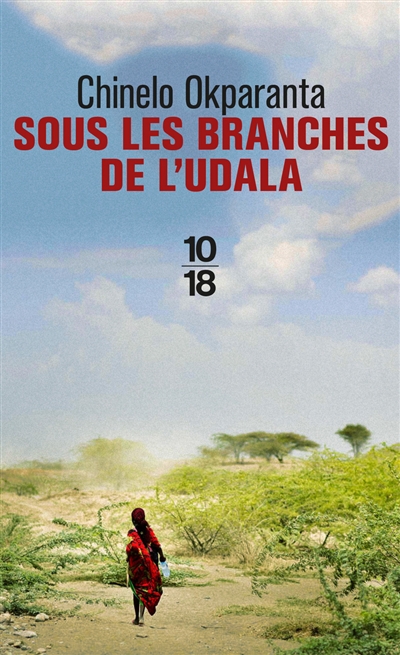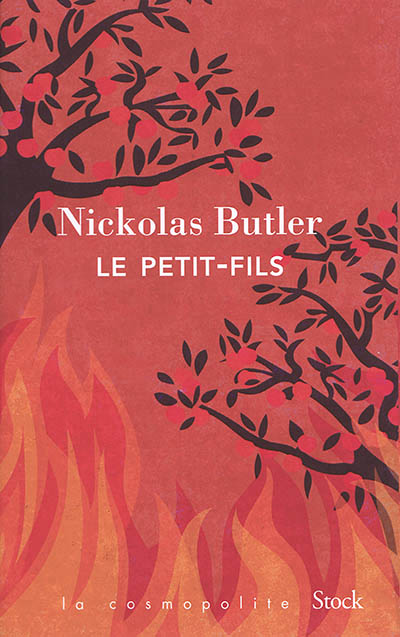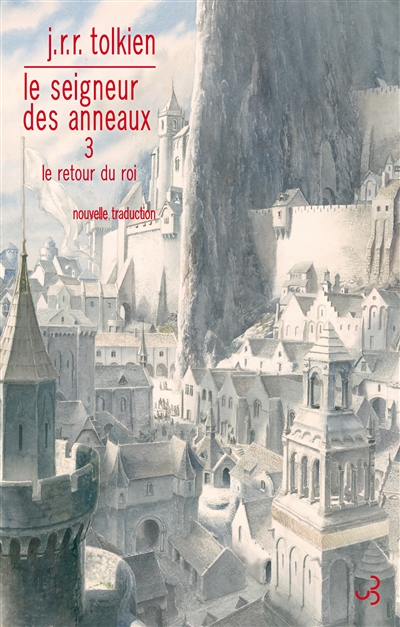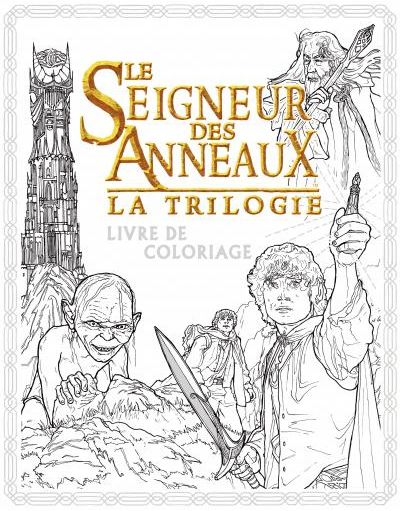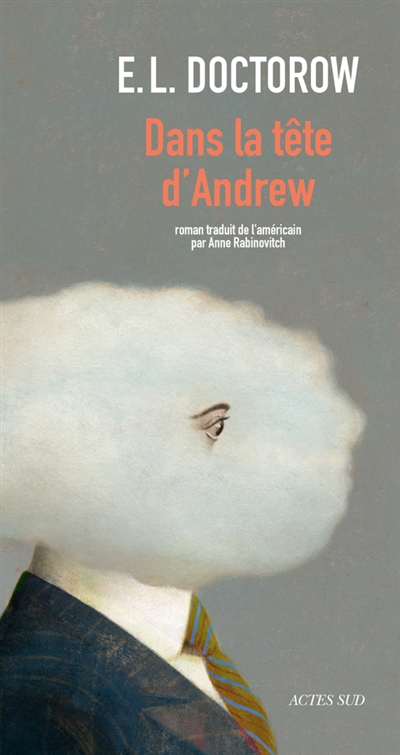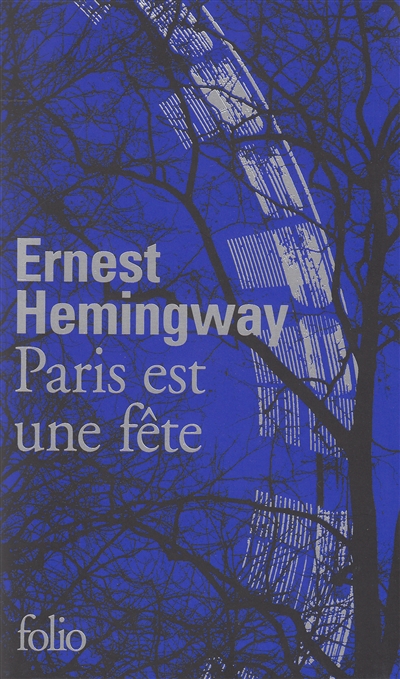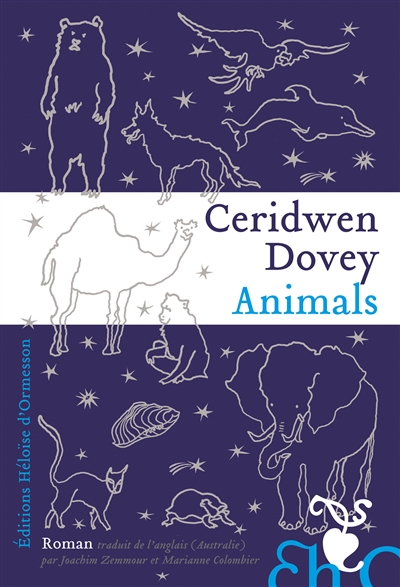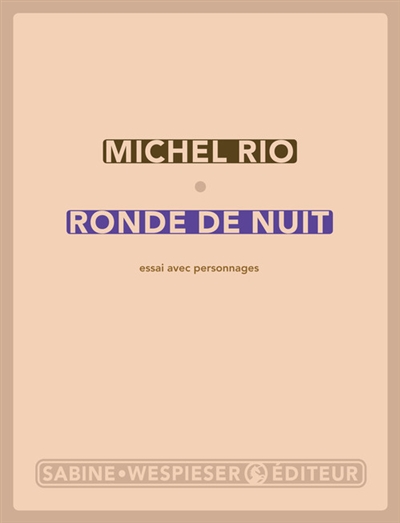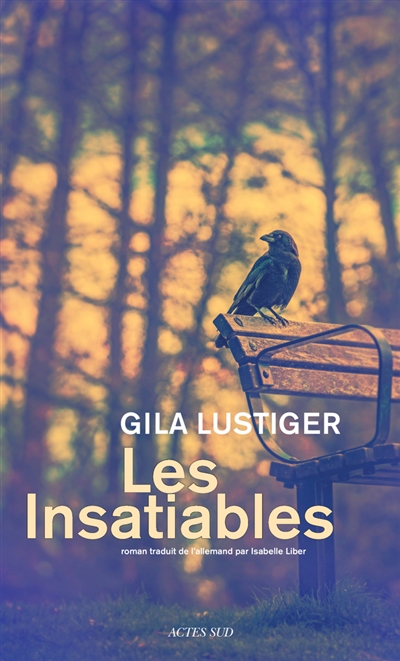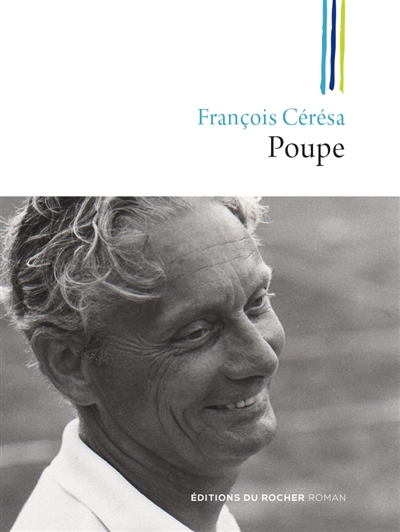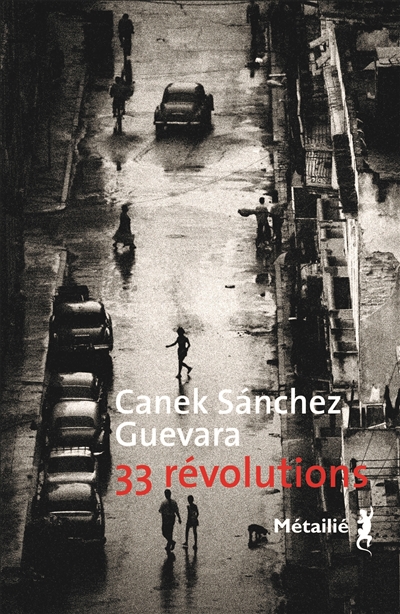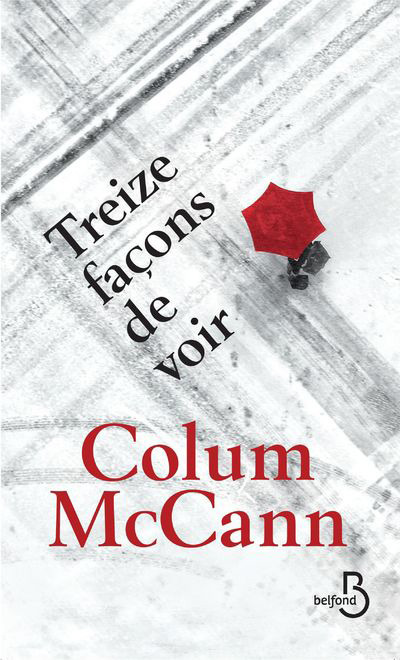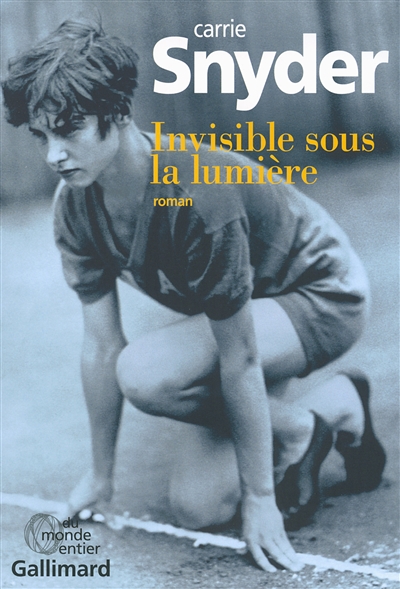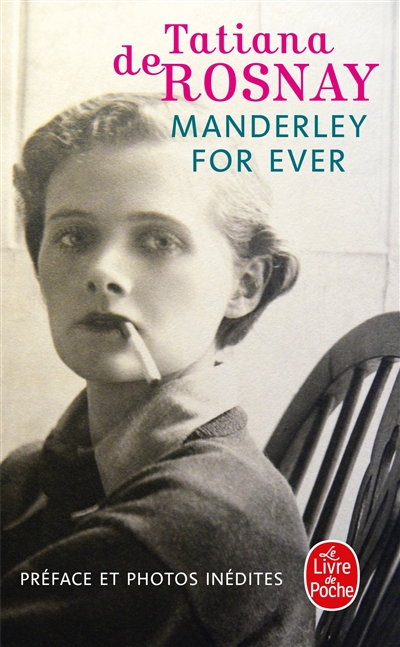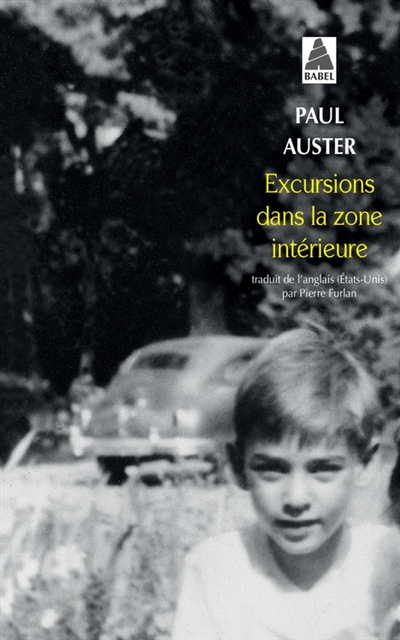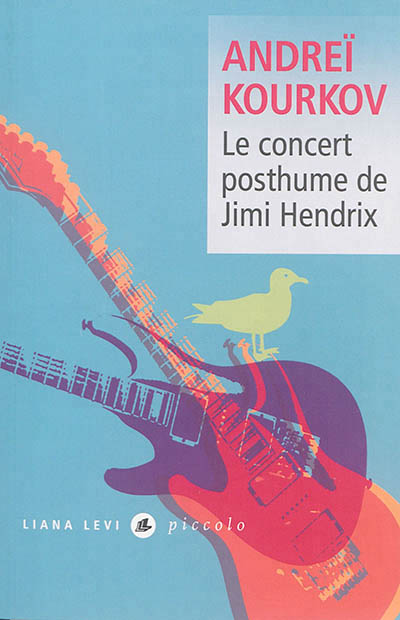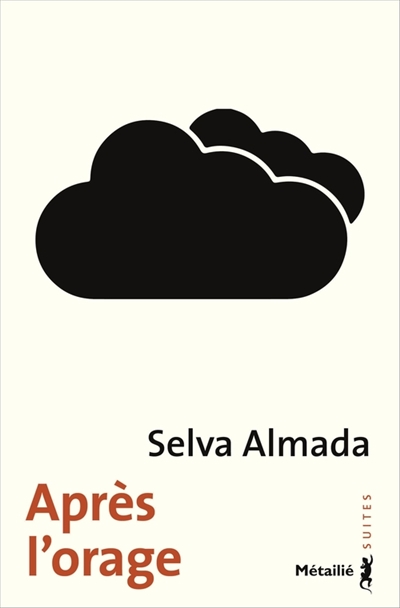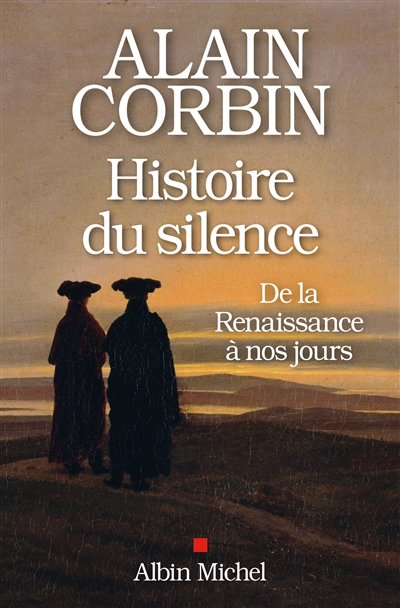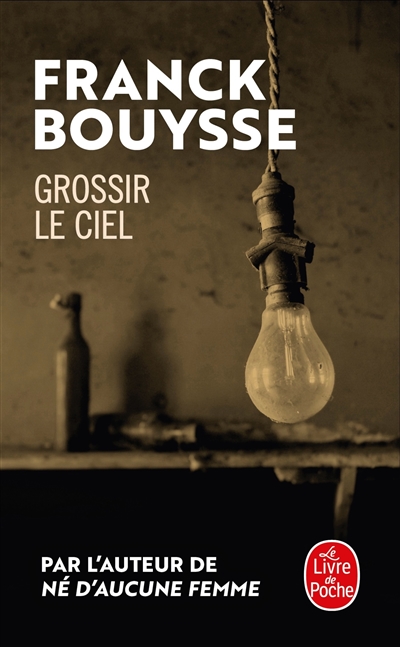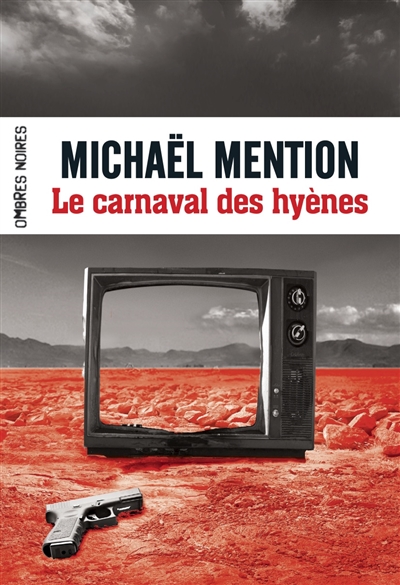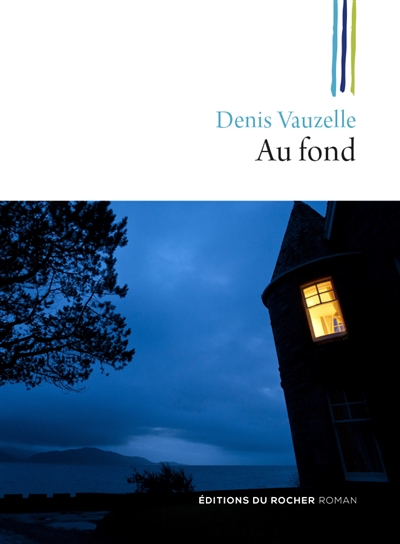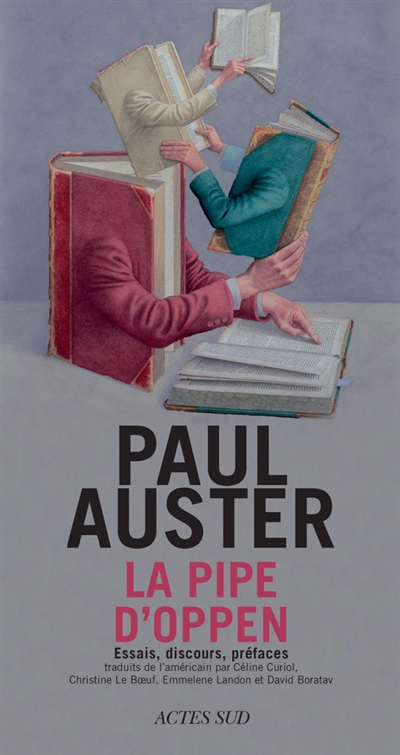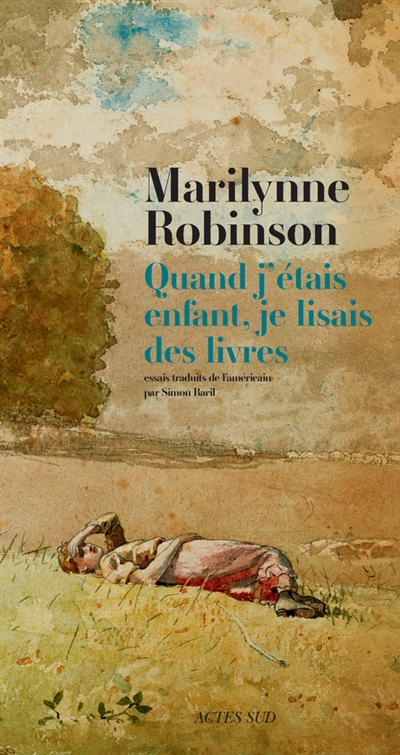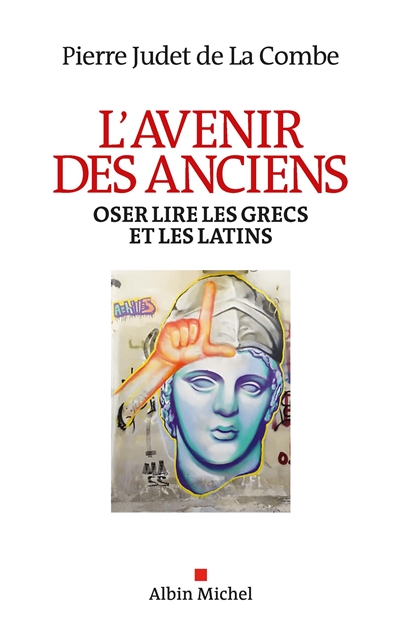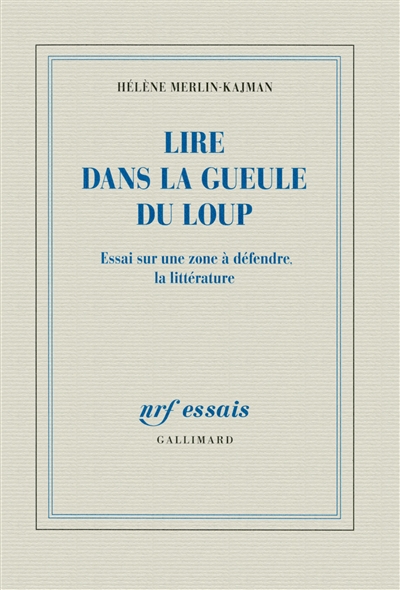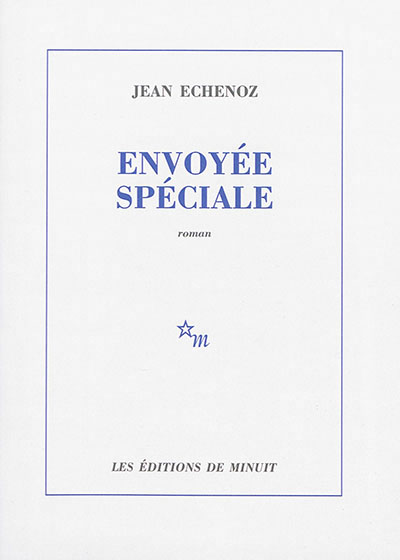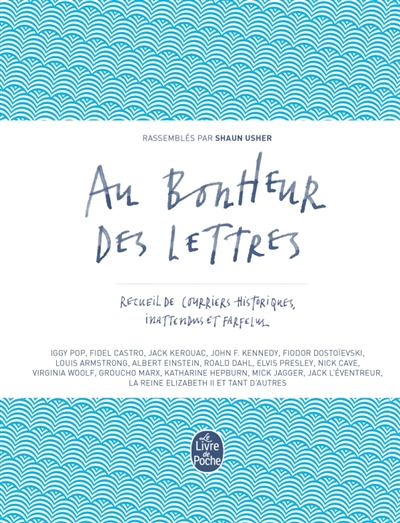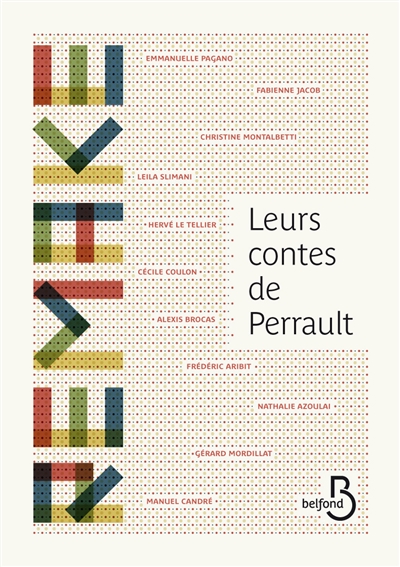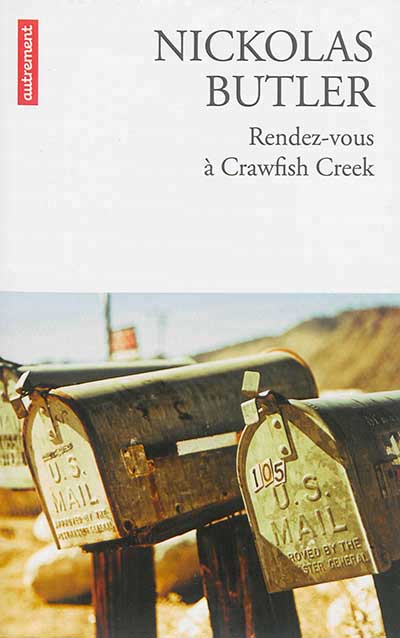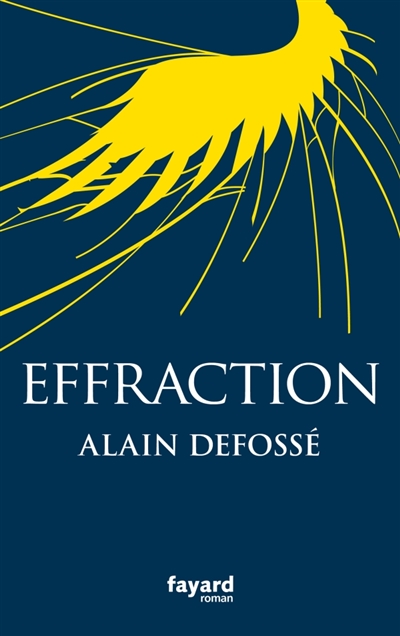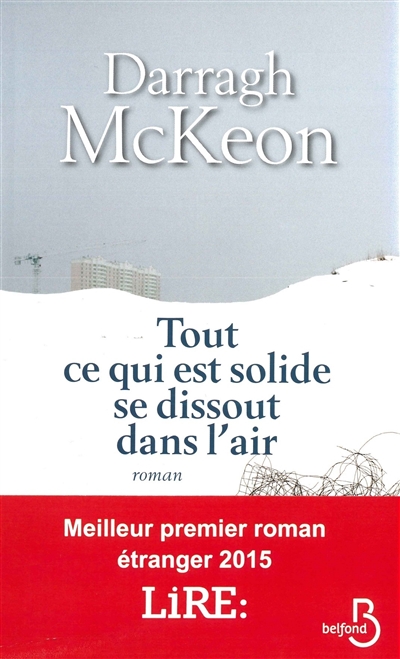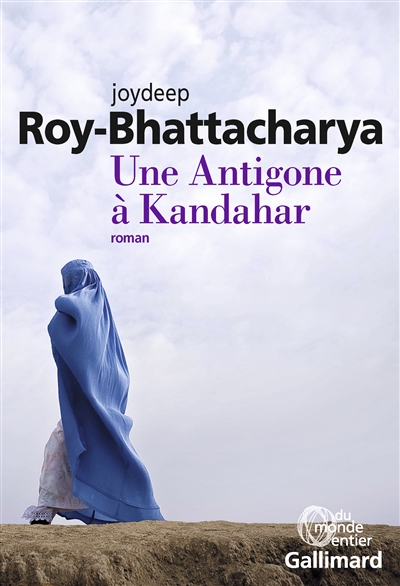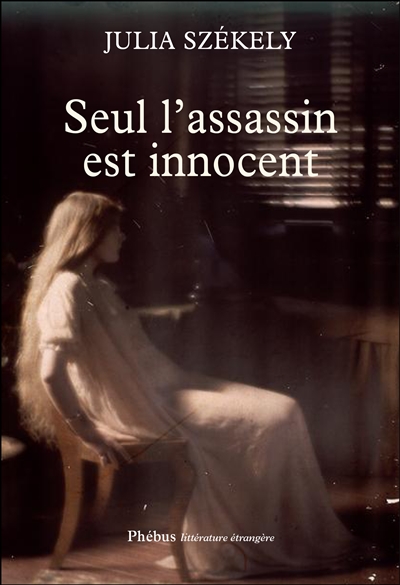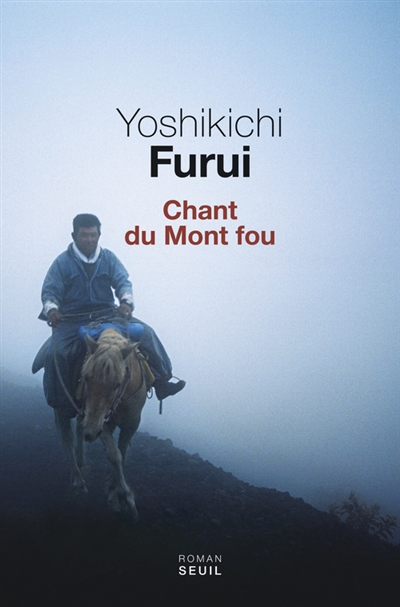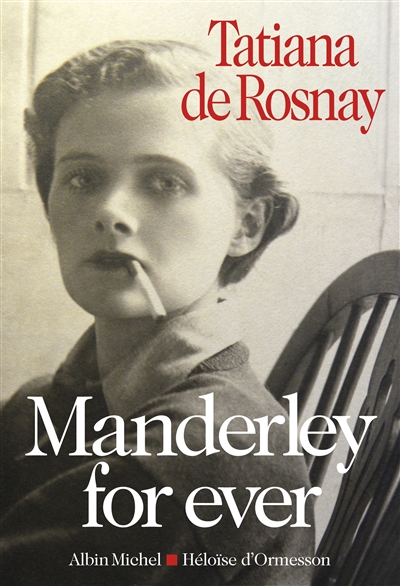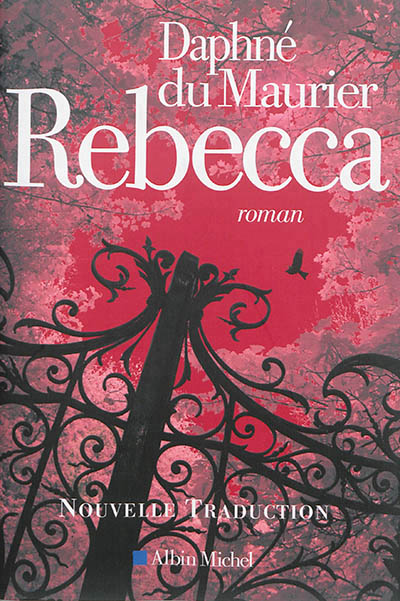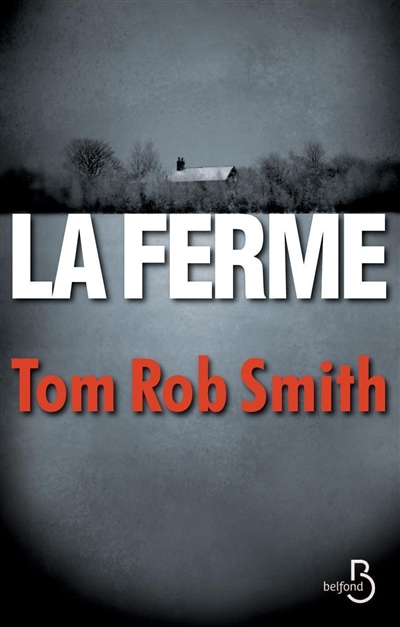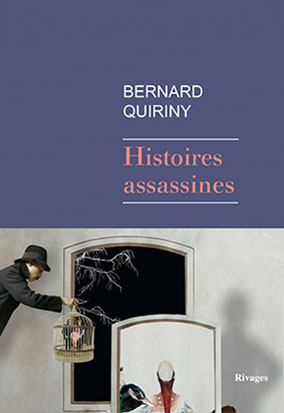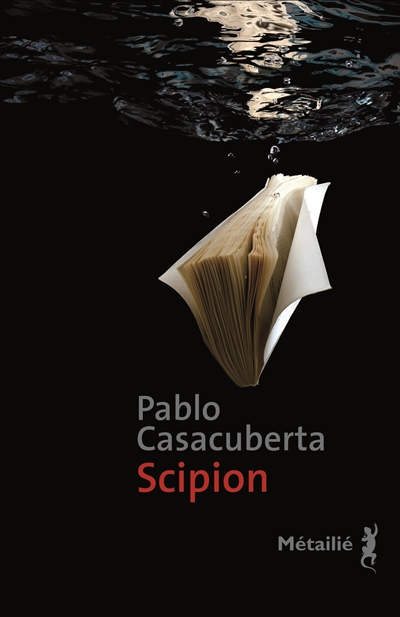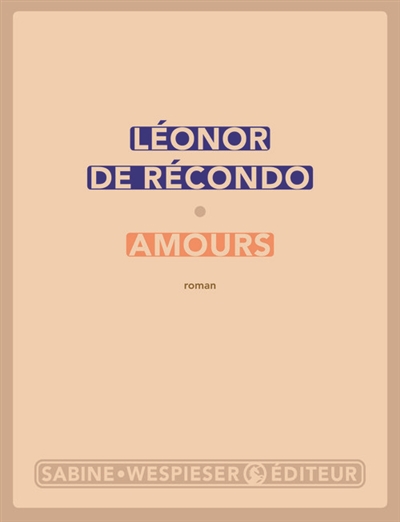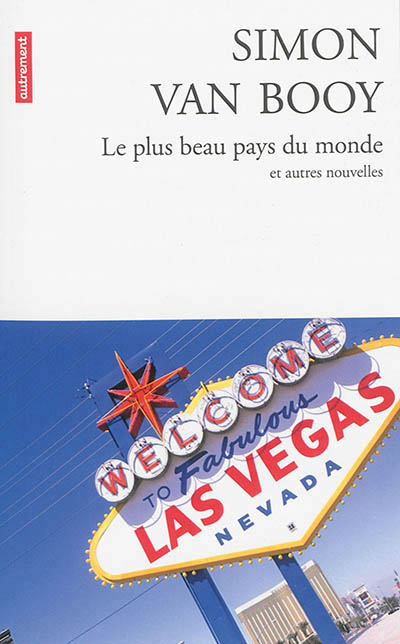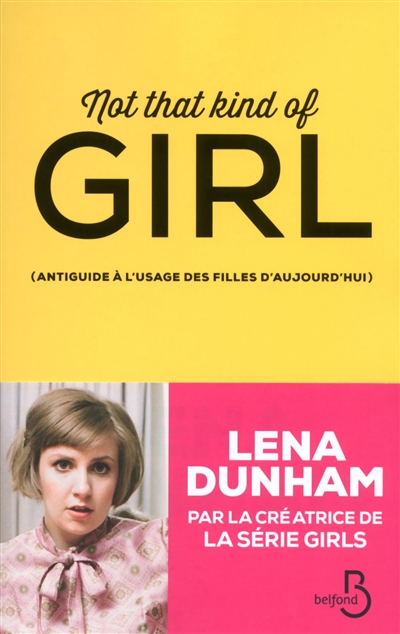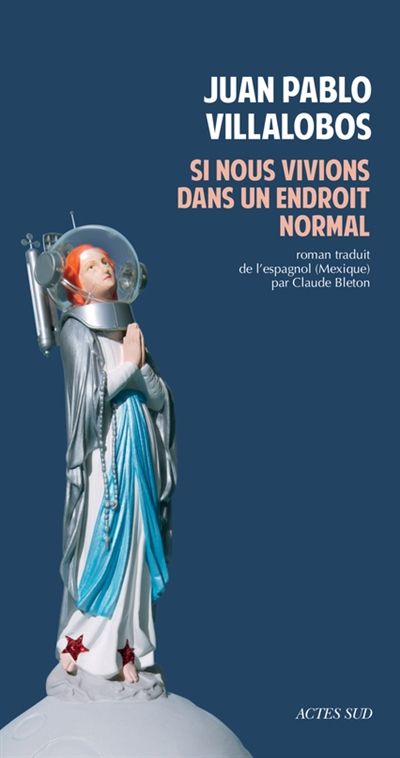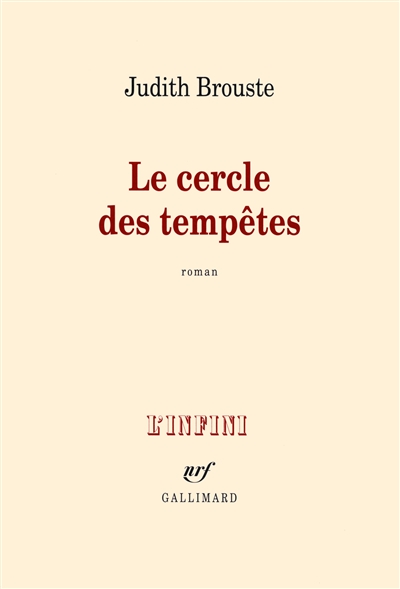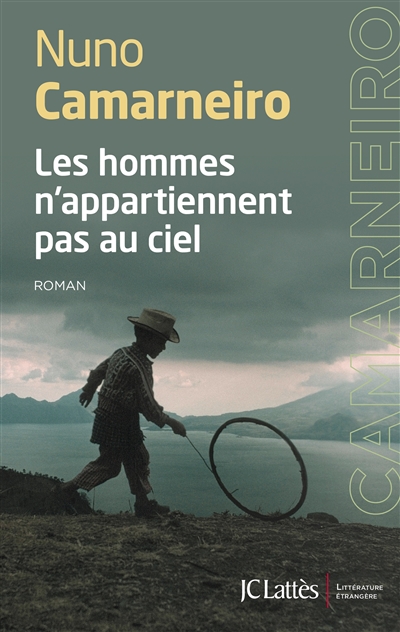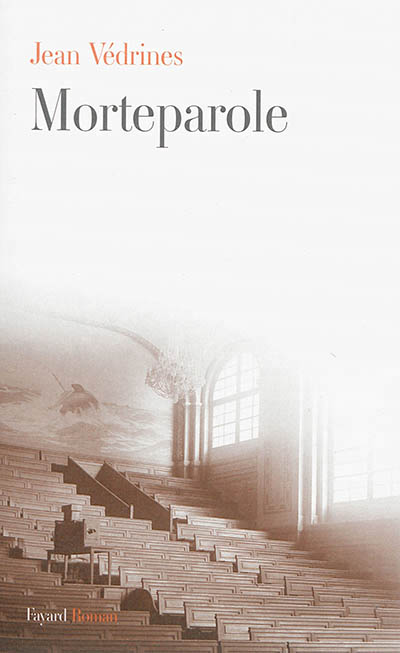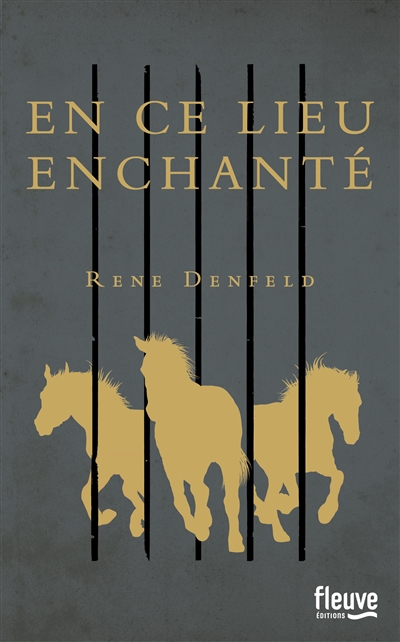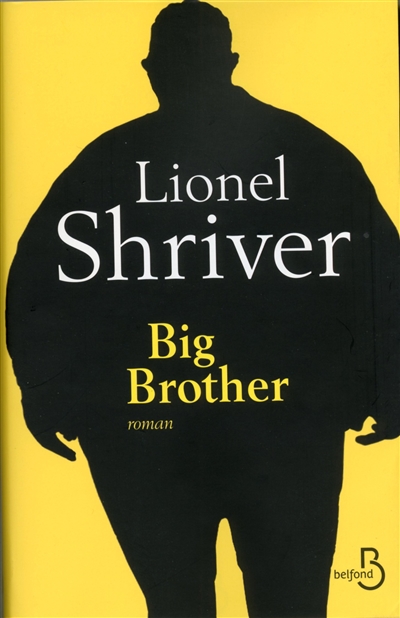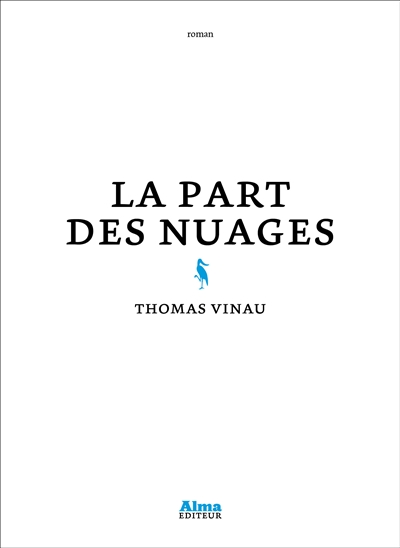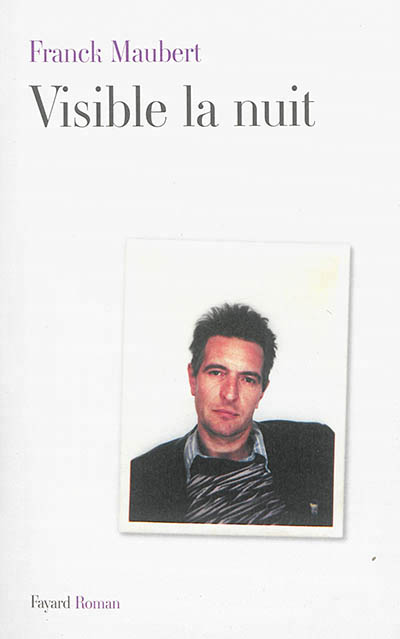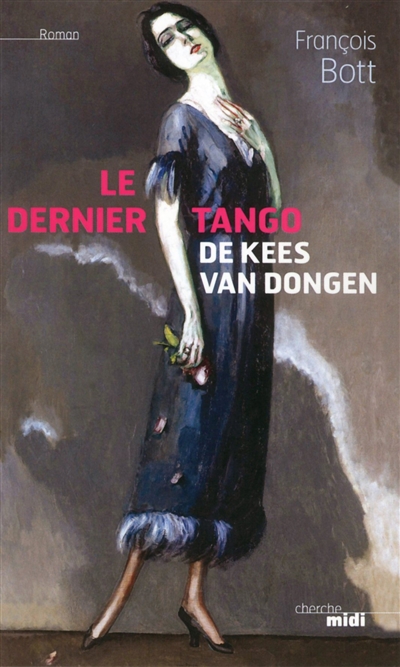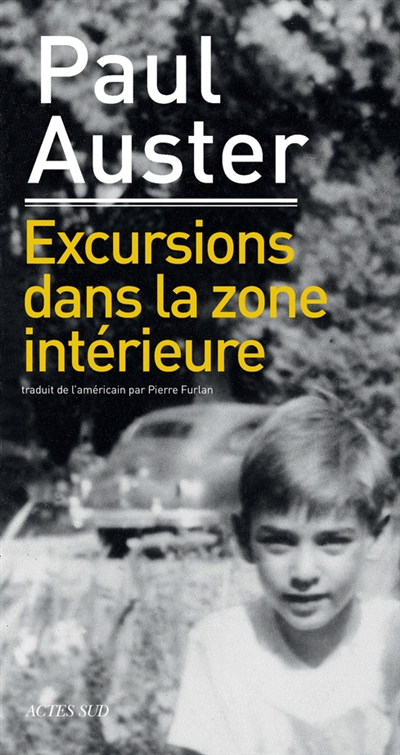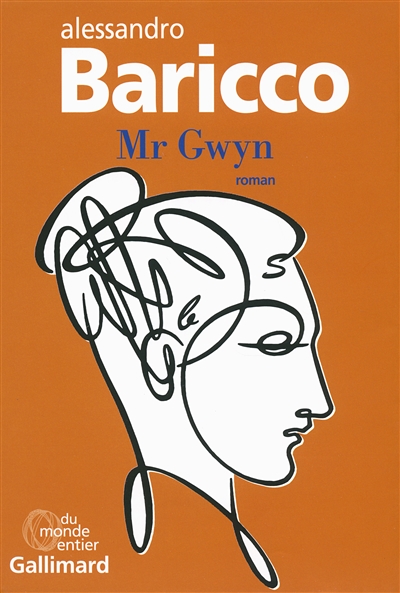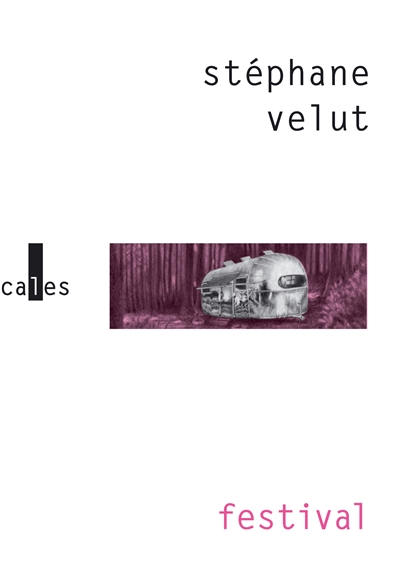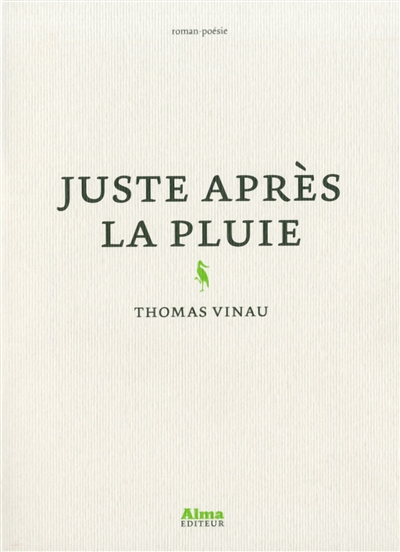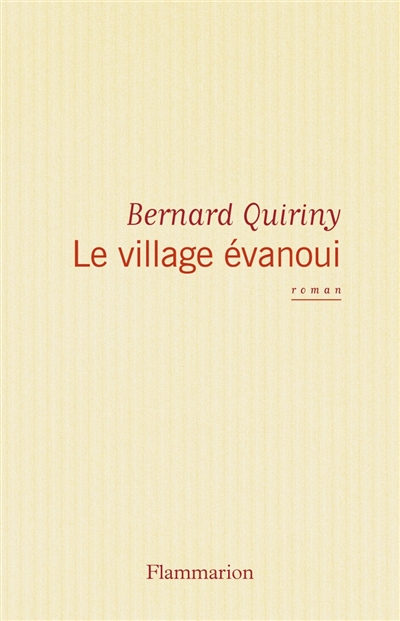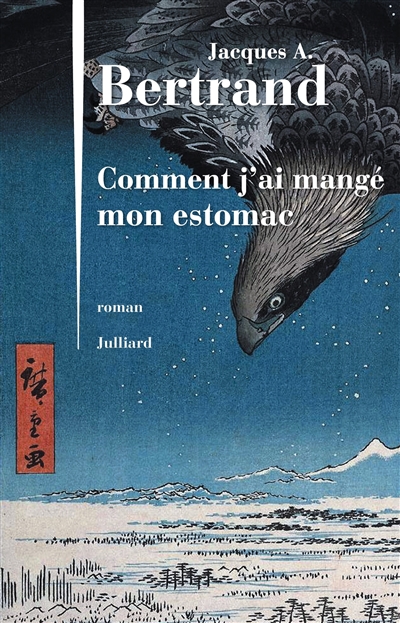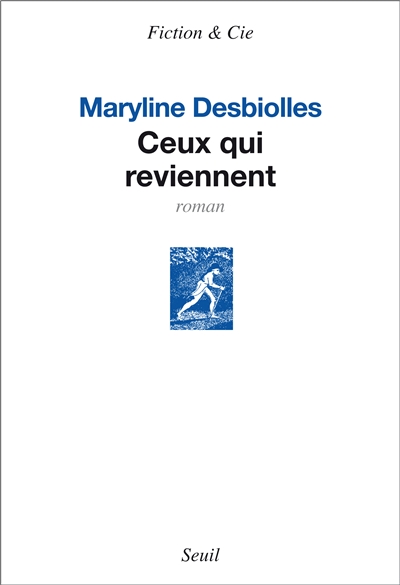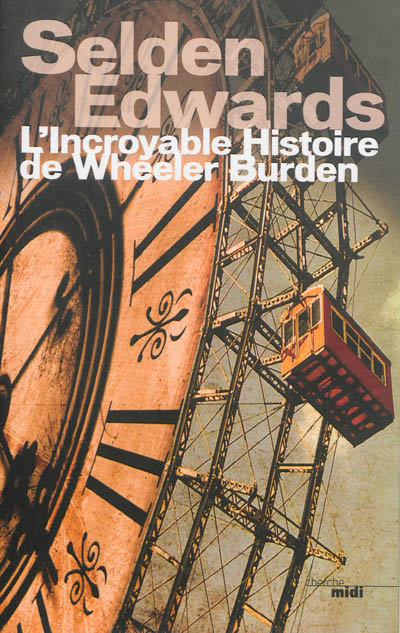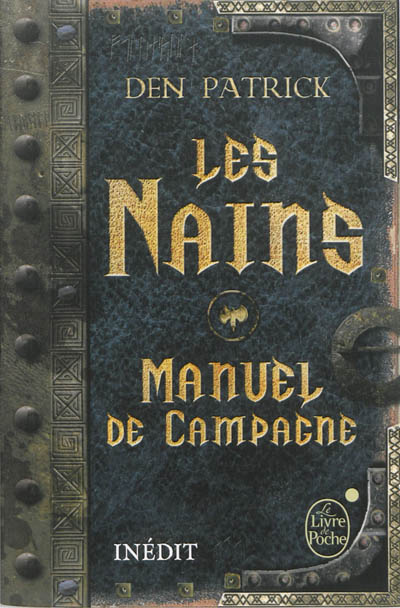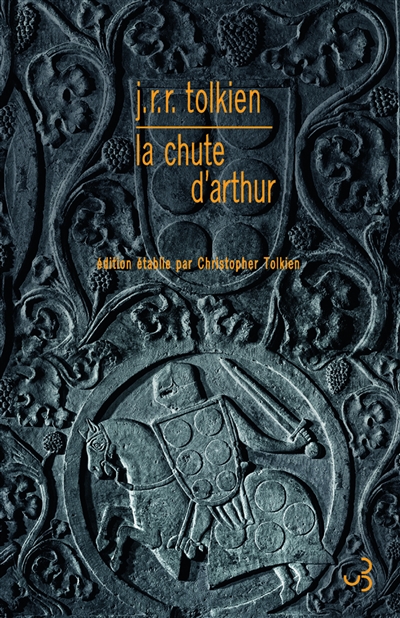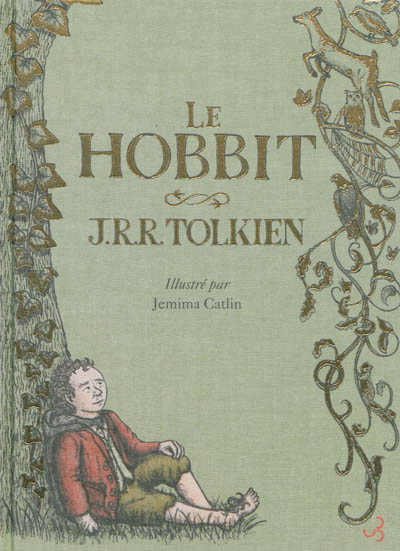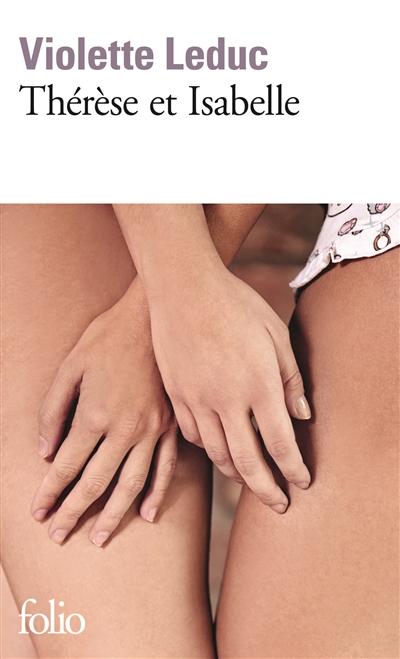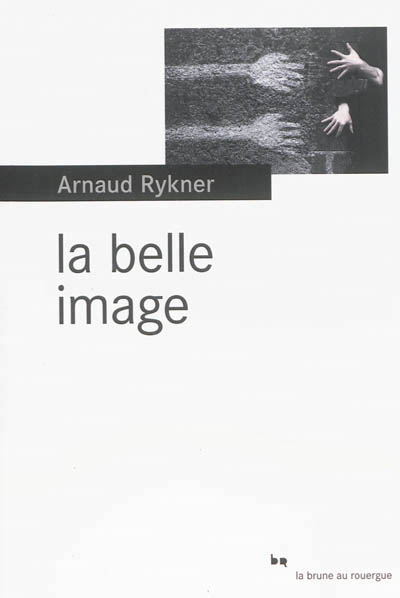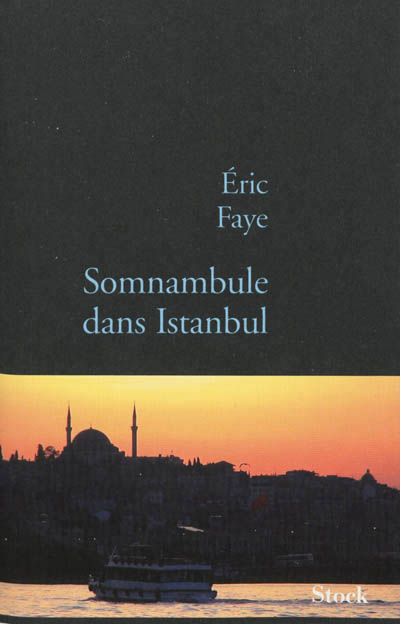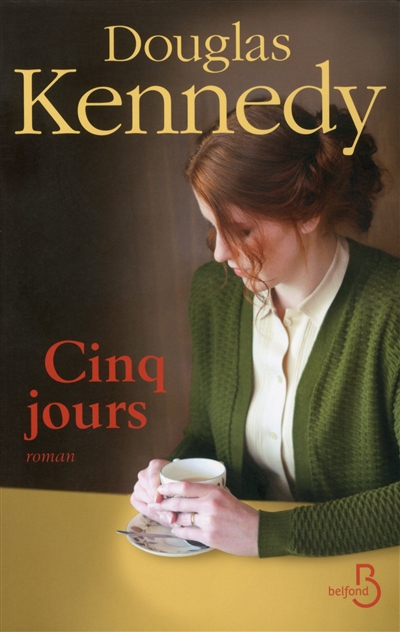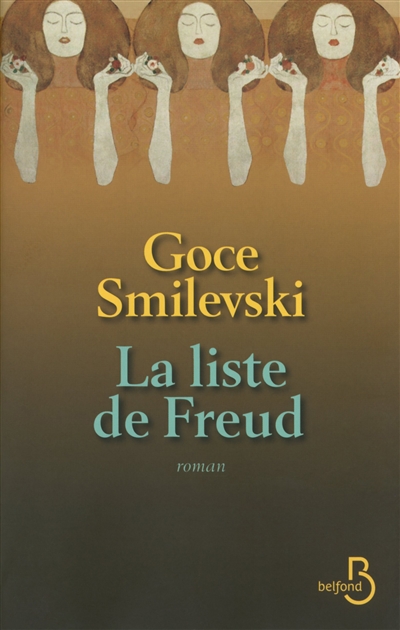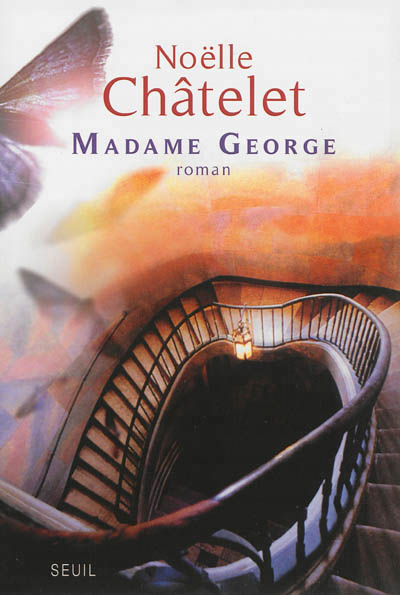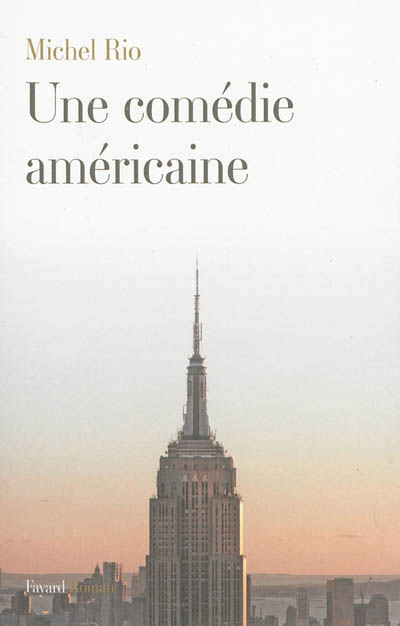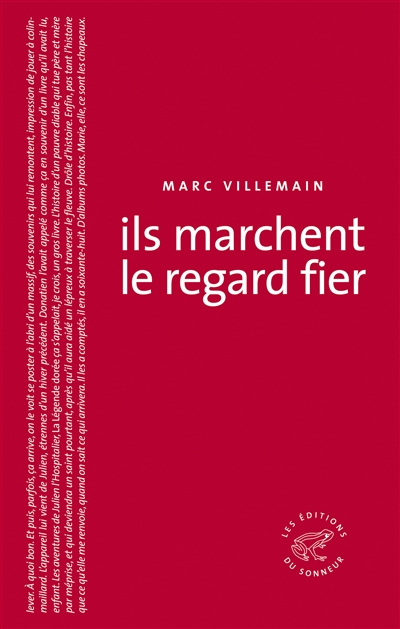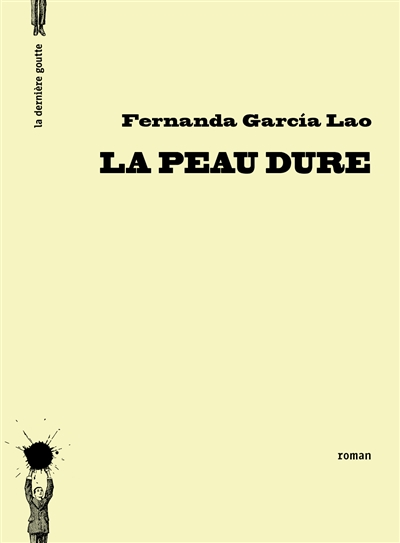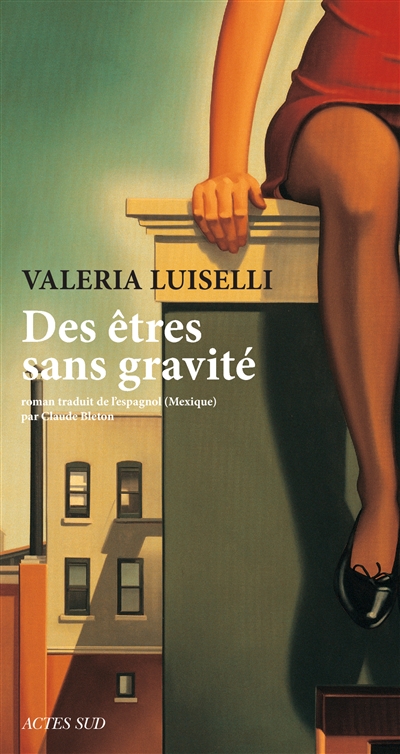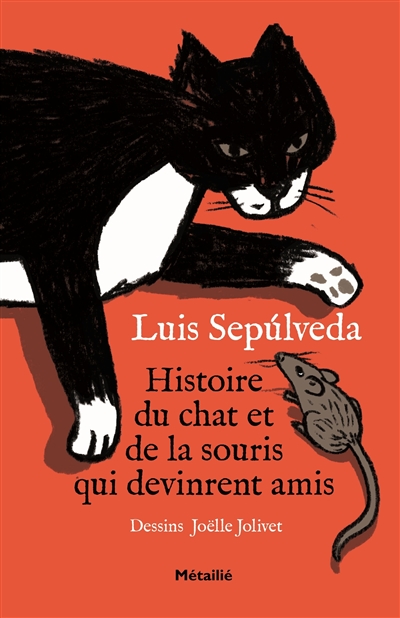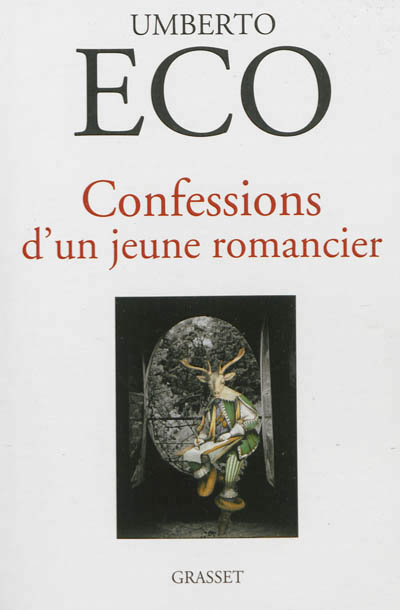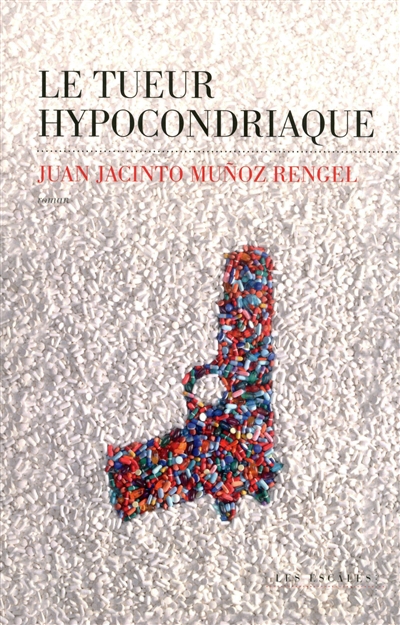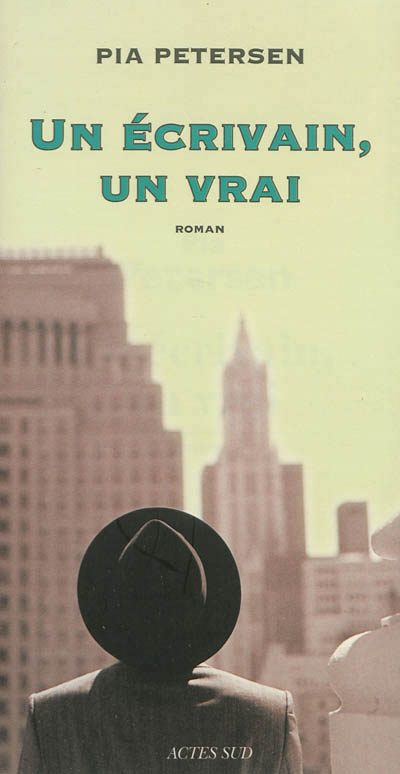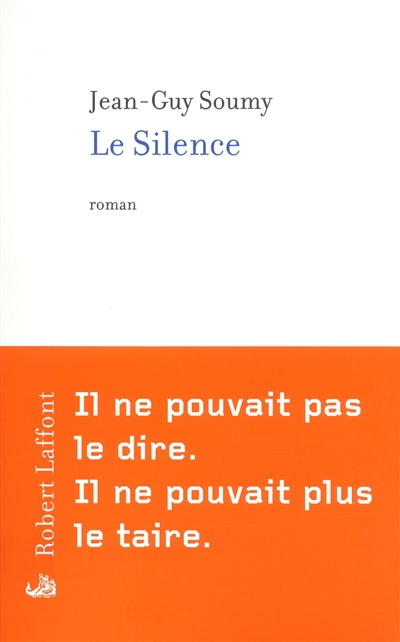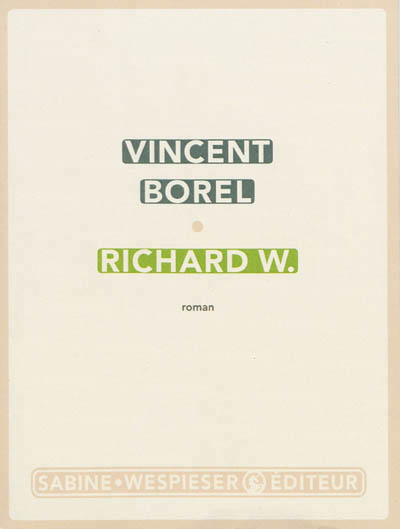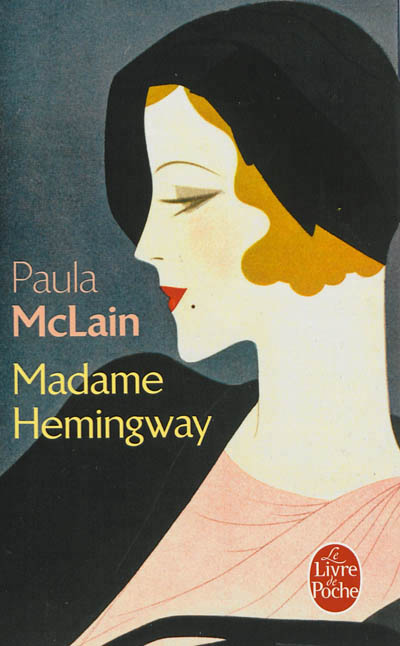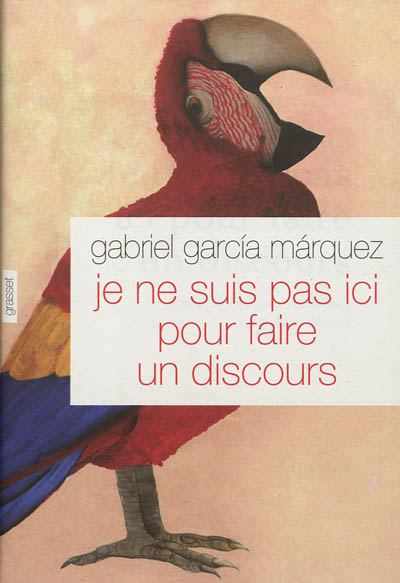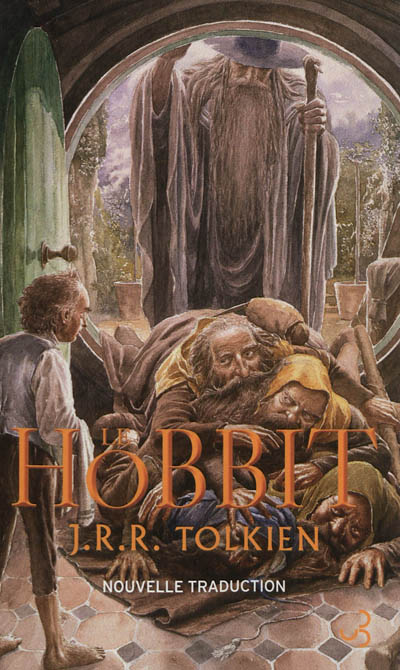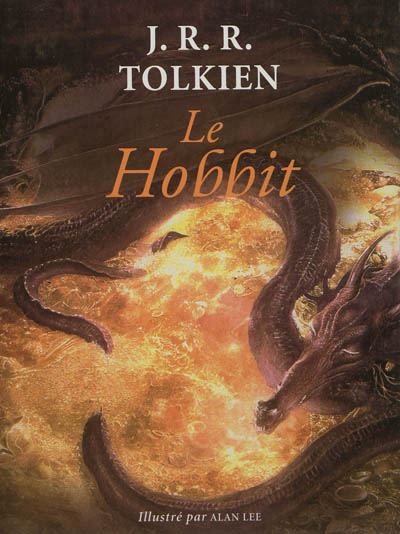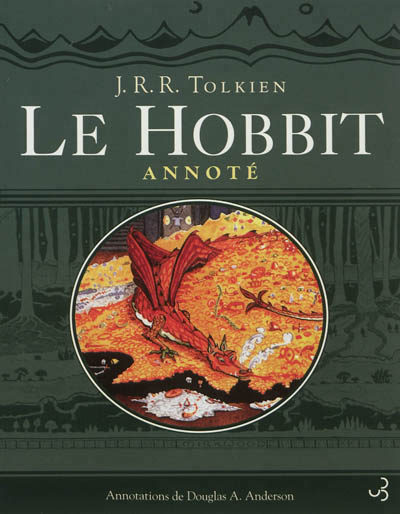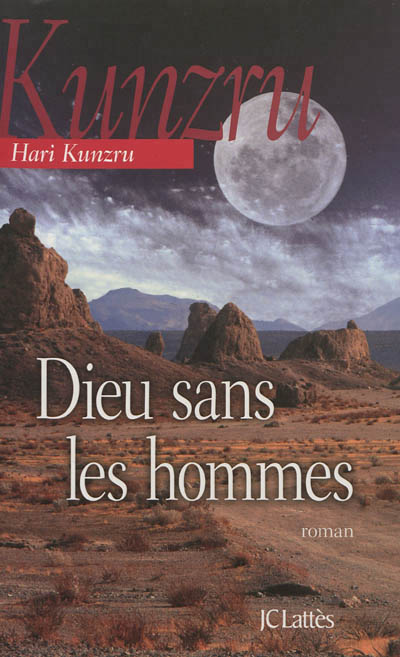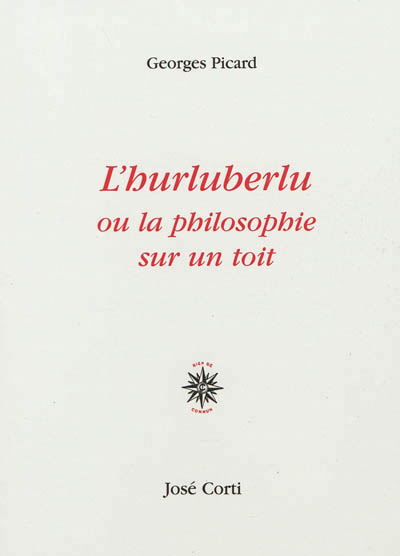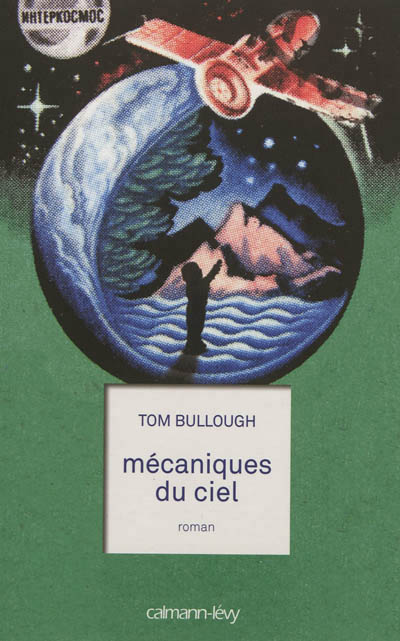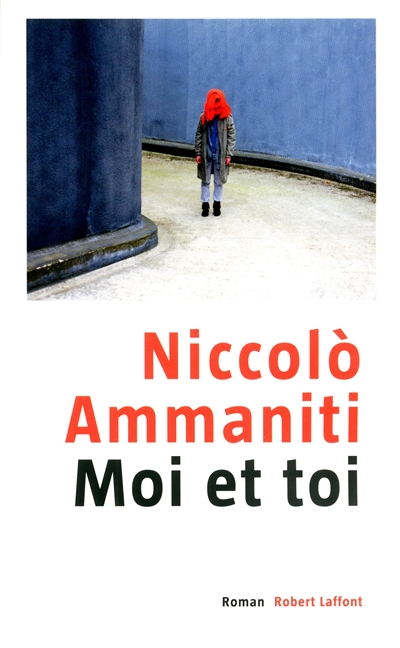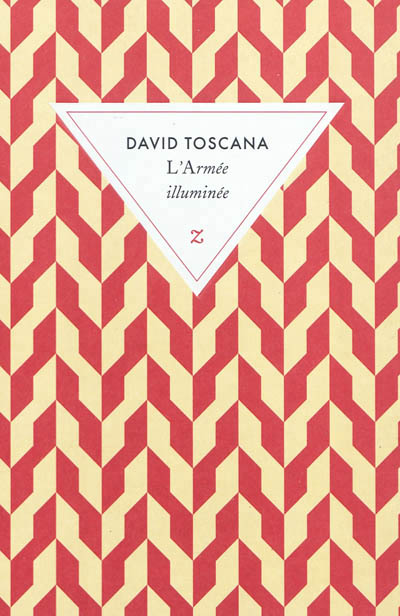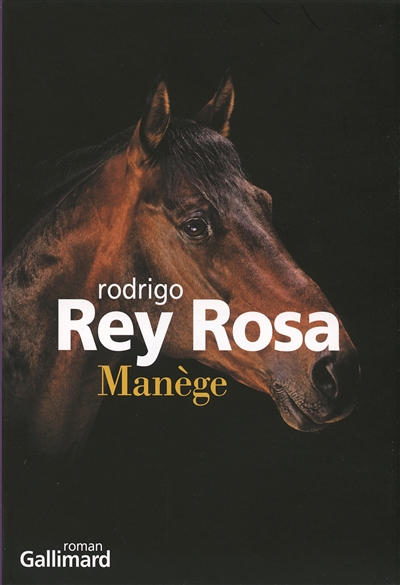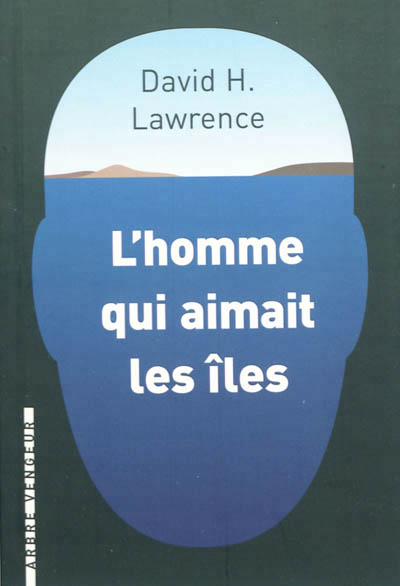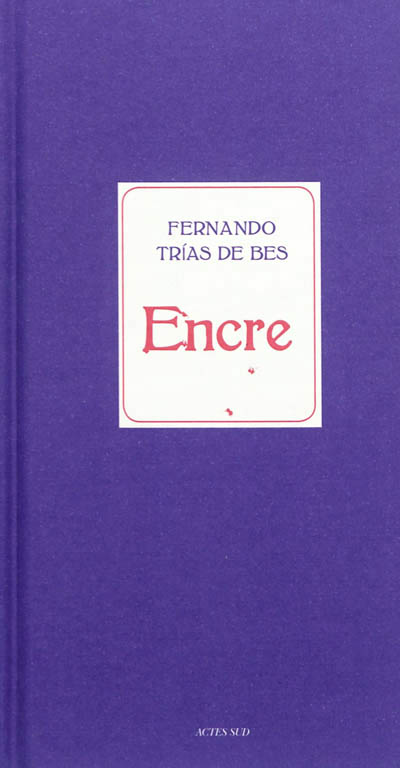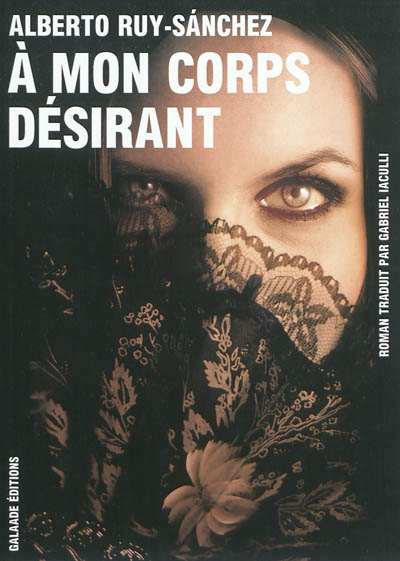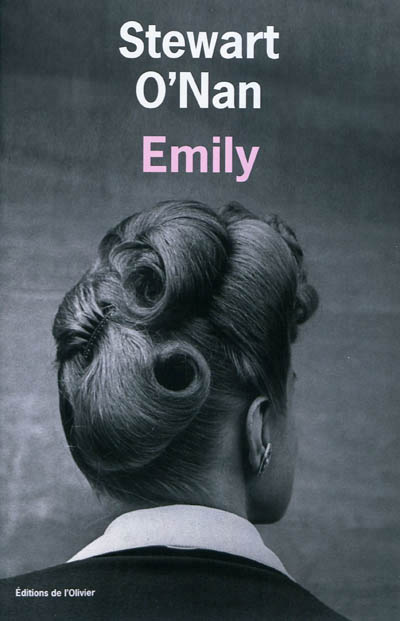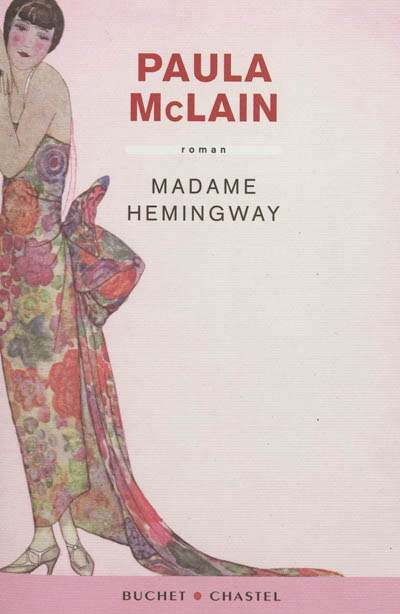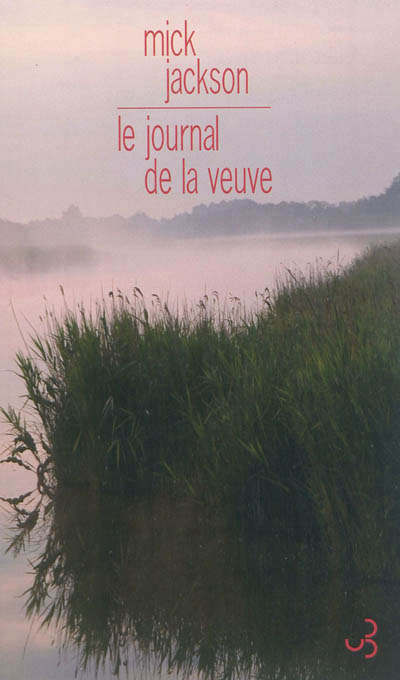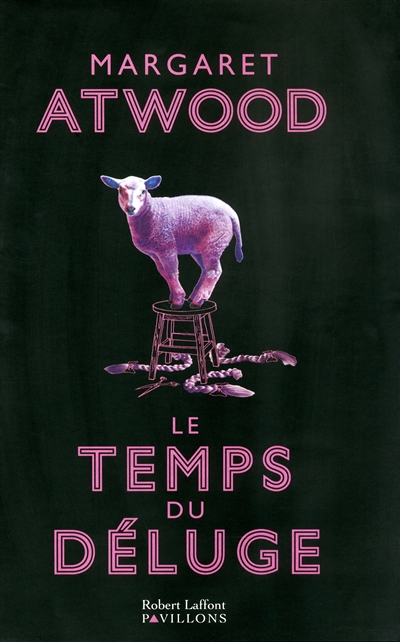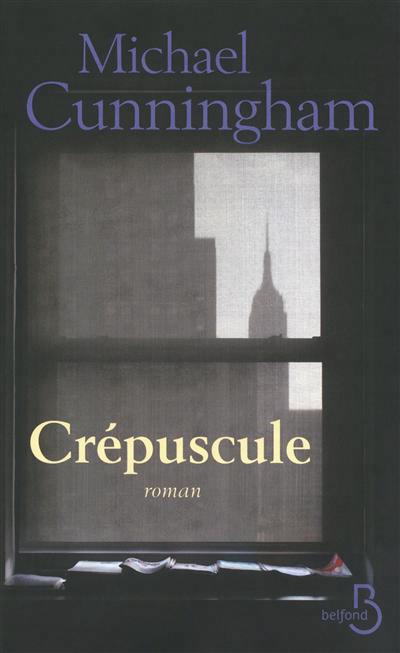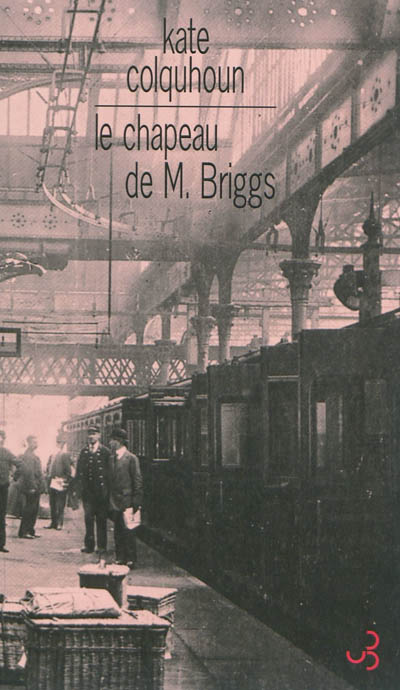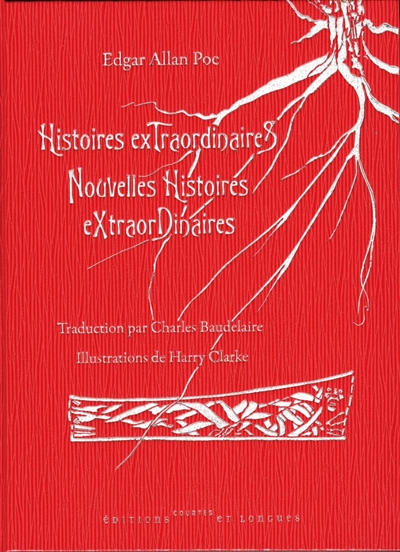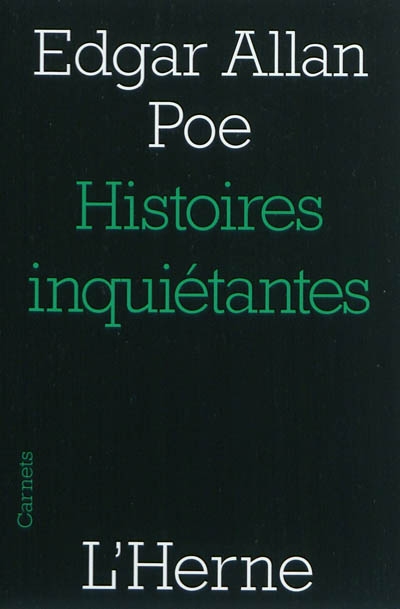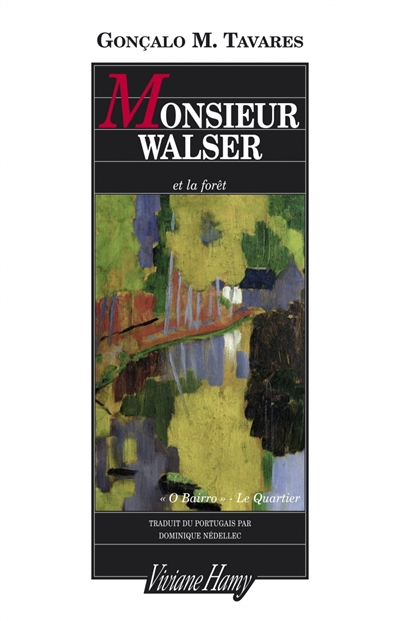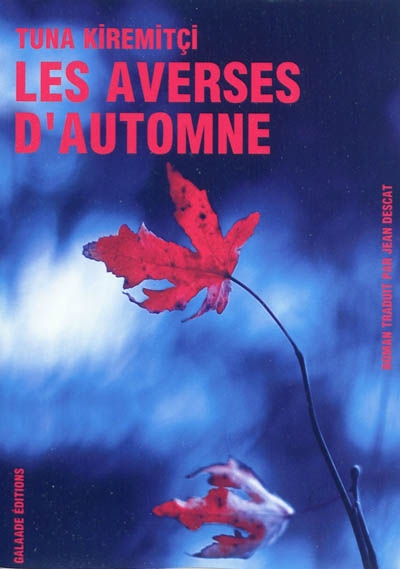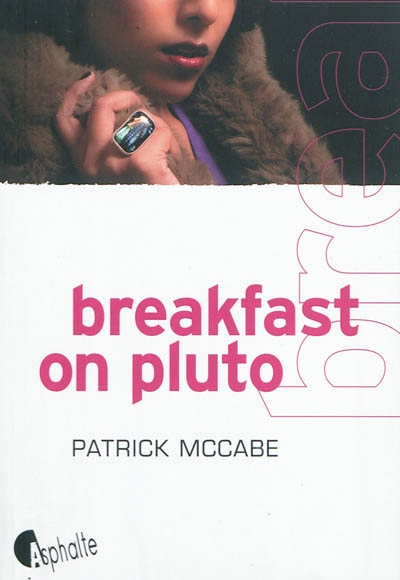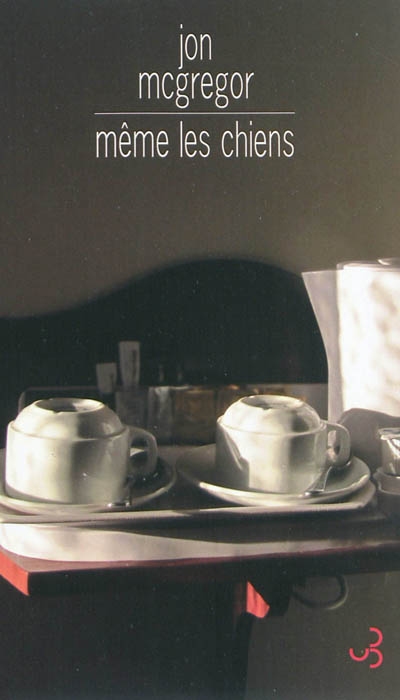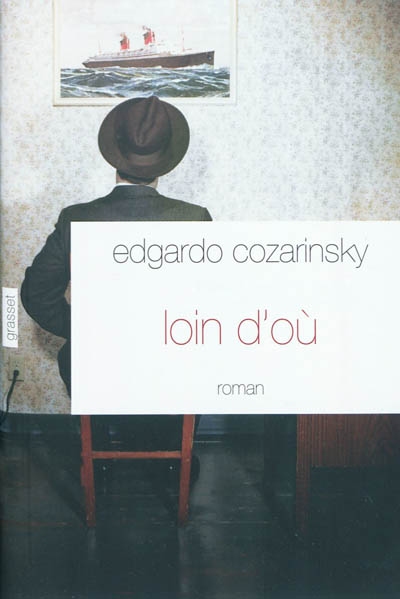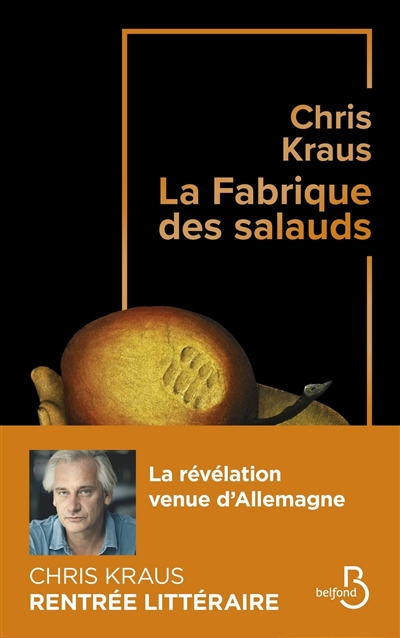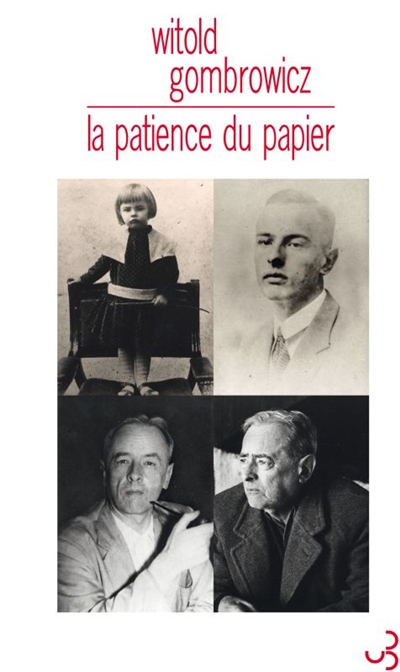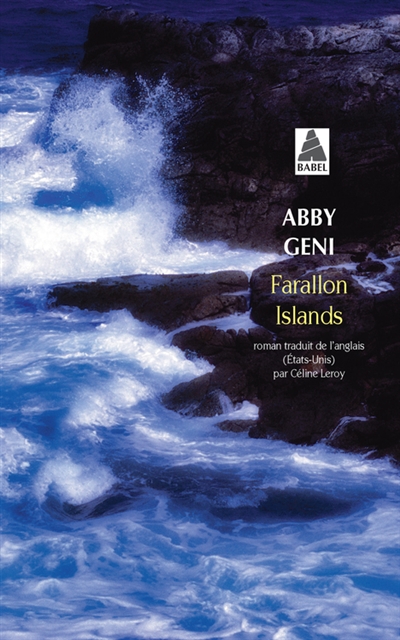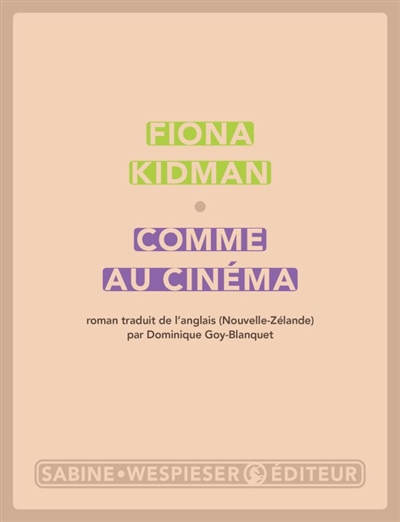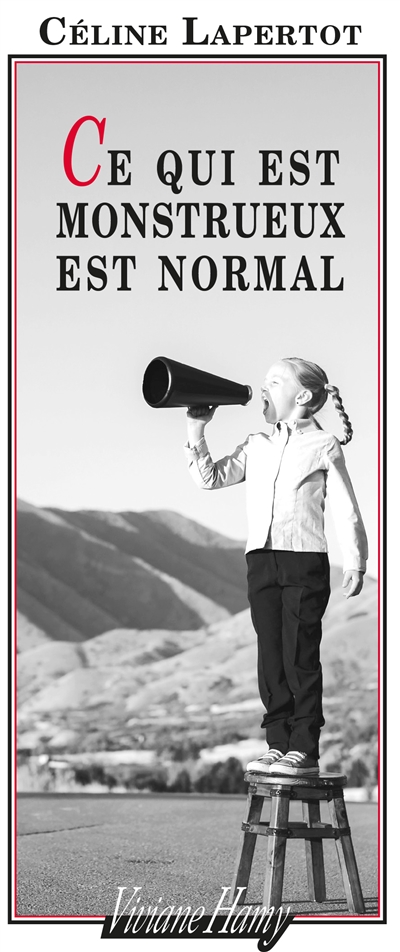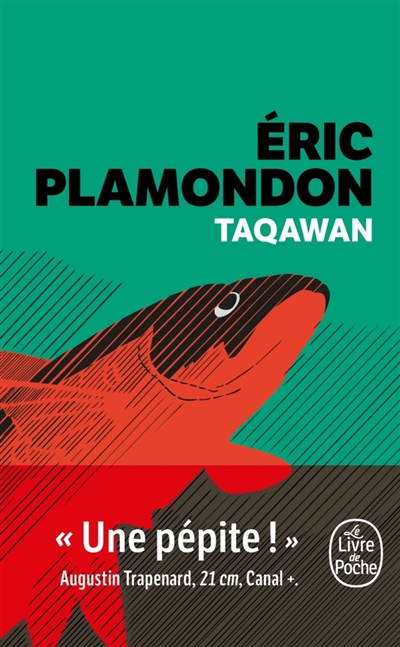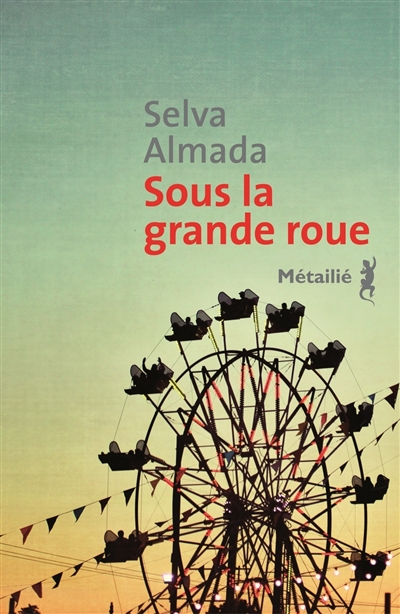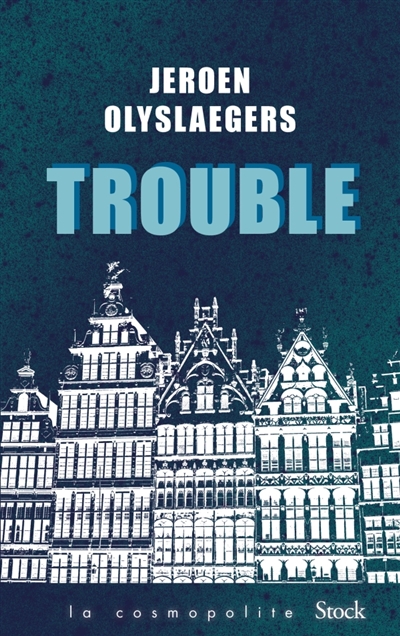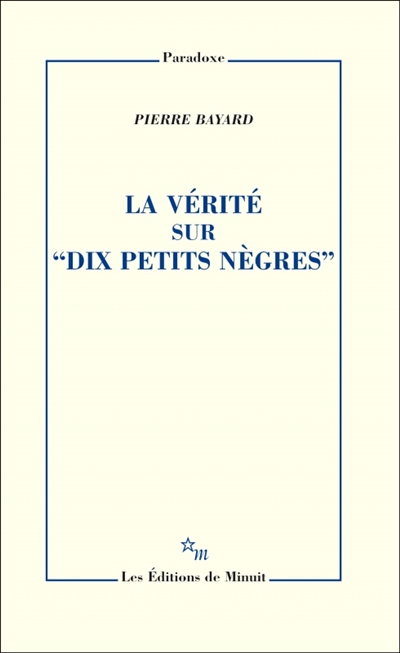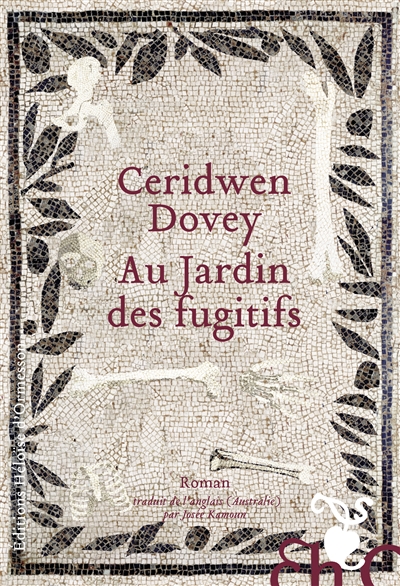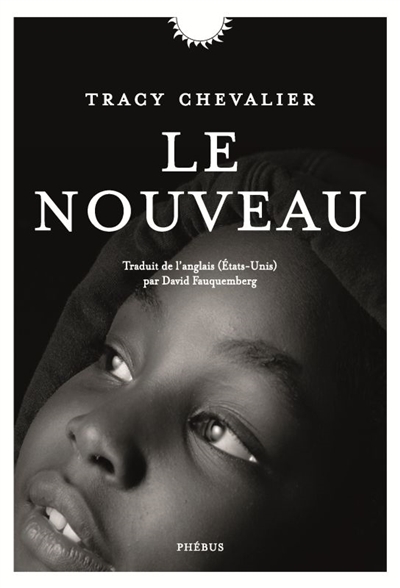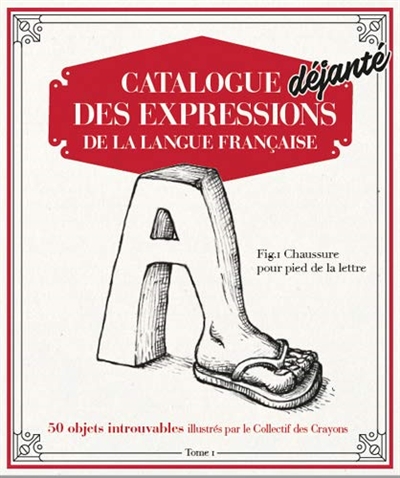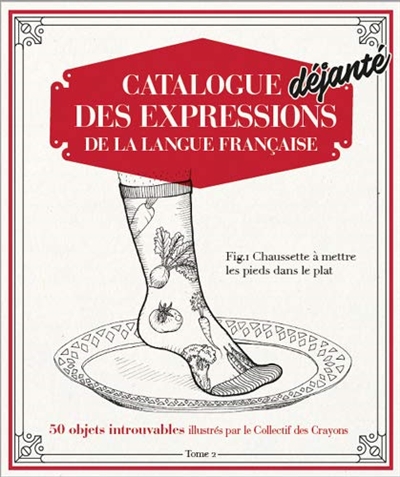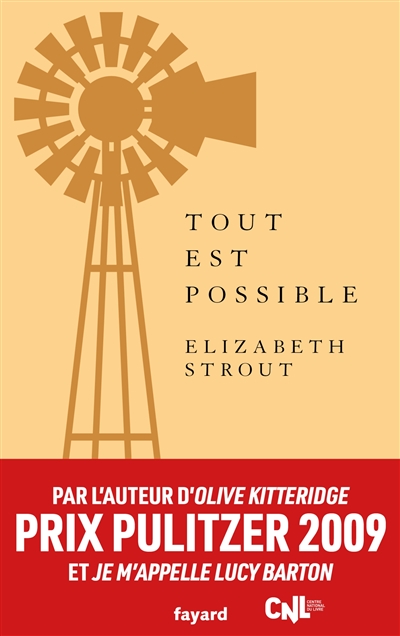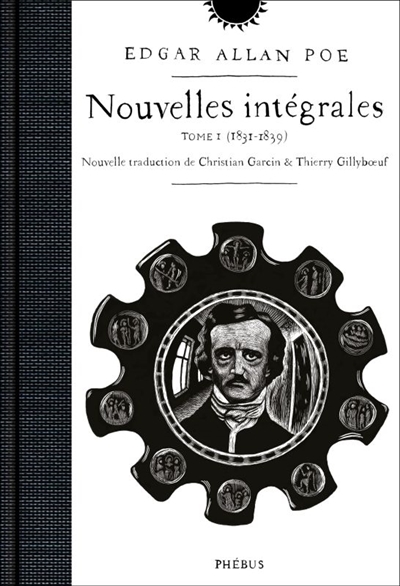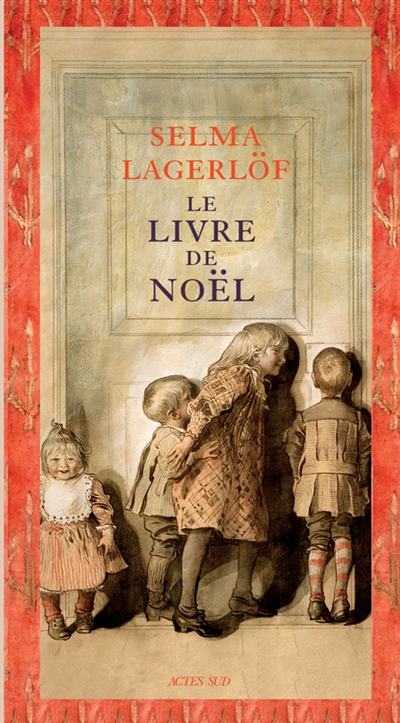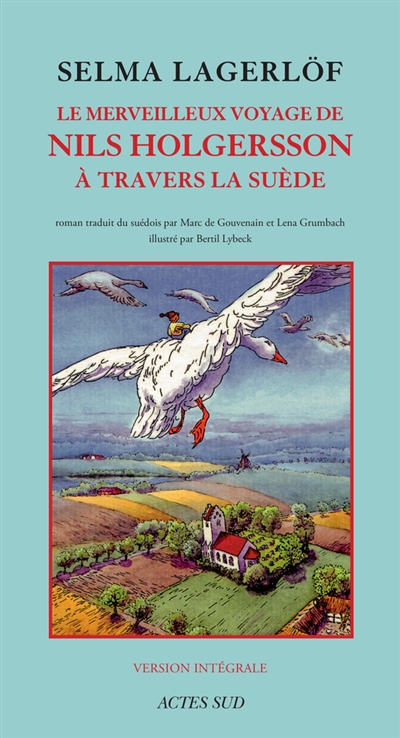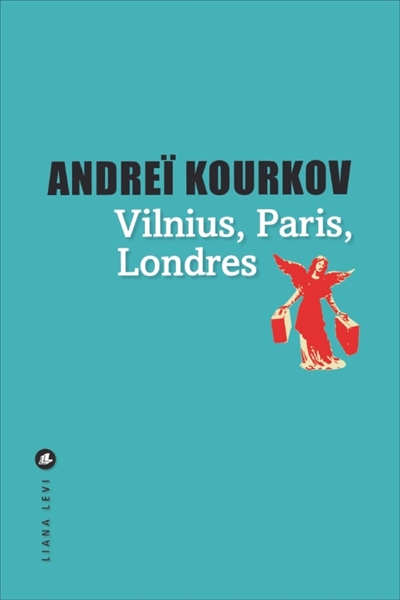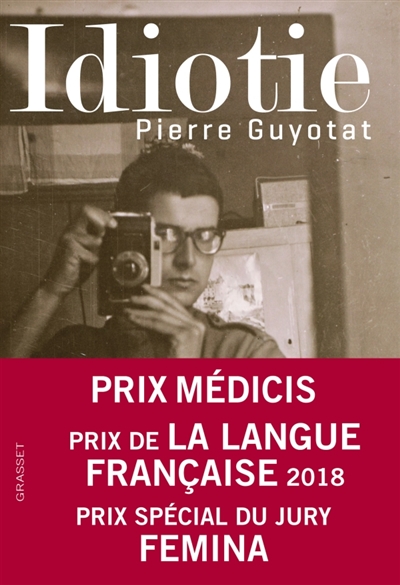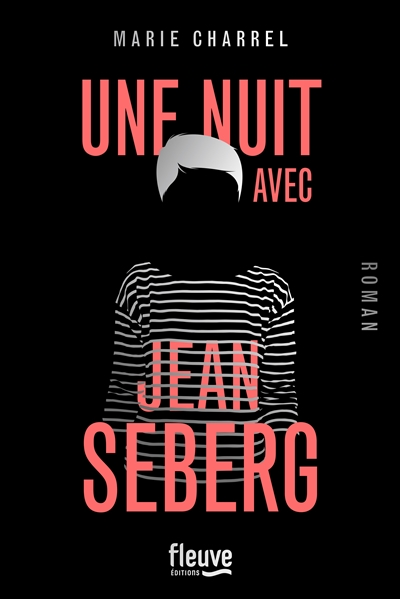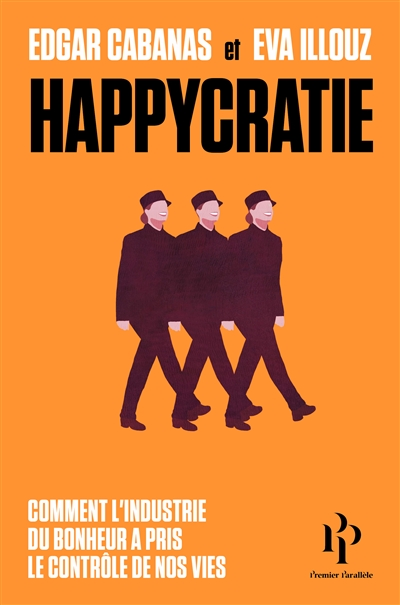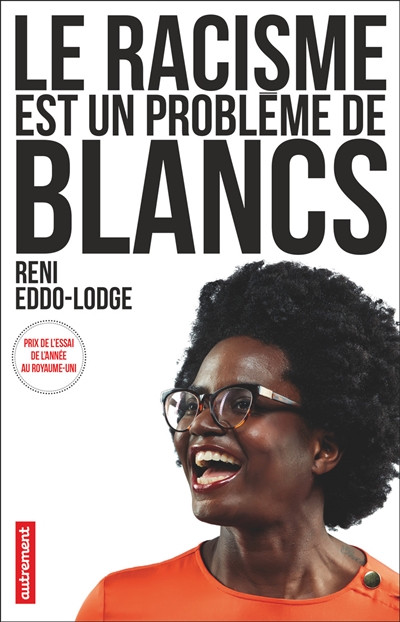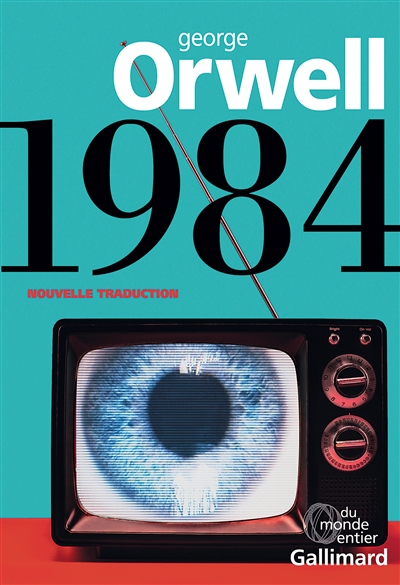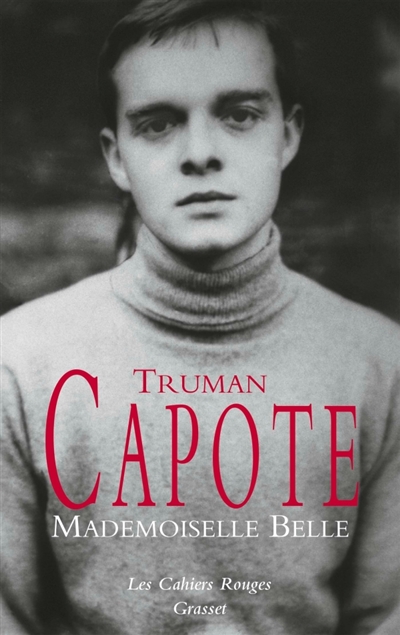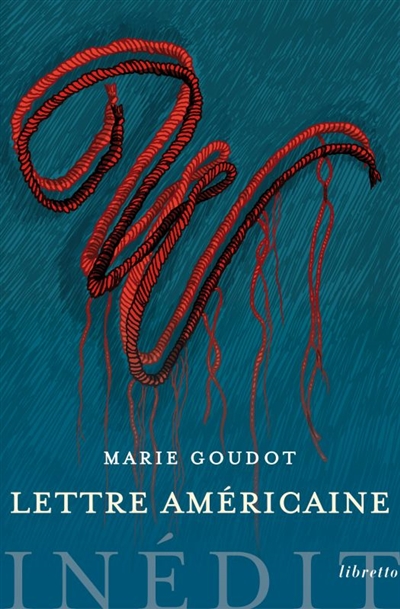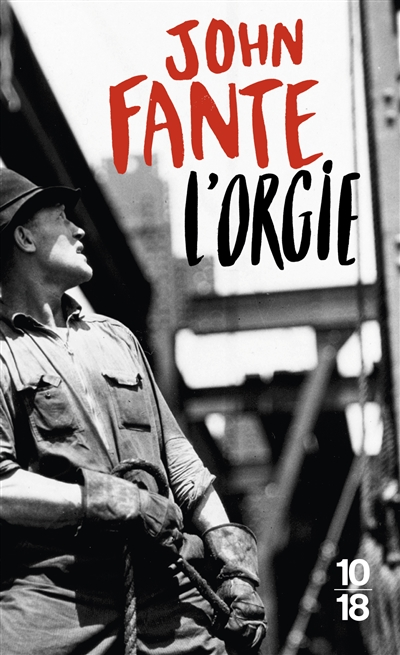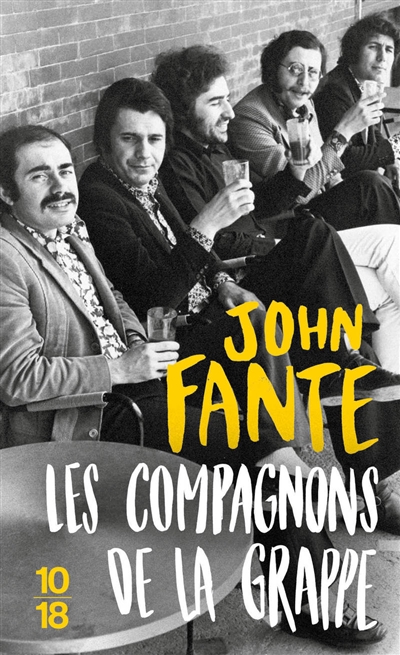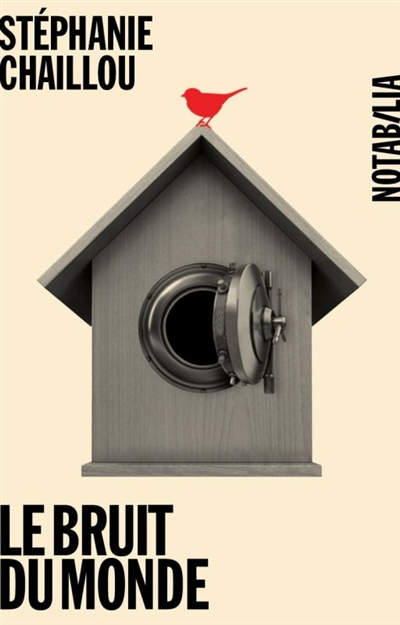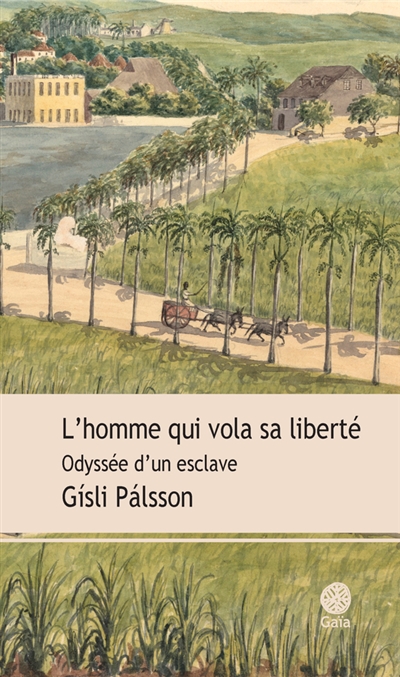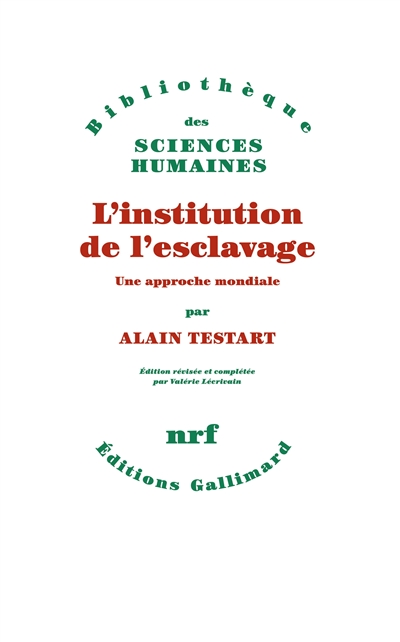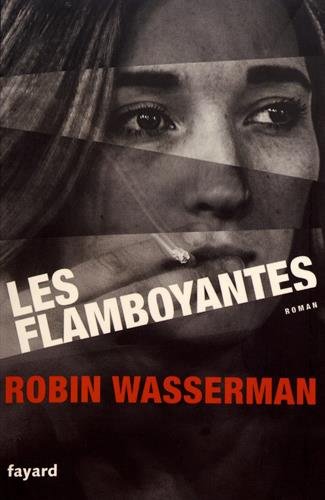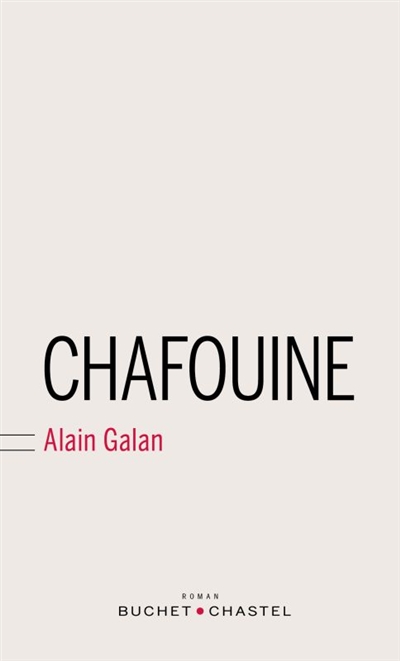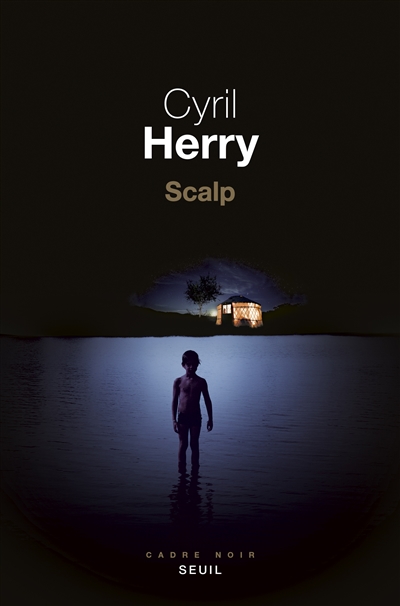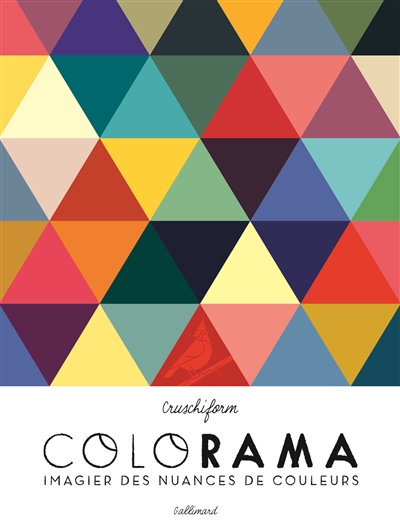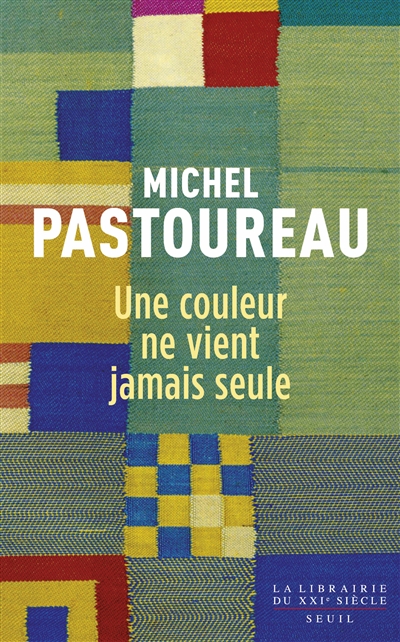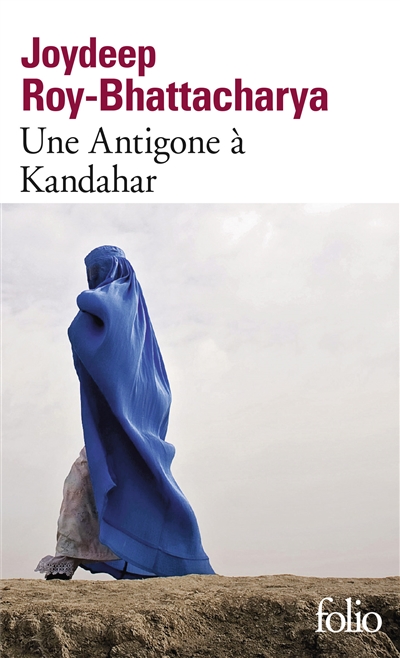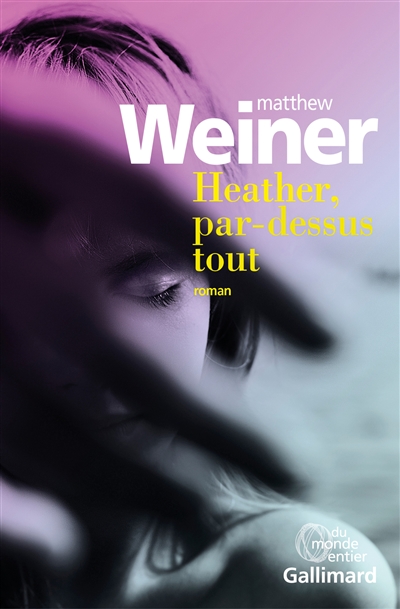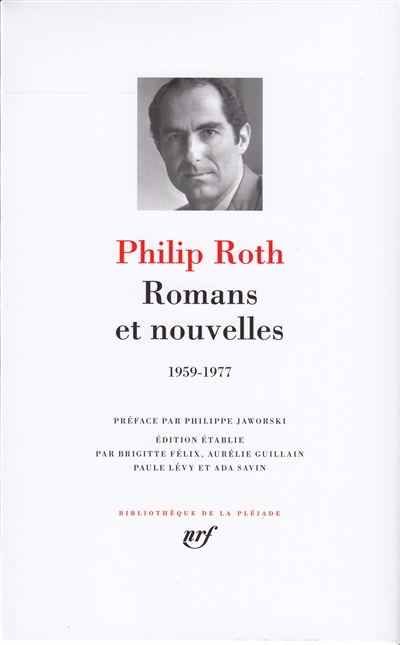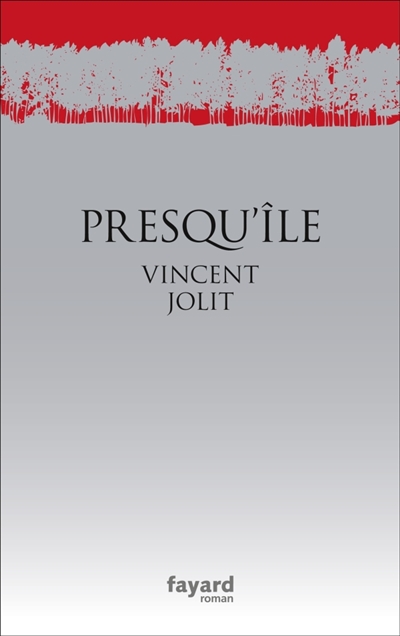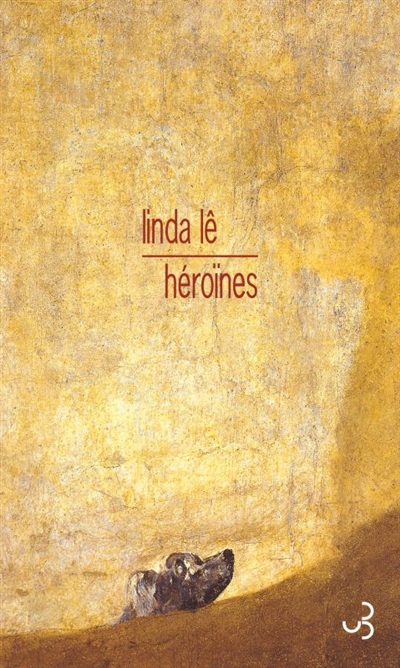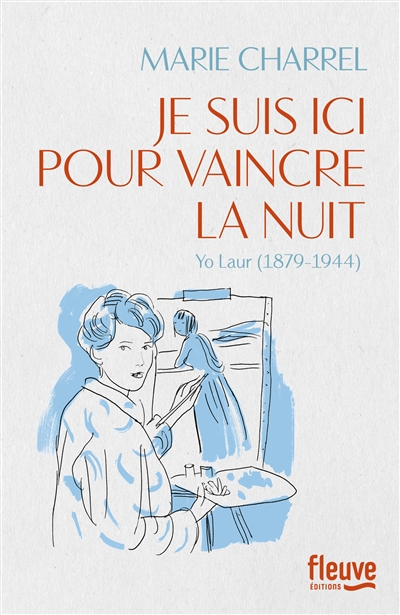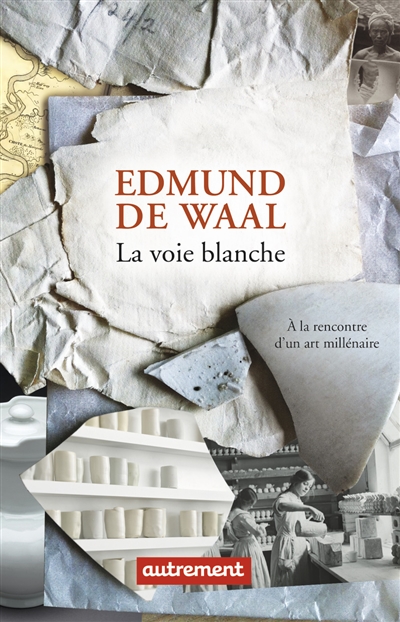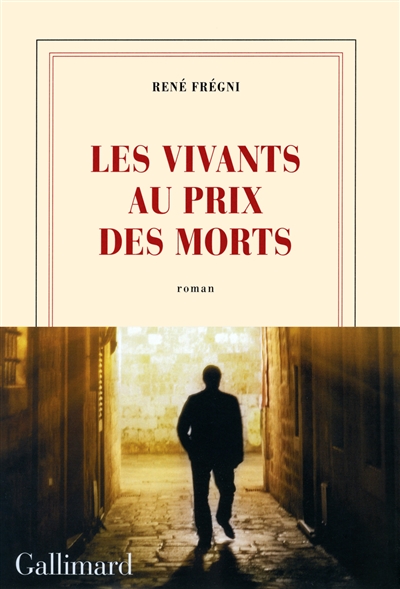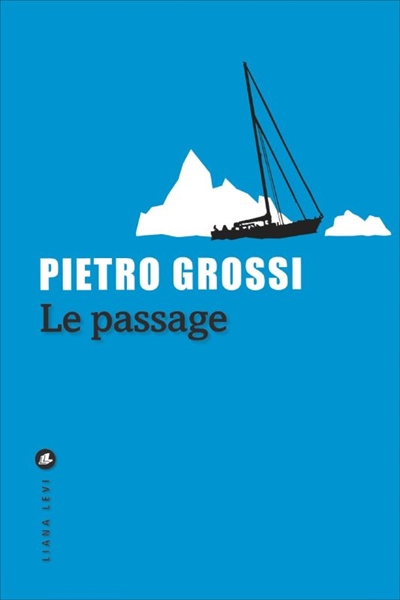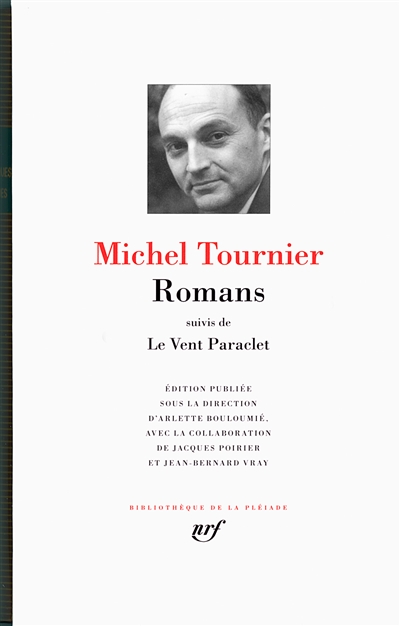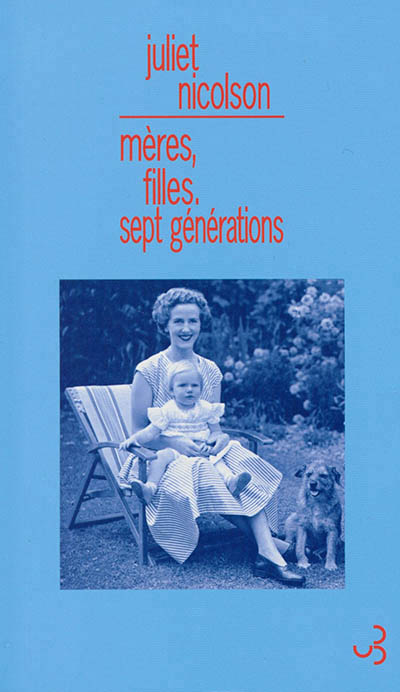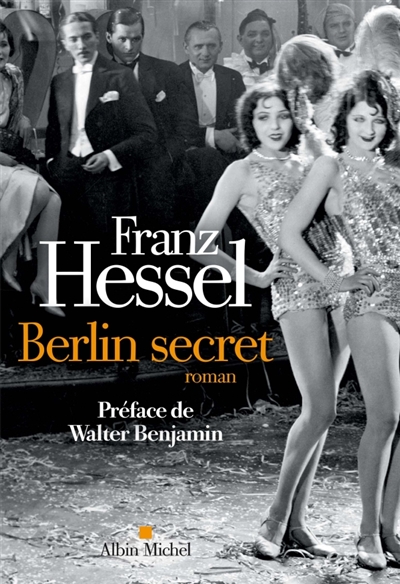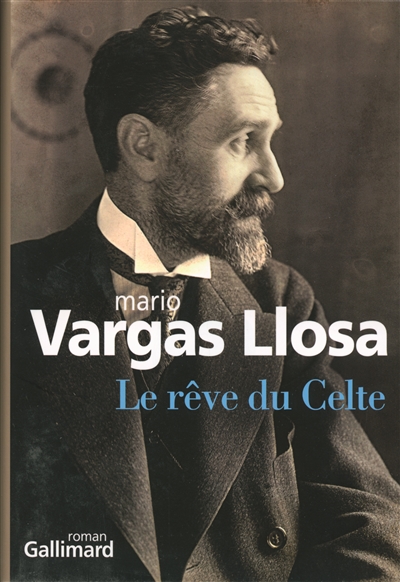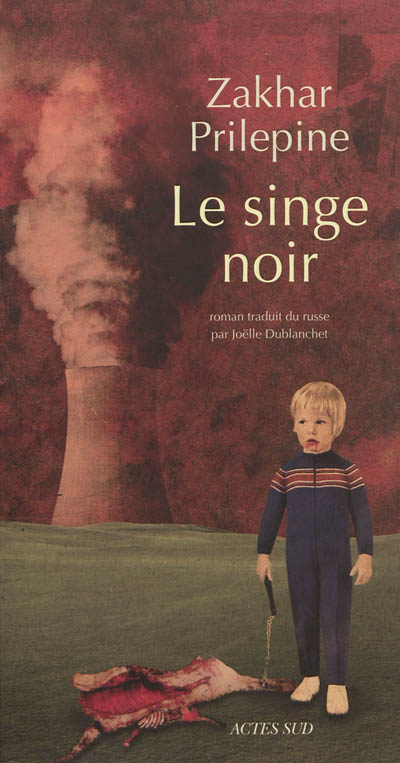Littérature française
Louis-Philippe Dalembert
Avant que les ombres s’effacent

Partager la chronique
-
Louis-Philippe Dalembert
Sabine Wespieser éditeur
02/03/2017
290 p., 21 €
-
Chronique de
Aurélie Janssens
Librairie Page et Plume (Limoges) -
Lu & conseillé par
26 libraire(s)


Chronique de Aurélie Janssens
Librairie Page et Plume (Limoges)
Louis-Philippe Dalembert est né à Port-au-Prince. Si ses professions l’amènent aujourd’hui à parcourir le monde, c’est un épisode de l’Histoire d’Haïti qu’il nous livre dans son dernier roman. Un épisode assez méconnu qui a pourtant marqué l’Histoire mondiale, à travers le parcours d’un homme, le docteur Ruben Schwartzberg de Łodź à Haïti.
Première sélection du Prix Médicis 2017
PAGE — Vous venez de recevoir le prix France Bleu/ Page des libraires. Quelle fut votre réaction en l’apprenant ?
Louis-Philippe Dalembert — Pendant les minutes qui ont suivi l’appel de Sabine, mon éditrice, j’étais sur un petit nuage. C’est la première récompense pour ce roman, en lice pour plusieurs prix. Je me suis dit que c’était peut-être un signe, qu’il y en aurait d’autres. Pour moi, c’est le plus beau de tous, car il est décerné par un acteur majeur de la chaîne du livre, des libraires indépendants, et par le plus important réseau de radios publiques françaises. Que du bonheur !
P. — Dans ce roman, vous traitez d’un épisode de l’Histoire fortement méconnu (du moins en France) : la déclaration de guerre d’Haïti à l’Allemagne et l’Italie pendant la Seconde Guerre mondiale et l’accueil sur son sol de nombreux réfugiés, juifs essentiellement. Pourquoi pensez-vous que cet épisode soit aussi méconnu aujourd’hui ?
L.-P. D. — Vous avez oublié le Japon. Mais la déclaration de guerre à l’Allemagne est celle dont les Haïtiens tirent le plus de fierté. À l’époque, le pays comptait moins de 3 000 000 d’habitants. Ce qui ne l’a pas empêché, à travers plusieurs de ses natifs, de prendre part au combat sur le terrain. C’est le cas du commandant Kieffer, né et élevé en Haïti par un père alsacien, et qui a participé au débarquement de Normandie. En revanche, l’accueil de réfugiés juifs en Haïti est moins connu. Le pays, par son histoire, a une longue tradition d’accueil et une grande capacité à faire des nouveaux venus des citoyens comme les autres. Ensuite, les réfugiés juifs eux-mêmes, comme la plupart de ceux qui ont échappé à cette horreur, n’en ont pas beaucoup parlé. D’où ce roman, pour donner à connaître cet épisode de l’Histoire, avant qu’il ne soit complètement oublié.
P. — Vous racontez l’histoire d’un homme, le docteur Ruben Schwartzberg, né en Pologne, arrivé pendant la guerre à Port-au-Prince. Cette histoire s’inspire-t-elle d’un homme en particulier (le docteur a-t-il réellement existé) ou d’une somme d’histoires ?
L.-P. D. — Plutôt d’une somme d’histoires, plus ou moins proches de moi. Et aussi d’obsessions personnelles, présentes dans d’autres de mes romans : les déplacements, forcés ou par choix, d’individus ou de groupes d’individus ; la main tendue, ou pas, sur les terres d’accueil, la grande Histoire, etc.
P. — Vous avez choisi de ne pas focaliser essentiellement l’histoire de ce docteur sur son exil loin de l’Europe, mais de la raconter de manière plus ample, décrivant aussi ce que fut sa vie après sur l’île. Pourquoi avoir fait ce choix ?
L.-P. D. — Je voulais que le personnage « découvre » le pays où il mettait les pieds. Je ne pouvais le faire qu’à travers un regard « extérieur », lucide sur la réalité, en même temps plein d’empathie, de tendresse pour cette terre qui était en train de devenir sienne. Je voulais aussi montrer qu’il y a une vie après l’horreur. Que l’être humain est aussi capable du « meilleur ».
P. — Il y a dans votre roman beaucoup d’humour, un ton auquel nous ne sommes pas forcément habitués lorsqu’il est question de ces sujets. D’où puisez-vous ce recul et cet humour ?
L.-P. D. — De la distance dans le temps et dans l’espace. Au moment où il se décide enfin à raconter son histoire, le docteur Schwartzberg tutoie le siècle et vit depuis longtemps loin, géographiquement, de toute cette horreur. De l’humour dit « juif » aussi, dont le personnage est imprégné. Son oncle Joshua, avec lequel il a grandi et qui le suivra en Haïti, en était un grand amateur. Cette forme d’autodérision est également très présente dans la culture haïtienne.
P. — Ce roman s’inscrit dans un temps donné mais il fait aussi tristement écho à des situations que nous continuons à vivre aujourd’hui : la position des États quant à l’accueil des réfugiés. Aviez-vous cela en tête lorsque vous avez choisi de raconter cette histoire ?
L.-P. D. — Bien sûr. Ce n’est pas par hasard si j’y ai inséré l’épisode du Saint Louis, ce bateau avec à son bord un millier de réfugiés juifs dont personne, en 1939, ne voulait : ni Cuba, ni les États-Unis, ni le Canada. Le refoulement en Allemagne équivalait pour eux à une mort certaine. Imaginez l’angoisse de ces gens quand le bateau a dû rebrousser chemin. Au bout du compte, quelques pays européens ont fini par se les partager. Ça ne vous rappelle rien ?
P. — On ressent une profonde humanité à la lecture de ce roman, ne croyez-vous pas que cette valeur, cette qualité, soit en voie de disparition ?
L.-P. D. — Pas du tout. Nous vivons, en Occident, une période de surmédiatisation qui s’est amplifiée avec Internet, les réseaux sociaux, les chaînes de télévision d’information en continu… Ce cirque médiatique a tendance à ne se nourrir que du négatif. Ça a fini par conditionner les gens branchés 24 heures sur 24. Partout dans le monde, il existe des hommes et des femmes attachés, individuellement ou regroupés en association, à cette valeur d’humanité. Ils tendent la main tous les jours à d’autres, parfois en courant des risques énormes. Les médias en parlent très peu. Mais cette valeur existe bel et bien. Heureusement.