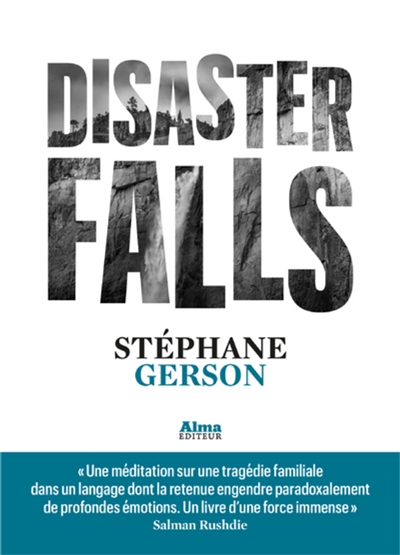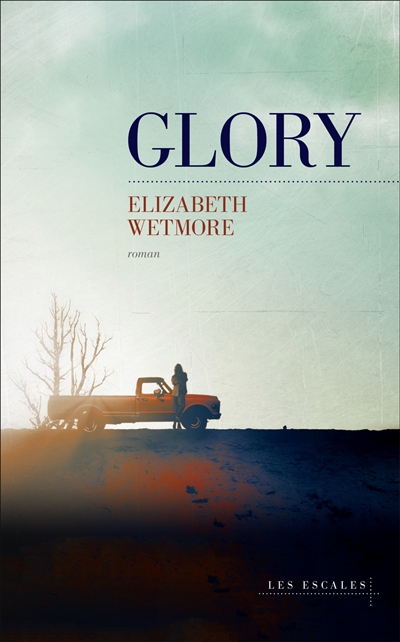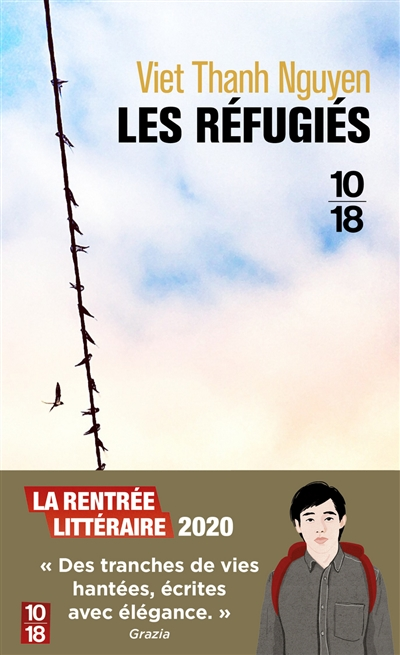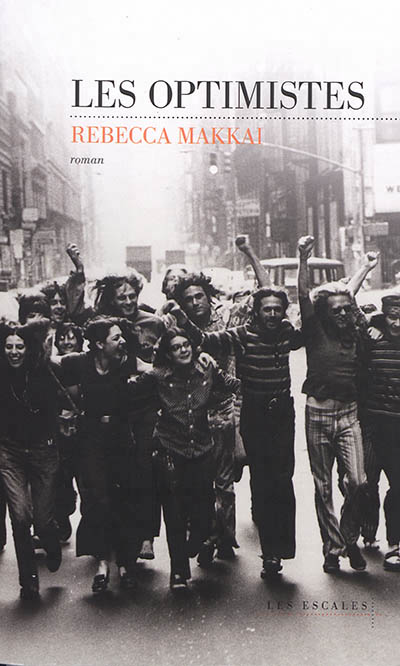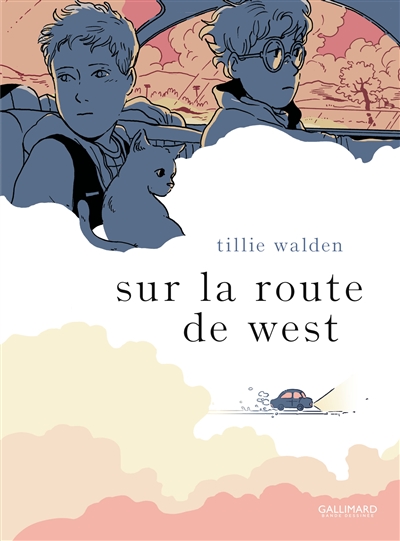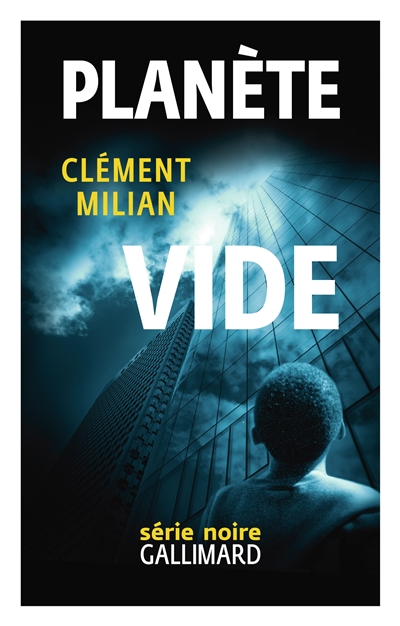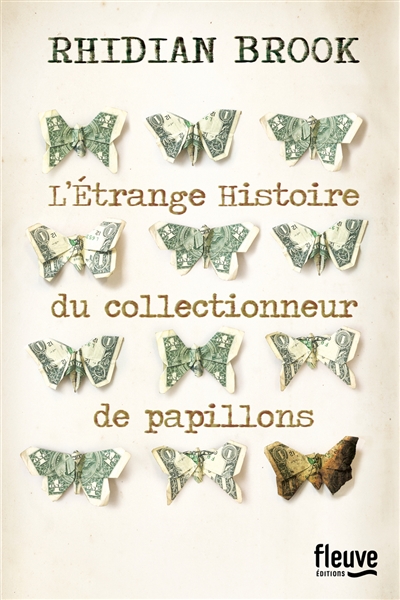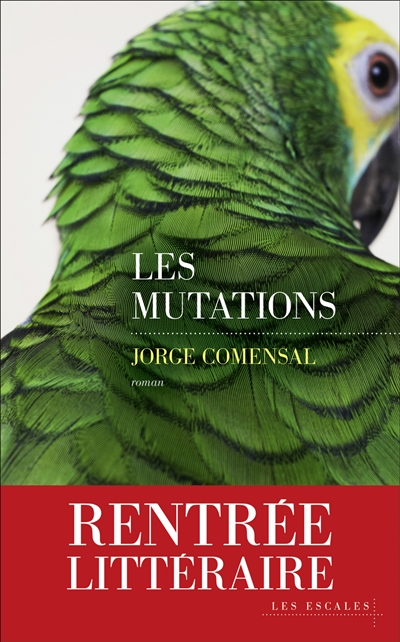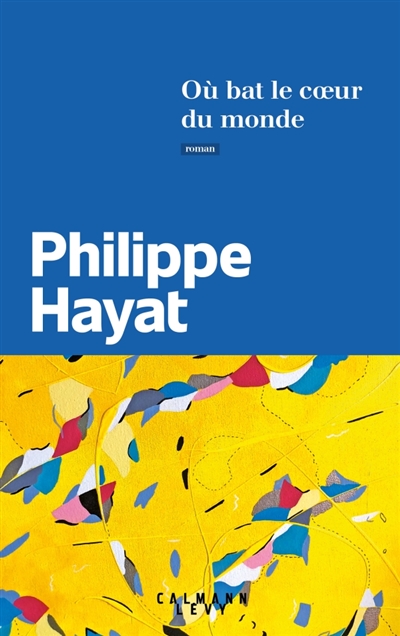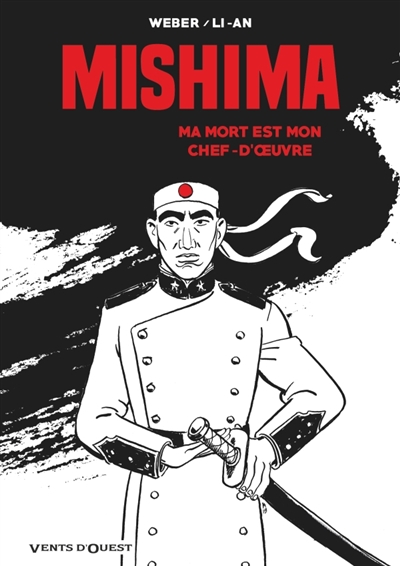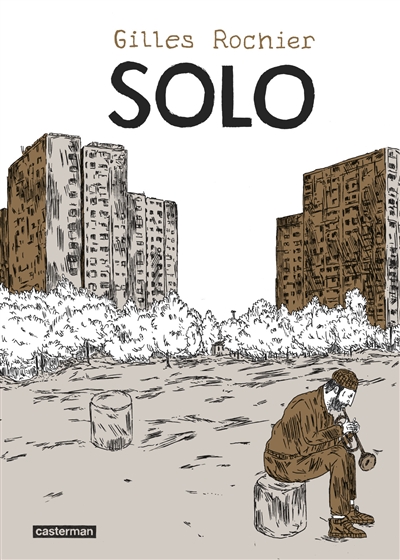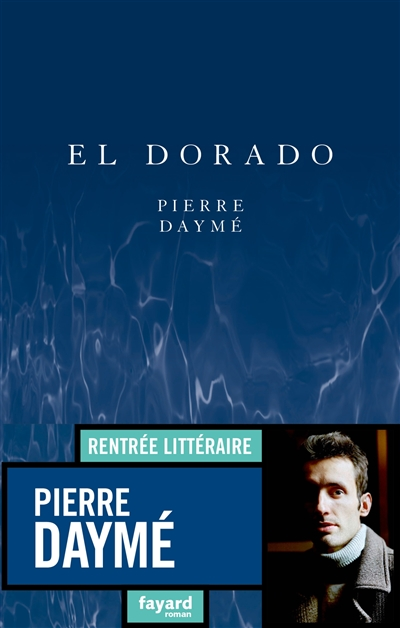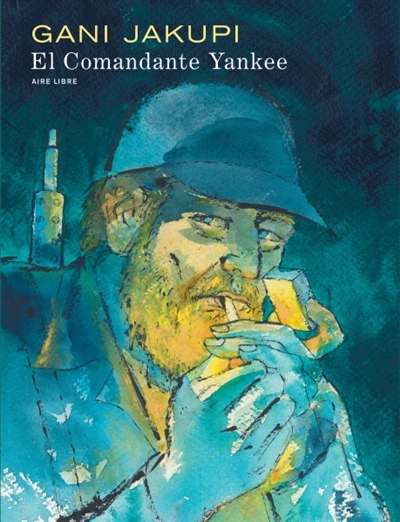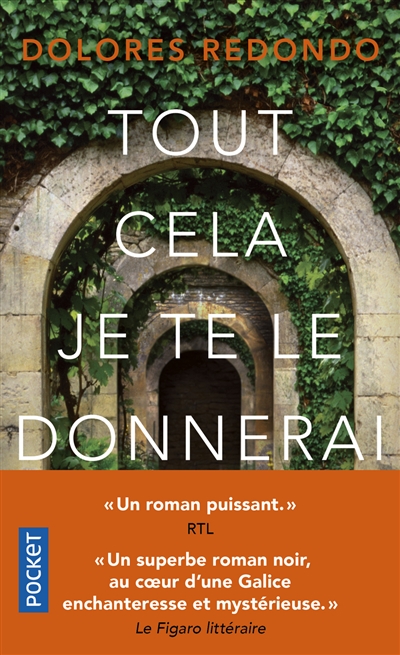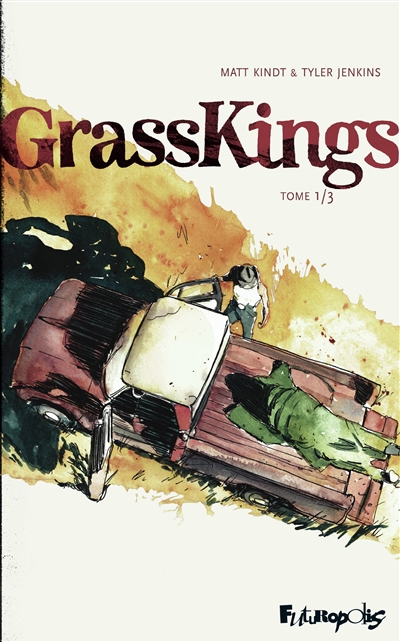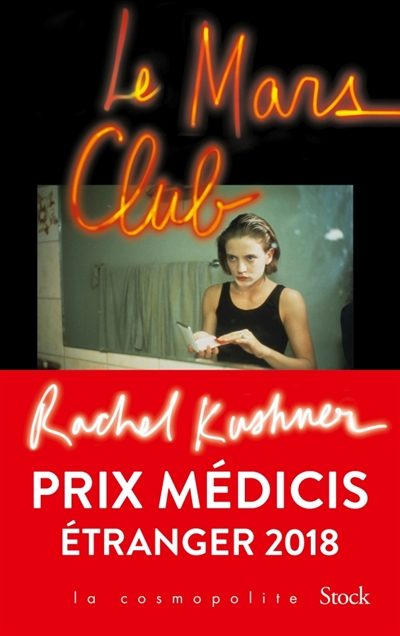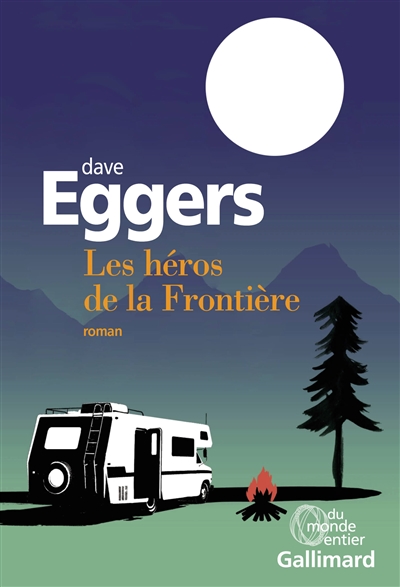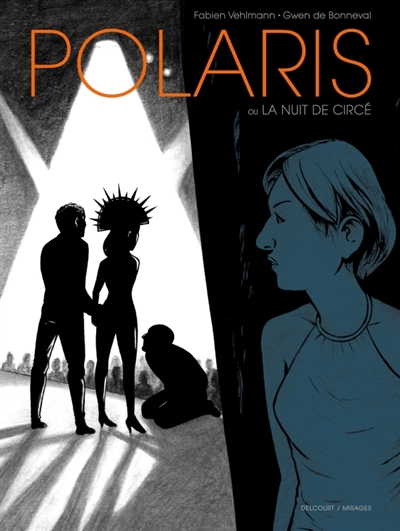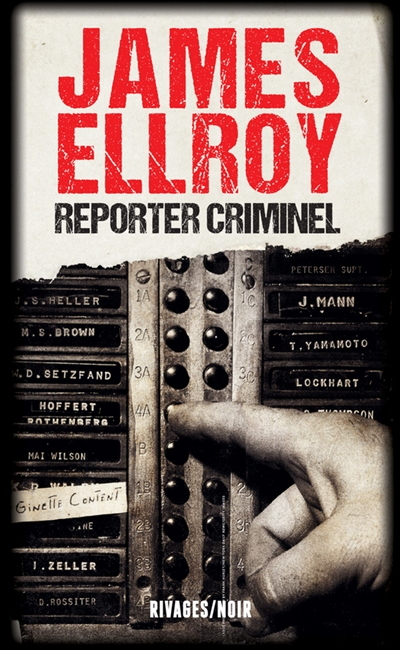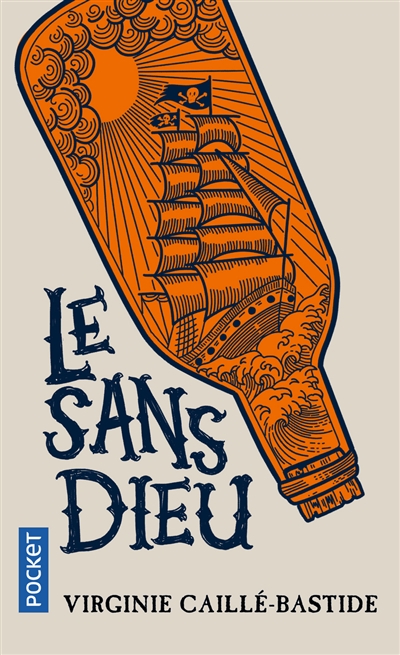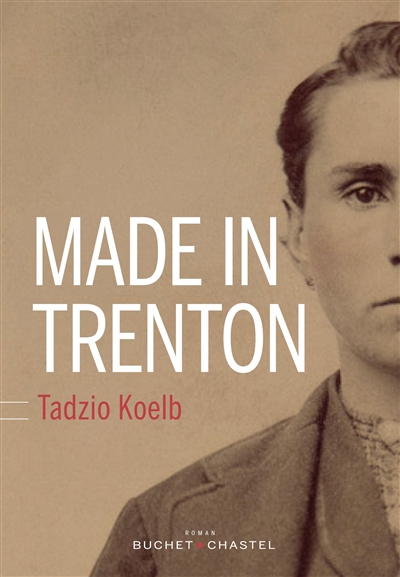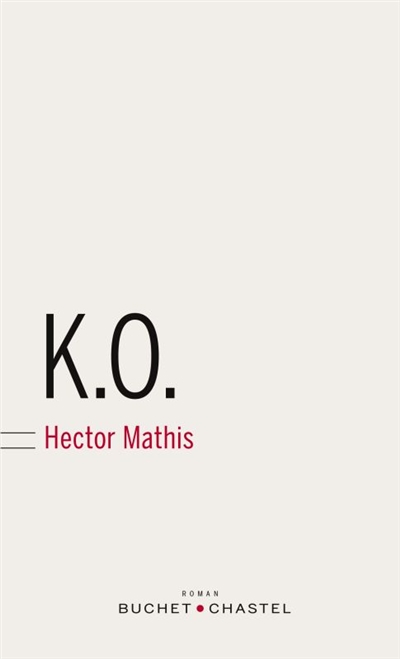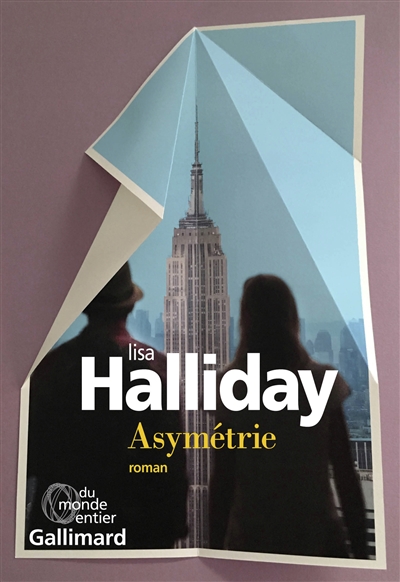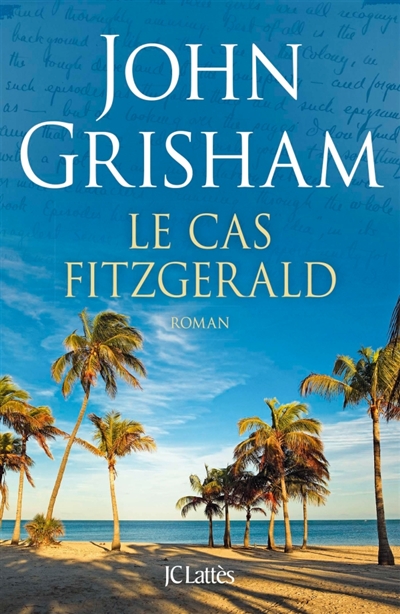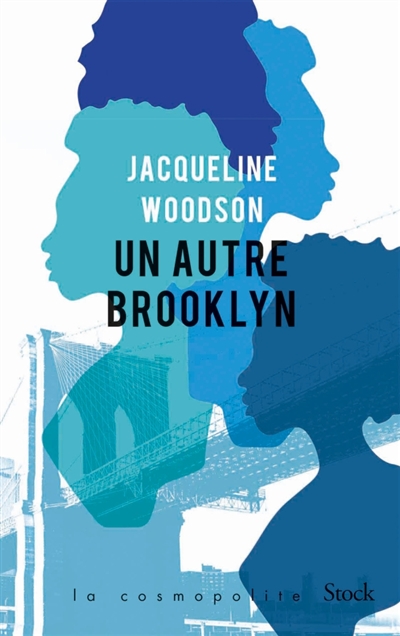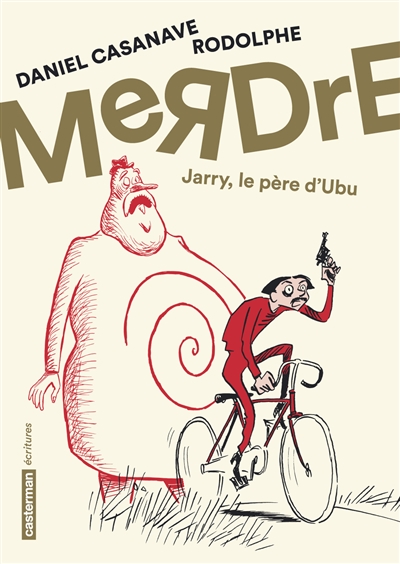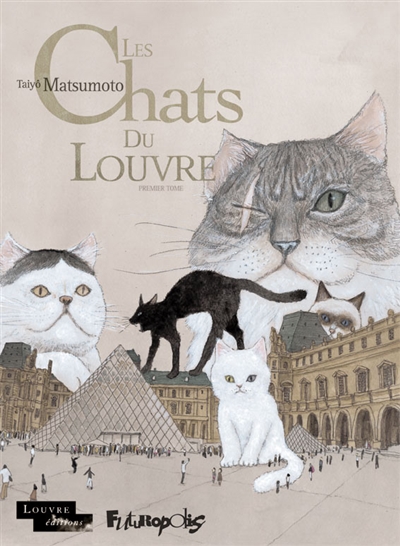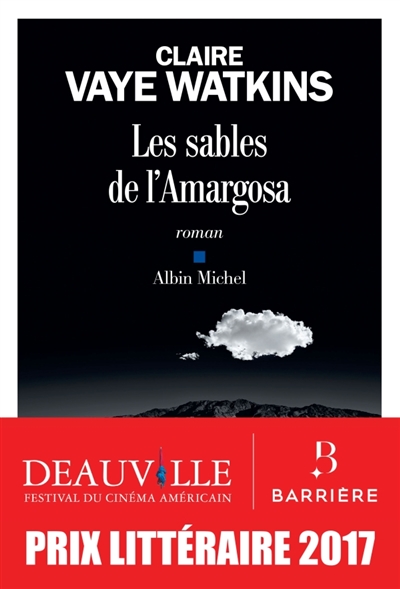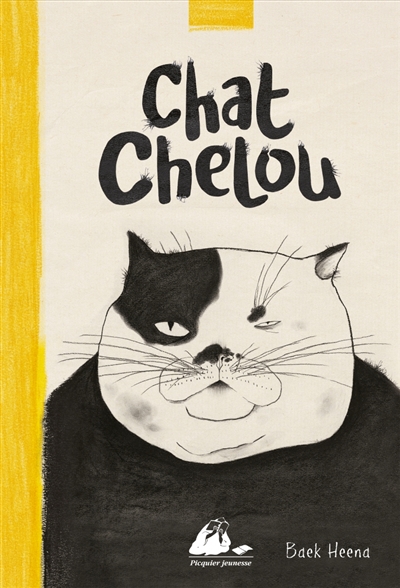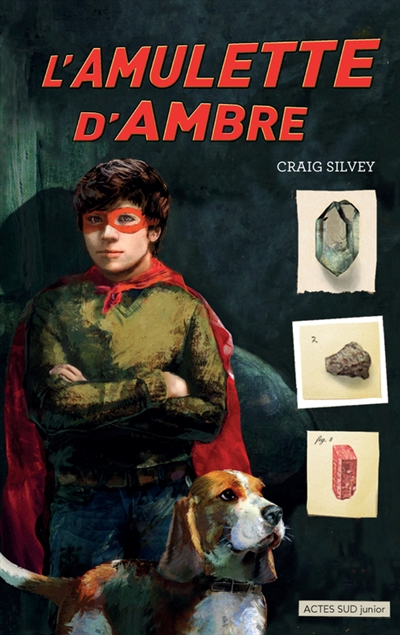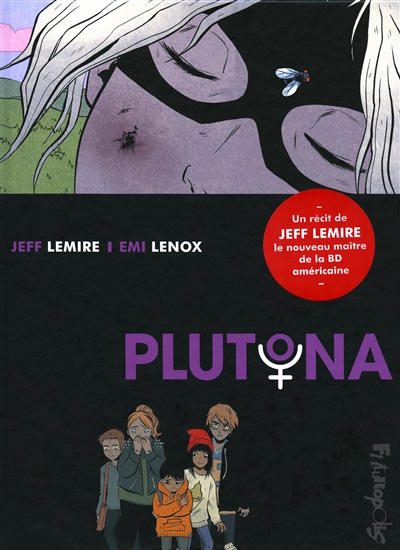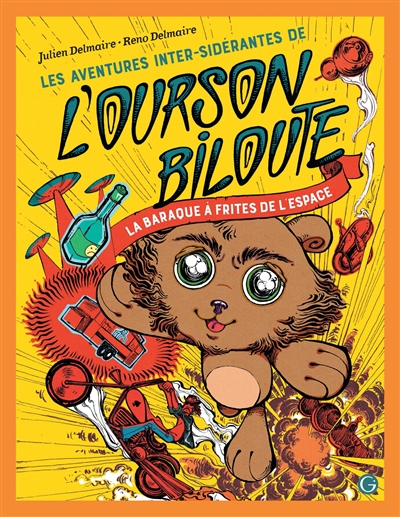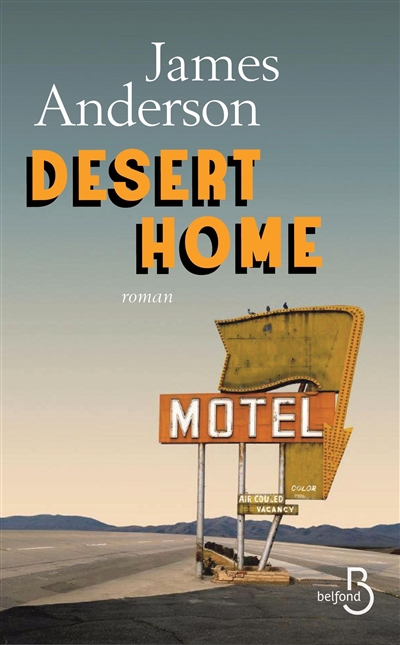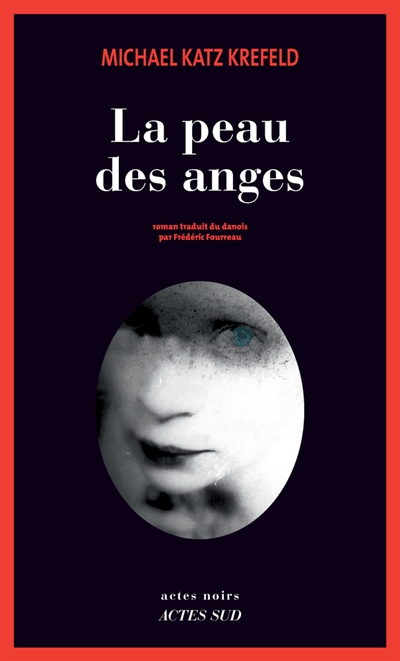Polar
Karin Slaughter
Son vrai visage

-
Karin Slaughter
Son vrai visage
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Eve Vila
HarperCollins
03/04/2019
576 pages, 20,90 €
-
Chronique de
Anne-Sophie Rouveloux
- ❤ Lu et conseillé par 1 libraire(s)

✒ Anne-Sophie Rouveloux
( , )
Arriver à Saint-Pancras ce matin-là relève de l’exploit. Brexit oblige, les douaniers de la gare du Nord font grève, entraînant des retards monstres. Sur place, la fatigue s’envole, l’excitation déboule. Voici Londres, toujours aussi classe, son grand soleil vite douché par la pluie et cet accent so british qu’on attrape au vol dans les rues. Direction Trafalgar Square où se trouve le luxueux hôtel de Karin Slaughter. Lorsqu’elle nous reçoit, son sourire et son charme décontractés promettent un échange chaleureux. En effet, en vingt-cinq minutes chrono, l’auteure nous abreuve d’anecdotes personnelles et si nous parlons de son livre, il est aussi question du monde d’aujourd’hui. Très vite, je réalise que sa franchise, ses remarques pleines d’esprit et de psychologie ne me sont pas inconnues : toutes ces qualités sont présentes dans son dernier roman. Et cerise sur le gâteau, Karin Slaughter s’avère être une lectrice curieuse et passionnée qui affirme avoir besoin de lire pour écrire.
À l’occasion de son 31e anniversaire, Andy déjeune en compagnie de sa mère, Laura. Elles sont le jour et la nuit. Alors que Laura s’épanouit en tant qu’orthophoniste, Andy est introvertie et pleine de doutes. En plein milieu de leur repas, un jeune homme fait irruption dans leur restaurant et ouvre le feu. Il ne faudra que quelques instants à Laura pour maîtriser l’assaillant et le tuer d’un coup de couteau. Andy découvre en sa mère une inconnue. Une tueuse. Et bientôt, elle-même sera une fugitive qui devra faire preuve de malice et de détermination pour survivre, seule, sans personne pour l’assister. Il s’agira aussi de remonter le temps pour découvrir qui était réellement Laura. À la fois plongée dans le passé et course-poursuite haletante dans le présent, Son Vrai Visage s’avère être un thriller dense et construit. L’auteure explore également la relation mère/fille, forte et complexe, et aborde sans fard la question des violences faites aux femmes.
PAGE — Votre roman met en scène deux femmes, Laura et sa fille Andy. Cette dernière n’a pas vraiment confiance en elle et elle devra apprendre à se dépasser pour espérer comprendre qui est vraiment sa mère. Est-ce qu’on peut dire que Son Vrai Visage est le roman d’apprentissage d’Andy ?
Karin Slaughter — Oui, tout à fait. Je n’avais jamais écrit un personnage comme elle. La plupart des femmes que je crée me ressemblent : elles savent ce qu’elles veulent dans la vie. Avec Andy, je pense que j’essayais de comprendre mes nièces. Elles avaient à peu près le même âge qu’elle et il avait fallu les secouer pour qu’elles se lancent dans la vie. C’est courant dans notre monde occidental. Les enfants de maintenant sont beaucoup plus chouchoutés qu’à mon époque ! Pour Andy, voir en sa mère une meurtrière psychopathe était la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Ça l’a forcée à grandir et à prendre le contrôle de sa vie.
P. — Andy fait face à des problématiques modernes. À 30 ans, elle ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Elle compte encore beaucoup sur ses parents et s’interroge à la fois sur son avenir professionnel et sentimental.
K. S. — Quand on a 20 ou 30 ans, le regard des autres est très important. Pendant un moment, on cherche à comprendre qui on est jusqu’à ce qu’on finisse par se dire : « Et puis merde, je suis comme ça ! ». Mais ce cheminement prend du temps. Je pense aussi que les jeunes femmes d’aujourd’hui ont une grande maturité émotionnelle. Elles s’expriment beaucoup plus. Elles abordent des thématiques que les jeunes femmes de ma génération auraient soigneusement évitées et elles n’en ont pas honte. Il n’y aucune gêne à dire : « Je suis complètement paumée ! Qu’est-ce que je vais faire de ma vie ? ».
P. — Et Laura, quelle mère est-elle ?
K. S. — Laura est une femme différente selon la personne avec qui elle se trouve. Son métier consiste à aider les gens qui ont vécu des traumatismes et elle applique sur eux des méthodes déjà testées sur elle-même. Elle est une excellente mère pour Andy. Mais il y a une part d’elle que sa fille ne connaît pas. Andy va rapidement prendre conscience qu’elle a été abreuvée d’histoires qui s’avèrent être des mensonges. Pour sa fille, se retrouver confrontée à cette vérité cachée pendant si longtemps est encore plus violent que la fusillade que les deux femmes vont vivre au début de mon livre.
P. — Est-ce que l’on peut dire que choisir des héroïnes fortes est un acte politique ?
K. S. — Non, mais c’est perçu comme tel. Au début de ma carrière, je n’avais pas du tout conscience que je mettais en scène des « femmes fortes ». J’adorais lire, surtout des thrillers, mais je ne trouvais pas d’histoires avec des personnages féminins convaincants. Il y a des tas d’auteures femmes – Sue Grafton, Daphné du Maurier, Agatha Christie… – qui écrivent du policier, mais qui appartiennent à des sous-genres différents comme le roman d’enquête ou d’énigme, par exemple. Moi, je voulais être très réaliste. Je voulais écrire sur la violence, notamment sur celle que subissent les femmes. Je n’avais pas l’intention d’édulcorer les faits. Il me fallait écrire le genre de bouquin que j’aurais aimé lire. J’étais à l’université quand j’ai commencé à penser à mon premier roman. J’étais bénévole pour un centre d’aide aux victimes de viols. En moyenne, les bénévoles restaient trois mois. J’ai tenu quatre mois. C’était très dur. Mais cela m’a permis de comprendre que la plupart des récits de viols qui étaient racontés par des hommes étaient faux. Je voulais écrire quelque chose de réaliste sur cette expérience et c’était un choix délibéré. Il fallait que je parle de ce que je voyais là-bas. C’est en échangeant avec vous et d’autres interlocuteurs que je me rends compte que ce que je fais est un acte politique. Par contre, quand les hommes parlent des autres hommes, personne ne dit que c’est politique. Mais quand ce sont des femmes, soudainement, ça devient féministe.
P. — Une question compliquée pour terminer notre échange : pensez-vous que la littérature peut nous aider à mieux comprendre notre prochain ?
K. S. — Oui et non. Ça dépend du lecteur. Ça peut marcher si la personne est ouverte, si elle a envie de s’intéresser aux autres. C’est particulièrement vrai avec les problématiques de races. Je suis en train de lire Ma sœur, serial killeuse d’Oyinkan Braithwaite, paru chez Delcourt, et c’est vraiment bon. L’auteure n’est pas là pour démontrer quelque chose. C’est juste une super histoire. C’est destiné à un public qui est au courant de ce que c’est de vivre au Nigeria mais c’est écrit d’une telle manière que ça me parle, à moi aussi.