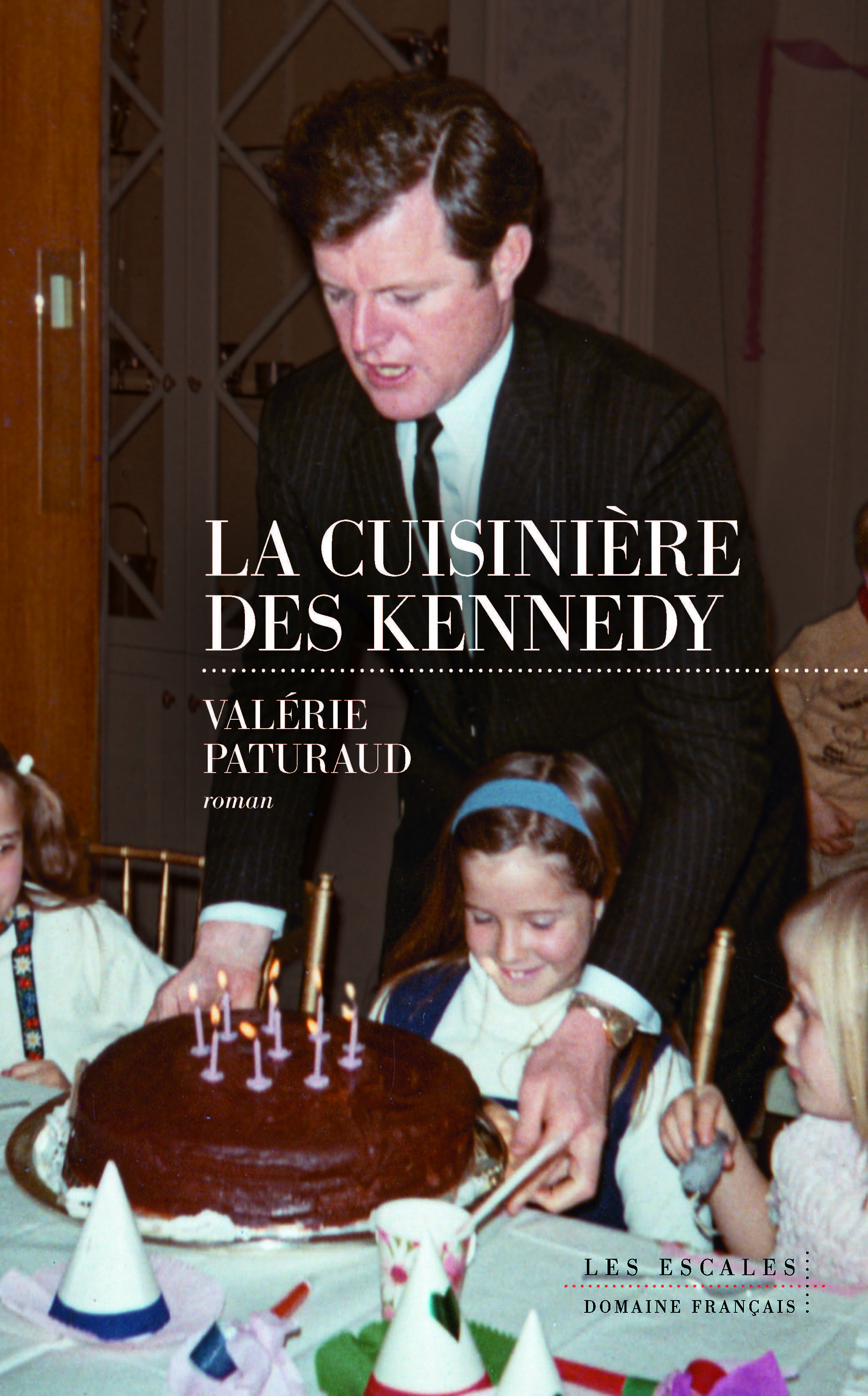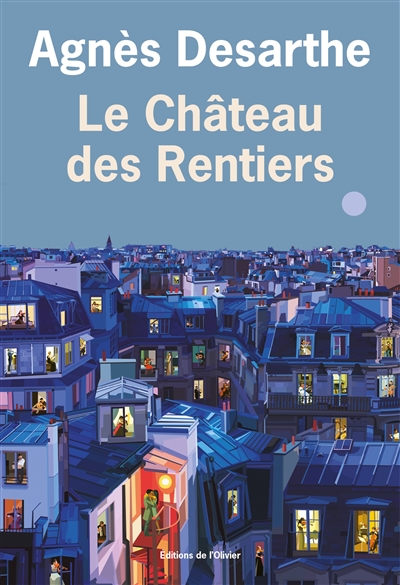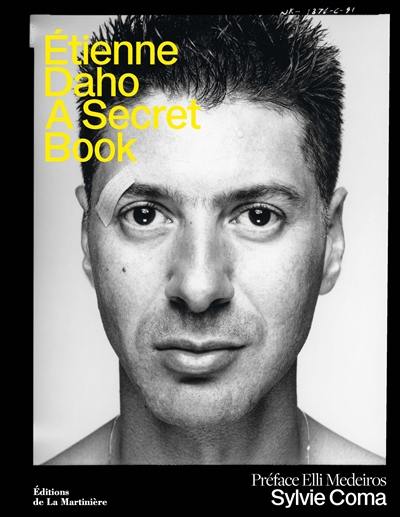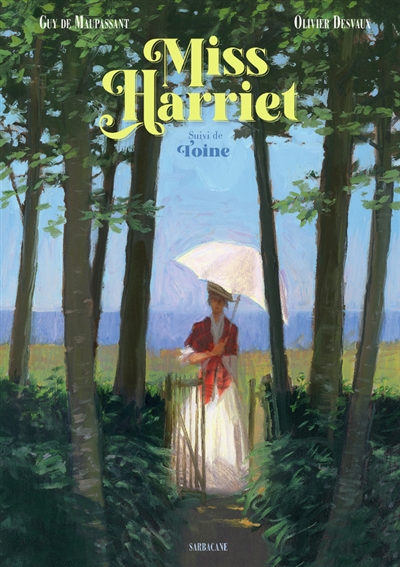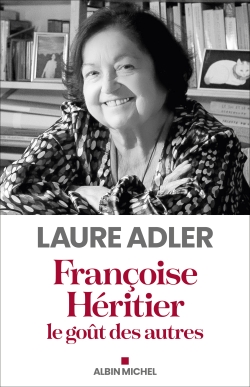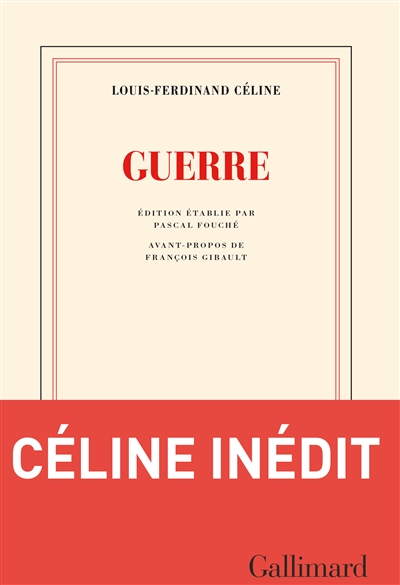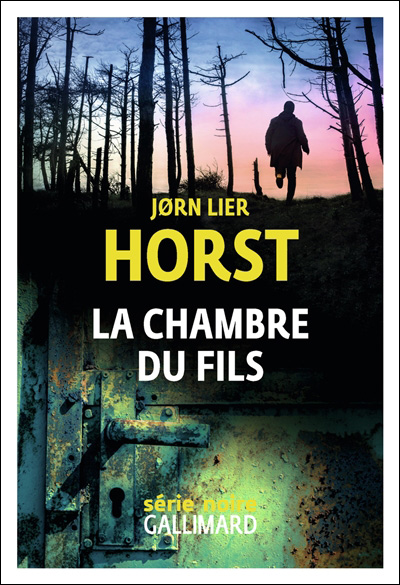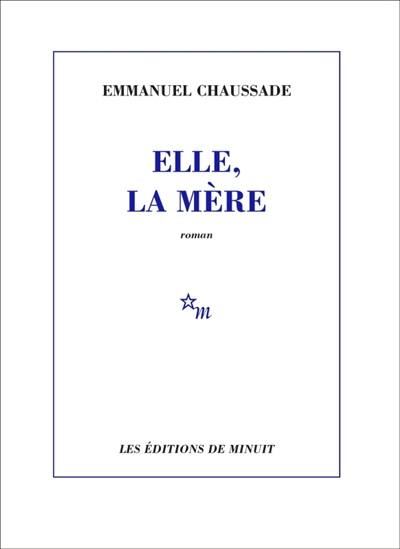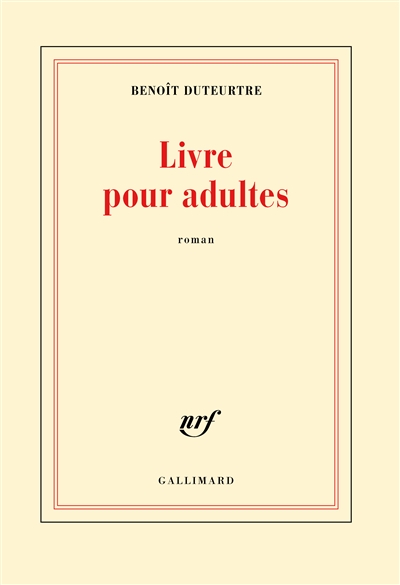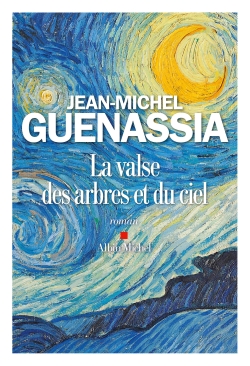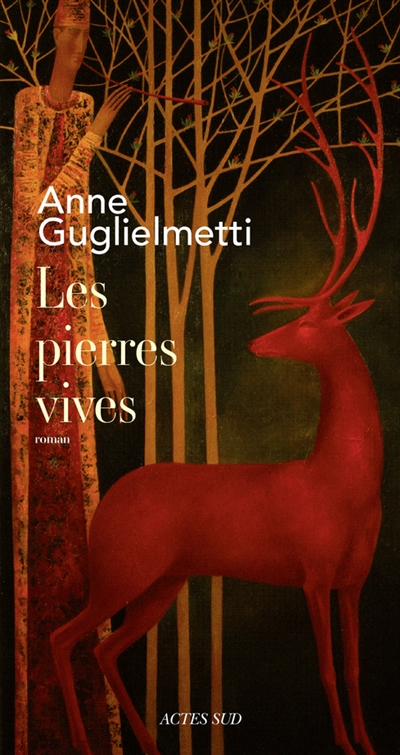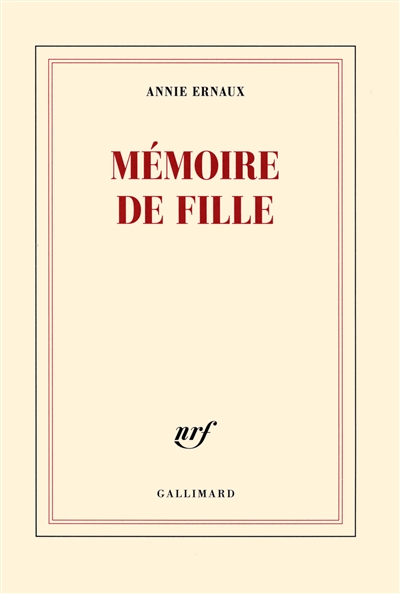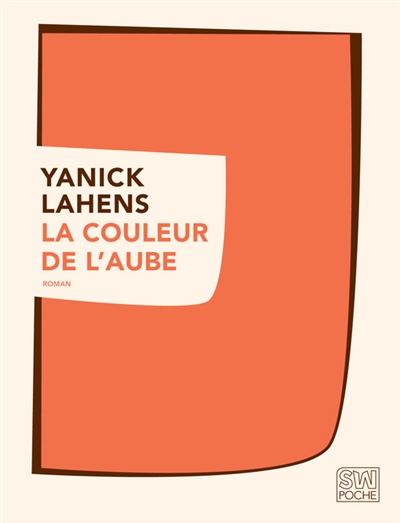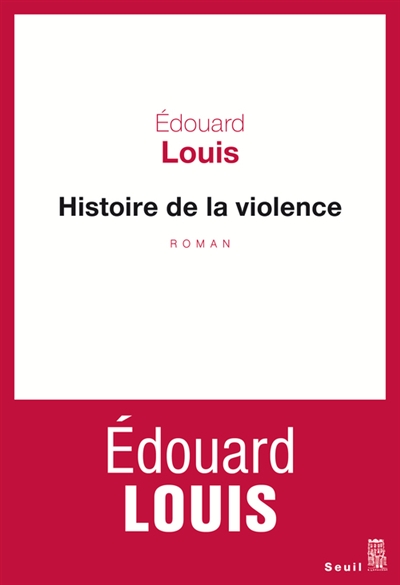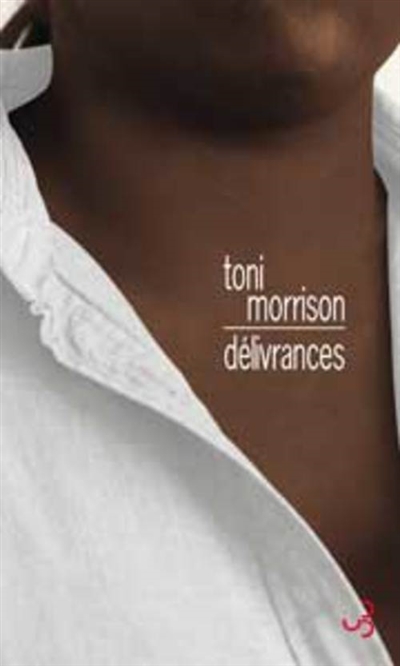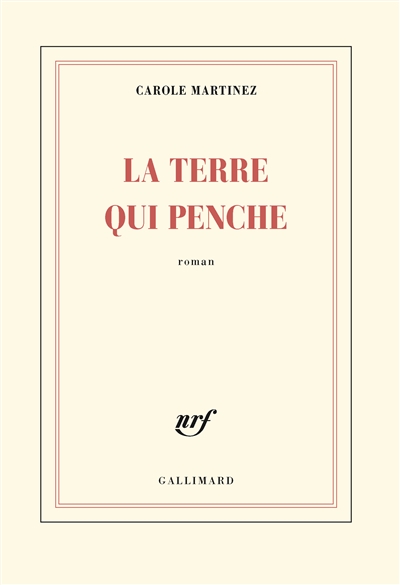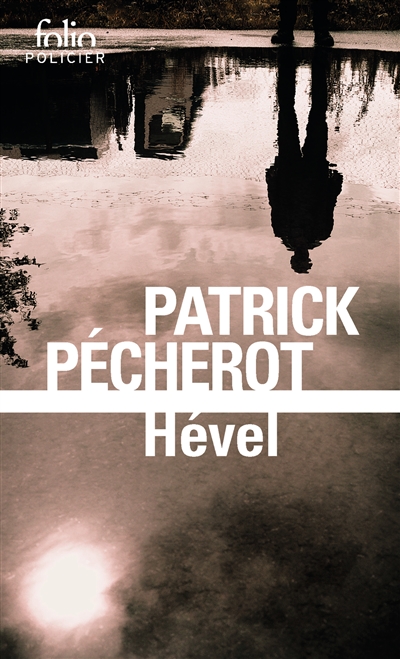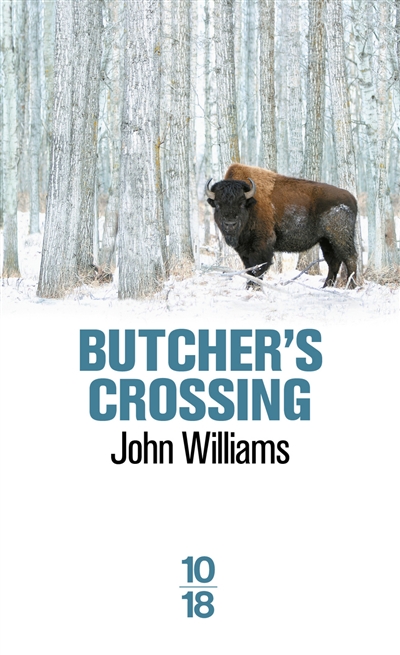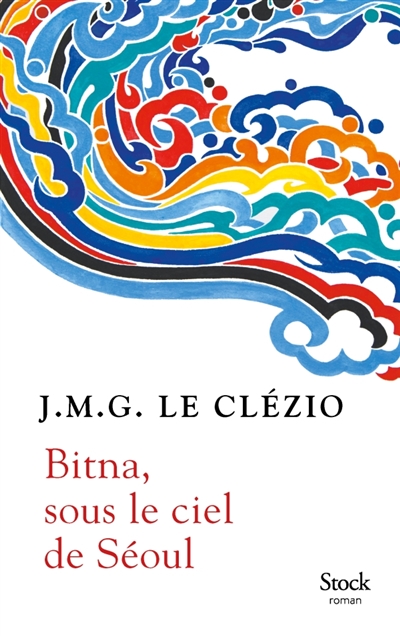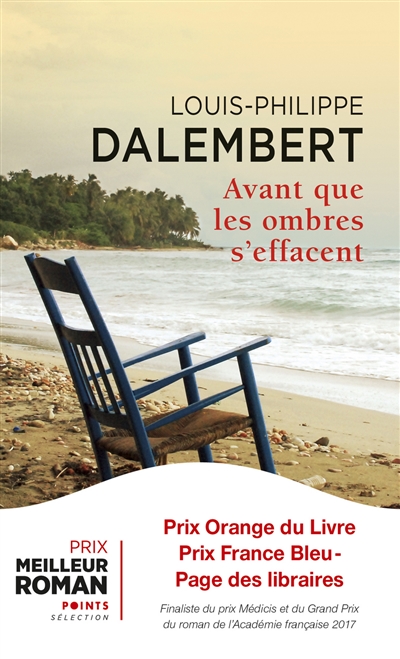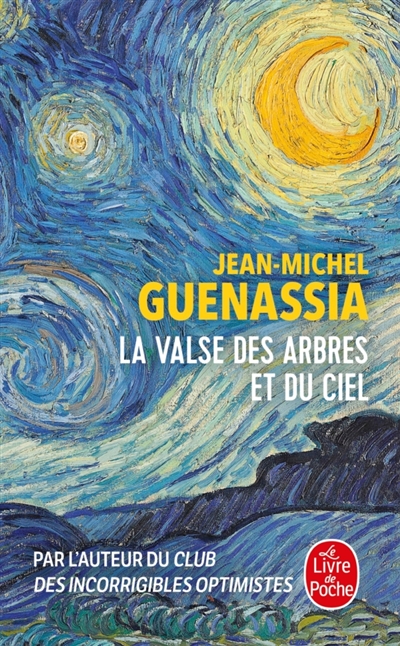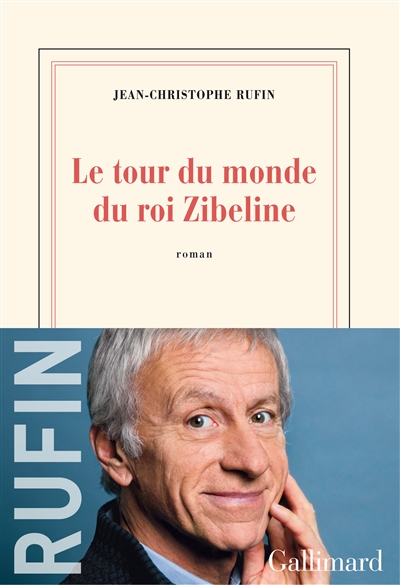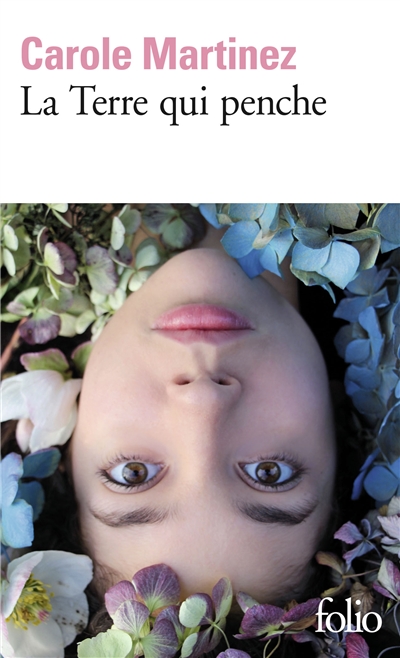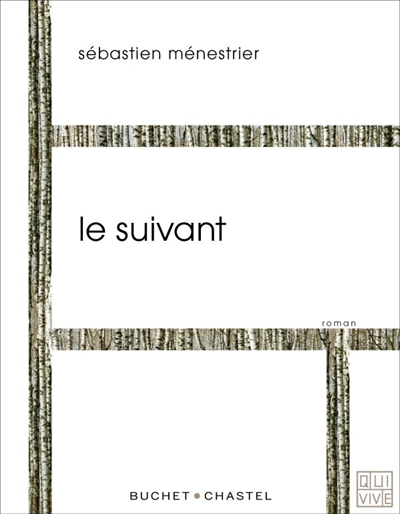Littérature française
Maylis de Kerangal
À ce stade de la nuit

-
Maylis de Kerangal
À ce stade de la nuit
Verticales
15/10/2015
7 pages, 50 €
-
Chronique de
Betty Duval-Hubert
Librairie La Buissonnière (Yvetot) -
❤ Lu et conseillé par
9 libraire(s)
- Geneviève Gimeno de Maupetit (Marseille)
- Jean-Pierre Agasse de Actes Sud (Arles)
- Christine Jankowski de Tome 19 (Revel)
- Valérie Faucon de BPI - Bibliothèque publique d’Information (Paris)
- Anne-Claire Demy de Arcadie (Luçon)
- Marie-Laure Turoche
- Laurence Quenard de Garin (Chambéry)
- Serge Blanchard de Papyrus (La Ferté-Bernard)
- Tiphaine Burger de Bilbliothèque Joseph Thiébot (Bricquebec)

✒ Betty Duval-Hubert
(Librairie La Buissonnière, Yvetot)
Lampedusa, une île, source de rêves et de rêveries insatiables; un îlot italien avant d’atteindre l’Occident, ses illusions mirifiques, dérisoires et mensongères. Lampedusa, à ce stade de la nuit et de la lecture, dit la fulgurance et l’exception littéraires.
À ce stade de la nuit est un texte de l’urgence, une invitation vitale et essentielle à (re)découvrir un paysage dans une situation extrême, quand les sens en alerte, l’oreille est soudainement captée par les voix de la radio. Elles disent le naufrage mortel de centaines de migrants clandestins africains au large de l’île de Lampedusa. Le choc arrive, le choc est là, fulgurant. L’information est passée dans le cerveau. La nuit est plus froide et dense, le texte prend soudainement corps et s’affine. La littérature s’expose et devient prodigieuse pour dire l’indicible, tenter de comprendre la tragédie. « Je me dis parfois qu’écrire c’est instaurer un paysage. (…) les îles sont comme des idées ». Et les idées avancent, lentement le tour de l’île s’opère en une boucle. La boucle du récit, la boucle de la nuit. Évoquer Lampedusa, c’est aussi convier Luchino Visconti et Le Guépard, sans omettre Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Une aristocratie finissante et arrogante, qui est l’image exacte d’un naufrage. C’est la vacuité et la vanité d’un monde occidental qui s’essouffle, proche de l’étouffement, pleinement dans le rejet et la peur de l’autre, l’étranger, celui qui est issu d’un monde, d’un milieu différent. La chute et la fin sont amorcées, la mort comme assurée, assumée. Et l’envie est grande de (re)voir ce film, ce lieu, de (re)lire cet unique roman. Suivre le fil des pensées de Maylis de Kerangal, c’est accepter avec grâce et appétence de s’immerger dans une langue extraordinaire, dans une scansion littéraire distinguée qui fait sens à chaque mot, à chaque image travaillée, à chaque virgule apposée. La mer revient, l’eau est l’élément immuable et récurrent dans presque tous ses romans, comme le sont les corps humains exaltés ou perdus dans leur finitude mortelle. La nuit dure et n’en finit plus, le nombre des morts noyés augmente ; le nom de Lampedusa obsède et marque durablement l’histoire. Les noms des naufragés demeurent inconnus, masse invisible, indivisible. Seul le nom du lieu reste tristement connu. L’auteure s’interroge et nous interroge, nous interpelle, nous immisce dans ces détours narratifs. Le voyage a déjà commencé depuis longtemps, avant ce stade de la nuit, au Havre, en Irlande, en Sibérie, à Stromboli… D’un lieu à un autre, d’une rencontre à une autre, sans jamais perdre le fil narratif, l’île de Lampedusa revient du début à la fin de la nuit. Le bleu inouï et magique de la Méditerranée ne peut faire oublier ses colères ni sa noirceur : « elle aussi est habitée d’épaves, peuplée de cadavres, hantée de fantômes ». La mer sépare et relie deux mondes opposés, deux mondes qui s’agitent en elle et sur elle. Malgré elle, elle recueille en son sein, en son ventre, les plus démunis, ceux qui fuient leur terre et leur désespoir pour un autre monde censément plus riche et plus libre, plus ouvert. L’eau devient la réalité dure et tragique des migrants. L’île est alors désespérément fantomatique. Ce texte, magnifique, est à lire, à relire inlassablement, car lorsque la littérature s’empare de la réalité elle devient prodigieuse.