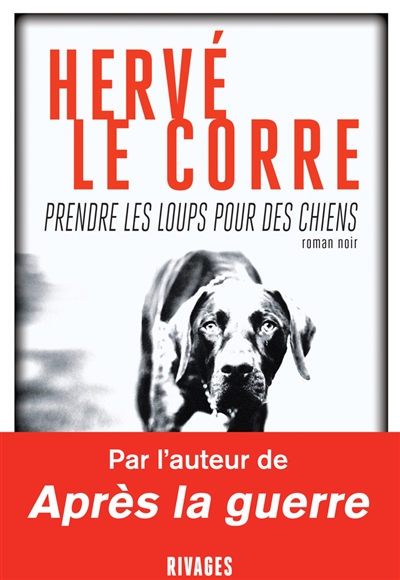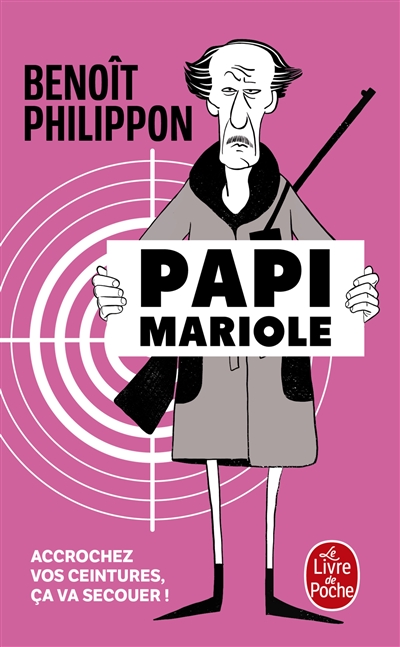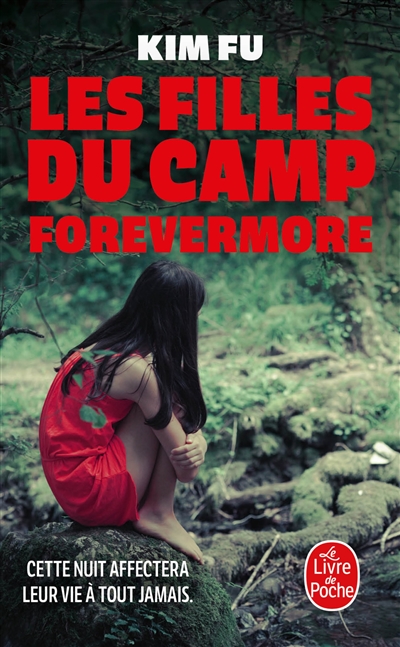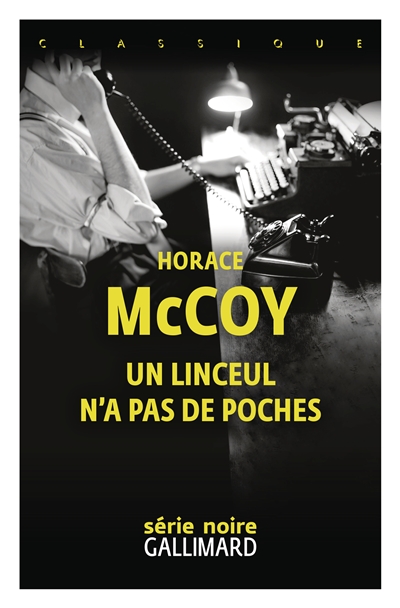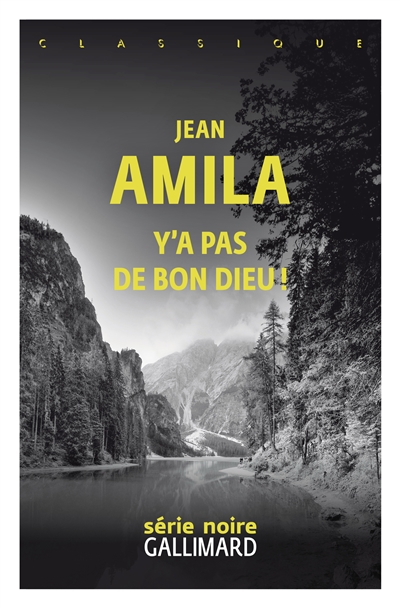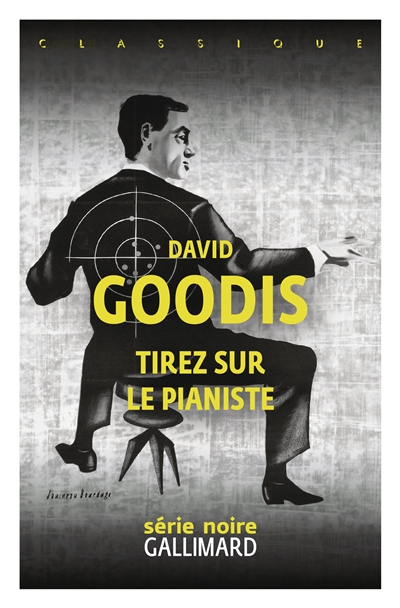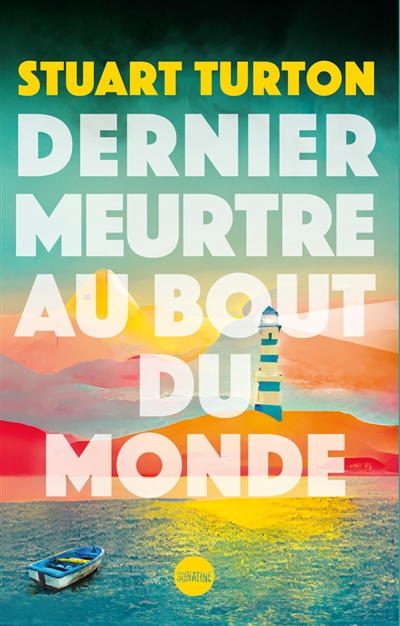Une maison isolée dans une forêt de pins sombres quelque part dans les Landes de Gascogne. Franck, debout à sa sortie de prison, sonné par la chaleur, vient d’y être conduit par Jessica, la compagne de son frère Fabien, celui qui a réussi à s’enfuir avec l’argent de leur cambriolage. Franck n’a pas parlé, il a pris six ans ferme. La liberté retrouvée prend l’allure d’un nouvel enfermement dans un espace-temps brutalement dilaté. Malgré lui, il est mêlé à la vie d’une famille empoisonnée par une ambiance plus que trouble : Jessica ouvertement provocante, ses parents méfiants, alcooliques, sa fille Rachel, une enfant silencieuse qui encaisse les coups, les sautes d’humeur, les injures, les non-dits terrifiants. Et un énorme chien noir, présence maléfique, quasi surnaturelle. La mécanique de la violence va se mettre en marche, nourrie par les haines anciennes, la précarité, les mensonges, les désirs stériles.
PAGE — Pas à pas, au fil de vos romans, vous traquez l’origine et les mécanismes qui mettent en œuvre la violence des hommes. S’agit-il pour vous à chaque fois de trouver un angle de vue éclairant ?
Hervé Le Corre — La violence est une obsession angoissante (sans doute comme toutes les obsessions, finalement…) : la violence que les humains sont capables d’infliger, mais aussi celle qu’ils sont capables de subir et d’endurer. Et l’éventail est large, de la violence criminelle, crapuleuse, ou bien motivée par des sentiments de haine, de jalousie, ou des pathologies mentales, jusqu’aux violences sociales, d’ordre symbolique, ou politiques. On n’en finit plus d’énumérer les circonstances et les raisons qui déclenchent l’acte violent, qu’il s’agisse d’un meurtre, ou de torture, ou bien encore de toutes les formes de maltraitance infligées à un autre être humain. Comme tout cela relève pour moi d’une sorte d’énigme, une fois que toutes les analyses politiques, sociales ou psychologiques ont été produites et ne sont pas parvenues à expliquer en profondeur déchaînements ou situations de violence, ne me reste que le roman pour tâcher de réinventer des contextes, des protagonistes, et me reposer les mêmes questions pour leur trouver, par la fiction, quelques éléments de réponse. Le roman comme tentative de connaissance, comme recherche, évidemment jamais satisfaite ou aboutie… D’où la nécessité d’écrire encore d’autres romans. C’est ainsi que dans Prendre les loups pour des chiens, j’ai essayé d’explorer les ressorts intimes de quelques personnages dans leurs rapports à la violence. Jessica et sa pathologie mentale, Franck parfois au bord de la perte de contrôle.
P. — Après la guerre (Rivages noir) dessinait une ville couleur sépia, trouble, minée par des blessures encore à vif de l’épuration et l’inquiétude de ce qu’il se passait en Algérie sans être nommé. Comment êtes-vous arrivé dans les pins du sud de la Gironde avec une intrigue aussi resserrée ?
H. L. C. — Après la guerre, avec ses trois axes narratifs, occupait mécaniquement, et nécessairement, plus de volume. Narration éclatée, personnages aux parcours divergents, aux trajectoires antagoniques, convergence des époques (l’Occupation et ses crimes, l’Algérie et les siens). J’avais donc besoin de place. Avec Prendre les loups pour des chiens, je cadre plus serré puisque je n’ai qu’un point de vue narratif, celui de Franck. Et comme je voulais surtout écrire un roman d’ambiance, basé sur la tension permanente entre les personnages, je me devais de concentrer mon écriture sur les gestes, les regards, les silences, les espaces contraints dans lesquels ils évoluent, cette promiscuité, presque, qui ne pardonne pas dès lors qu’on ment ou qu’on dissimule, comme si chacun recevait, sous forme d’ondes, de vibrations, le malaise qui naît et grandit juste en face ou autour de lui. De plus, je voulais exprimer une sensation d’enfermement – après que Franck est sorti de prison, il s’enferme et s’enferre au sein de cette famille dangereuse – d’où peu d’échappées et d’envolées, peu d’espace et de lyrisme.
P. — Au moment où nous les rencontrons, vos personnages ont déjà pris des coups dans leur passé. Ce qui les rend imprévisibles, incontrôlables, dangereux et terriblement attachants, intemporels. Les avez-vous façonnés peu à peu ou se sont-ils imposés à vous ?
H. L. C. — Quand je commence, j’ai une idée assez précise des trois ou quatre personnages principaux, mais je les affine au fur et à mesure de l’écriture du roman. Je ne fais pas de fiches sur eux, avec leur biographie, voire leur CV, comme le font certains auteurs – et pourquoi pas leur groupe sanguin ! Tout doit résider dans la nécessité de l’écriture : l’essentiel repose sur eux et j’ai besoin qu’ils soient solides, vraisemblables, crédibles. Et dangereux selon les cas. Quant à leur imprévisibilité, elle vient du fait que je ne décide qu’au dernier moment ce qu’ils vont faire : je travaille toujours mes intrigues dans un équilibre instable d’improvisation et d’anticipation.
P. — Comme des respirations dans le déchaînement des passions destructrices, vous ménagez de superbes moments contemplatifs, une immersion charnelle dans une nature consolatrice. La promesse d’une rédemption ?
H. L. C. — Dans ce livre, la nature est omniprésente : oppressante, hostile ou au contraire libératrice et somptueuse à la fin, par exemple. Et c’est sans doute ce que j’aime le plus écrire dans un roman : ces moments où un personnage se trouve face à la nature et en ressent l’espèce de message angoissant ou apaisant qu’elle lui envoie. C’est dans ces moments-là que mes personnages sont les plus seuls, les plus nus et désarmés. Quant à la rédemption, je ne sais pas. Je crois que chacun a le droit à une deuxième chance (au moins), comme celle que j’aménage pour le père de Franck. Une sorte de droit à la paix, à la plénitude des jours. Et la contemplation fait alors partie de ces moments où l’on essaie d’arrêter le temps comme une eau fraîche au creux de ses mains.