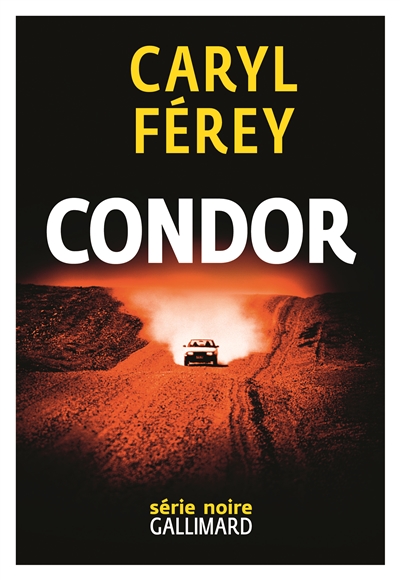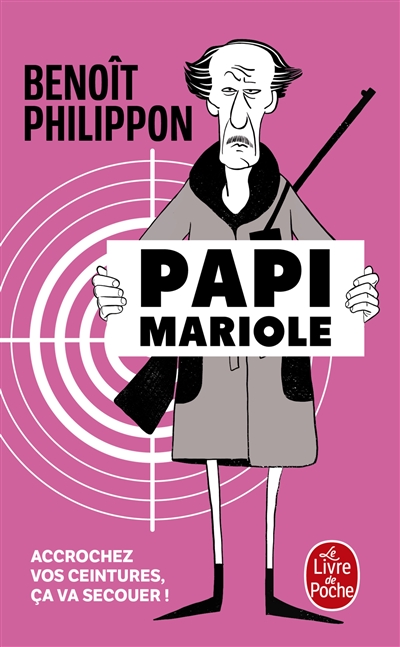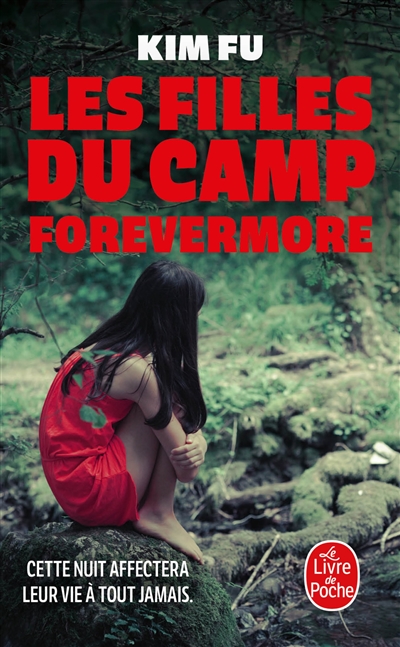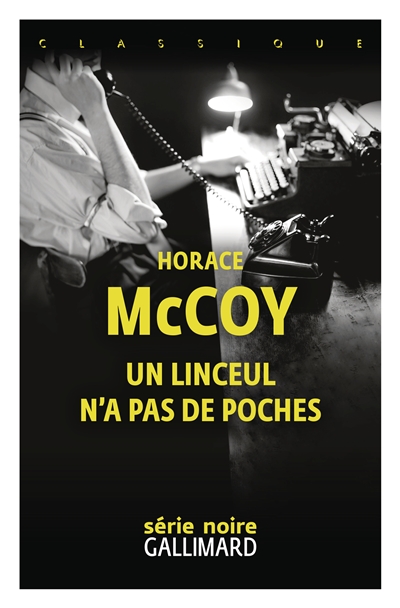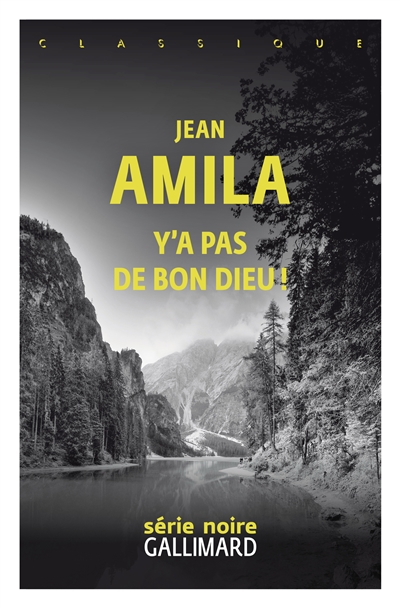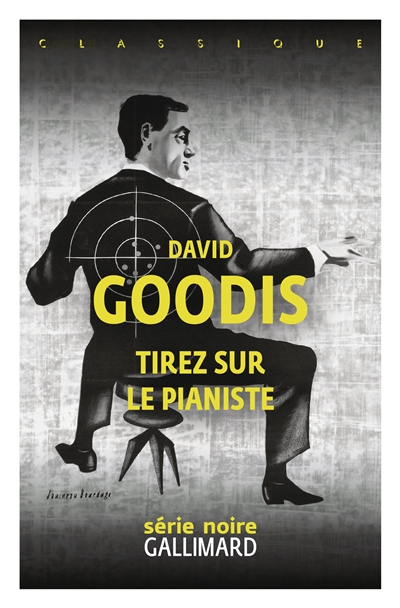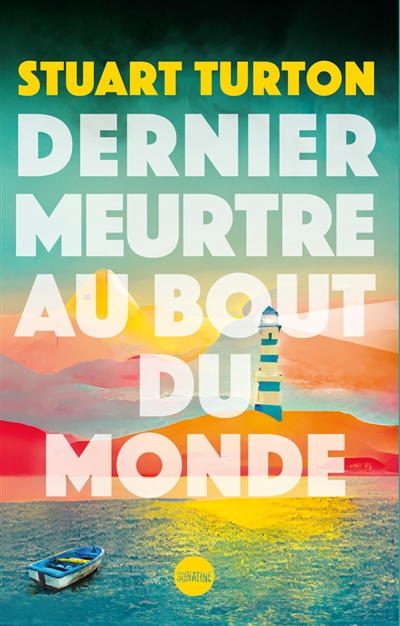L’histoire débute avec la mort suspecte d’Enrique et de trois autres gamins dans un bidonville de Santiago. La consommation d’une cocaïne trop pure en serait la cause, mais comment cette drogue est-elle entrée en leur possession ? C’est la question que se posent Stefano, propriétaire d’un cinéma d’art et d’essai, et Gabriela, sa protégée, jeune vidéaste mapuche et amis du père d’Enrique. Cette dernière ira trouver Esteban Roz-Tagle, avocat « spécialiste des causes perdues », comme il se définit lui-même, afin de mener une enquête qui les entraînera de découvertes en découvertes, jusqu’au plus profond du désert d’Atacama... Condor est une plongée vertigineuse dans l’héritage encore très présent de la dictature de Pinochet. Son intrigue est habitée par la violence et les vicissitudes de l’Histoire chilienne. Mais il y a aussi chez Caryl Férey cet attachement viscéral aux peuples originaires et à leurs traditions, aux opprimés et aux combattants de l’injustice... et une foi profonde en l’Humanité.
Page — L’Argentine était au centre de votre précédent roman Mapuche (Folio policier). Vous faites avec Condor découvrir ou redécouvrir à vos lecteurs l’Histoire politique et sociale d’un pays voisin, le Chili. L’Amérique du Sud vous habite-t-elle au point qu’il vous semblait ne pas en avoir fini avec elle ?
Caryl Férey — J’ai rencontré les Mapuches au Chili et constaté que leur situation était bien différente là-bas, où les contestataires sont considérés comme des terroristes – la loi datant de Pinochet ne s’applique plus à personne, sauf à eux, c’est-à-dire que les Droits de l’Homme s’arrêtent à ceux des Mapuches, le plus souvent des militants écologistes. L’Histoire du Chili est proche de celle de l’Argentine, sorte de frère et sœur ennemis. C’est aussi un continent riche en enseignements, historiques et politiques. La barrière de la langue fait qu’on a peu de nouvelles de là-bas, mais les combats y sont emblématiques du monde actuel. C’est ce que j’essaie de retracer à travers le roman.
Page — Gabriela, l’héroïne de Condor est une Mapuche. Ce peuple, ces « gens de la terre », étaient déjà au cœur de votre précédent roman. Vous donnez le sentiment d’avoir voulu cette continuité tout en cherchant à aller plus loin encore dans la découverte du destin, des coutumes et des croyances de ce peuple.
C. F. — C’est difficile de comprendre un peuple qui pense le monde d’une autre manière que nous, Occidentaux. Mais j’ai deux armes avec moi, la curiosité et l’empathie. En gagnant leur confiance, je gagne aussi le droit de les défendre, ce qui n’est pas évident vis-à-vis d’un « Winka » comme moi. Mais j’avais aussi envie de parler des autochtones normaux, comme vous et moi, de gens qui aspirent à des métiers comme celui de Gabriela, vidéaste. Même si leur côté mapuche les rattrape... C’est une longue histoire, que je tente de décrypter à travers Condor. Il y a une dimension mystique dans le livre, liée au pays mais surtout à ses peuples autochtones. C’est aussi pour cela que Condor n’est pas une sorte de Mapuche II.
Page — Le Chili de Pinochet ne se résume pas à l’histoire des victimes et des bourreaux. Le traumatisme de la dictature est encore sensible bien des années après. Le personnage d’Esteban, fils d’un héritage douloureux, en est l’incarnation. Que symbolise-t-il pour vous ?
C. F. — Le Chili est tellement plombé par l’héritage de Pinochet (à titre d’exemple, la Constitution est restée celle de la dictature), que j’avais besoin d’un personnage qui incarnait à la fois le non-partage des richesses, mais aussi quelqu’un de haut en couleur. On peut être riche et avoir des scrupules – si, si ! Esteban symbolise cet écart social, mais son acharnement à tout saboter peut le rendre sympathique, du moins sans manichéisme. Il est aussi l’âme d’un pays qui crève de cet écart social. Et puis j’avais déjà traité l’aspect victimes et bourreaux de la dictature avec mon roman argentin. Condor est d’une autre veine, moins violente (l’insécurité est sociale au Chili, même s’il nous est arrivé quelques mésaventures), mais pas follement gaie non plus... La jeunesse chilienne, qui n’a pas connu la dictature, est aujourd’hui l’espoir du pays, notamment à travers le droit à l’éducation (toujours réservée aux riches).
Page — Le condor, symbole de l’Amérique du Sud et de la cordillère des Andes, est un oiseau de proie ; c’est un rapace charognard, mais il est surtout l’oiseau terrestre qui possède la plus grande envergure au monde une fois ses ailes déployées. Tout comme le plan Condor des années Pinochet, plan qui se propagea secrètement, mortellement et mondialement. Est-ce que ce titre était une évidence ?
C. F. — Oui, totalement. Le pays est une bande de 4 000 kilomètres, semblable aux ailes déployées du condor, un pays géographique – volcans omniprésents jusque dans la culture mapuche, avec les Andes qui délimitent les frontières et interdisent tout accès par la terre, et ses terribles tremblements de terre qui dévastent régulièrement le pays. Quant au plan Condor, établi par Pinochet et les autres dictateurs de la région, il inaugurait l’élimination systématique des opposants sans autre forme de procès, non seulement dans les différentes dictatures sud-américaines, mais dans tous les pays du monde, y compris aux états-Unis, malgré l’appui de la CIA au plan Condor. C’est à la fois lamentable et passionnant. On peut noter aussi qu’aujourd’hui, l’Administration américaine opère un plan Condor de la même échelle... mais avec des drones. Au Chili, ce plan Condor est connu mais personne n’a été inquiété.
Page — Condor est une enquête, une quête, des destins qui rejoignent la grande Histoire, c’est un roman qui nous malmène par sa violence, son évocation de la noirceur de l’âme humaine. Pourtant, j’ai envie de vous dire, Caryl Férey, que c’est l’amour qui reste au cœur de votre livre…
C. F. — Heureusement suis-je tenté de dire, le reste est assez plombant, non ? Cette remarque est valable en Europe avec les menaces d’attentats et le retour des religions. L’amour est ce qui nous soude envers et contre tout – il suffit d’être amoureux pour savoir que le reste, au fond, compte peu. Mes personnages sont liés par ces amours, présents ou passés. C’est ce qui nous restera à la fin de notre vie, pas l’argent présent sur notre compte en banque. C’est cette force de vie que mes personnages déploient, même s’ils s’y brûlent. On est, de loin, plus fort quand on fait les choses par amour. Ce n’est pas être excessivement sentimental, c’est juste mettre les sentiments à leur place, la première. Mes héros sont comme ça.
Page — Tous vos romans semblent avoir pour point commun de dépeindre des personnages aux destins souvent brisés. Or, ils font preuve d’une force de vie hors du commun. Est-ce pour vous la principale caractéristique de l’être humain, cette faculté de vivre malgré tout ?
C. F. — Oui, totalement. Je me vois mal dépeindre des personnages neutres, déprimés chroniques ou égoïstes. Face à des situations dures, comme celles du Chili où les gens n’ont presque aucun droits sociaux, il faut se battre avec ses armes – les sentiments, encore. De toute façon, on le voit dans l’Histoire des hommes, de Auschwitz à la Kolyma, les humains sont capables de résister à tout. Pas tous. Mes personnages sont des combattants. De préférence proches des plus fragiles ou des opprimés – à commencer par les femmes devant la domination masculine.
Page — À l’intérieur de Condor, il y a un livre dans le livre. Un texte écrit par Esteban Roz-Tagle, L’Infini brisé, allégorie d’un Chili qui fut le premier pays néolibéral au monde après le coup d’État de Pinochet en 1973, mais allégorie aussi d’un Chili qui est un champ de ruine aujourd’hui. Un projet original est né de ce texte : une lecture musicale de Bertrand Cantat, ManuSound et Marc Sens. Comment est né ce projet ?
C. F. — Je trouve les lectures classiques un peu soporifiques. J’ai inauguré un genre de lecture disons plus électrique avec Zulu et Mapuche, mais avec Condor j’avais ce texte hybride, L’Infini cassé, qui se prêtait à une autre forme de lecture puisque très imagée. Les deux musiciens (Marc Sens à la guitare électrique et Manu Sound aux sons/basse) faisaient partie des premiers projets, mais il me fallait une voix masculine. La vie a fait que j’ai retrouvé Bertrand Cantat lors d’un festival où l’on « jouait » Mapuche pour la dernière fois, on a bu des verres tous les quatre et on a eu envie de faire « un truc ensemble ». Bertrand a aimé le texte, il connaît l’histoire du Chili de près pour avoir des amis réfugiés... Bref, c’était l’occasion de mélanger ces talents. Comme voix, je ne pouvais rêver mieux. On va faire une petite tournée en Province et en Belgique, avec des rencontres dans des librairies partenaires de salle de spectacles, pour montrer que le livre, aussi, est vivant.