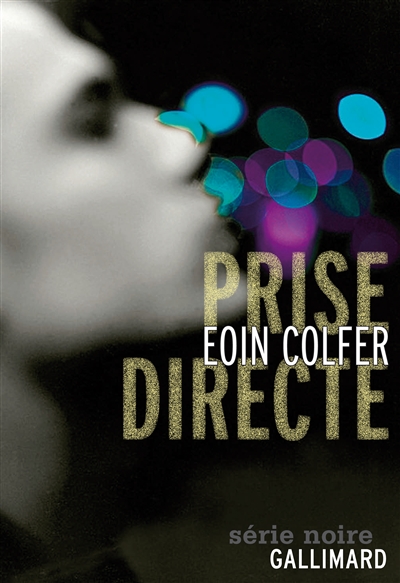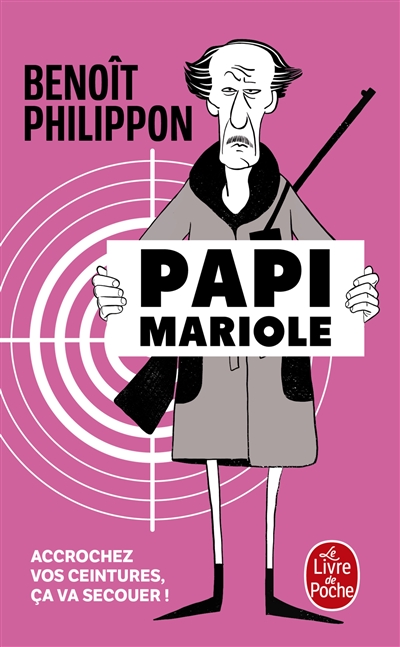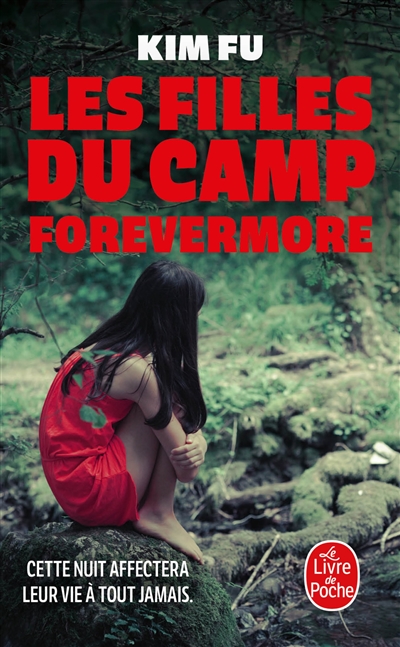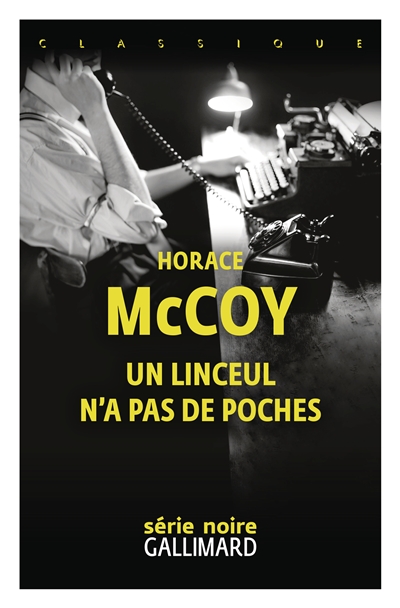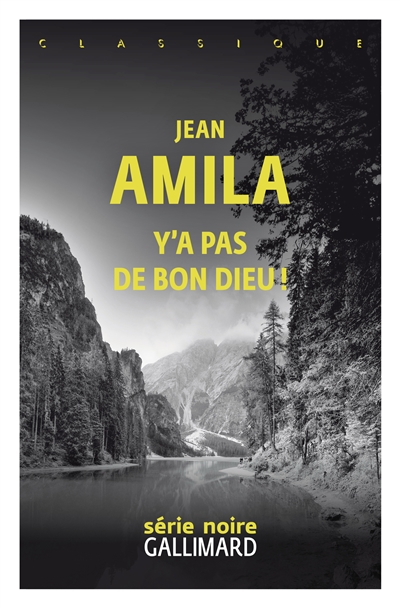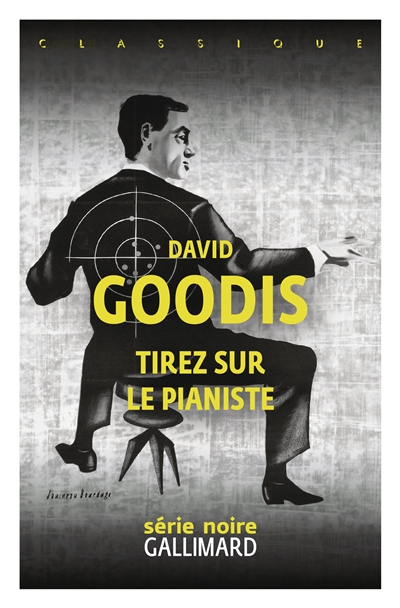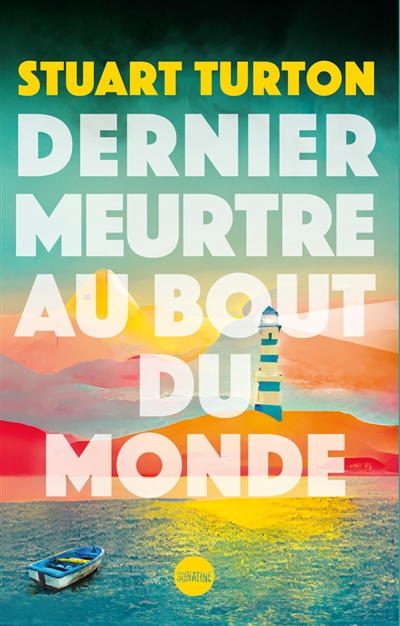PAGE : Quatre ans après Zulu, vous êtes de retour avec Mapuche ; après l’Afrique du Sud, l’Argentine est le théâtre de votre dernier roman. Vous avez certainement beaucoup lu pour connaître si bien l’Argentine et ses fêlures. Avez-vous également passé du temps là-bas pour prendre le pouls de cette société argentine du début du xxie siècle ?
Caryl Férey : Oui bien sûr, je ne conçois pas ce type de livres sans partager l’émotion des gens. On peut lire ou voir ce qu’on veut, rien ne remplace (heureusement) le contact humain. J’ai aussi rencontré la diaspora argentine à Paris, réfugiés politiques pour la plupart.
P. : Pourriez-vous nous expliquer qui sont les Mapuches ?
C. F : Ils sont la principale nation autochtone du sud des Amériques, les seuls à avoir repoussé l’impérialisme Inca. Comme d’autres à la même époque, ils ont été brutalement chassés de leurs terres, massacrés dans la pampa et réduits à se réfugier dans des régions pauvres. Ils sont 3 % en Argentine, 8 % au Chili, où ils vivent depuis plus d’un siècle comme des fantômes. C’est un des liens avec les disparus de la dictature argentine.
P. : Chacun de vos grands romans de l’ailleurs, Haka, Utu, Zulu et maintenant Mapuche, s’attache à faire connaître l’histoire des peuples originels... et à travers eux l’hypocrisie de sociétés qui nient leur passé et leur histoire, souvent bâties sur le mensonge, la violence et la mort. Est-ce une volonté affichée de votre part ?
C. F : Oui, radicalement. Redonner la parole à des peuples niés. J’insiste : l’Occident, fier parfois à juste titre de sa technologie, n’a pas le monopole de la raison. Les peuples autochtones pensent le monde d’une manière originale ; essayer de la comprendre, c’est ouvrir le spectre de sa propre pensée... Quant à nos richesses, il est clair que sans le pillage des leurs depuis des siècles, « on » n’en serait pas là. Où en sommes-nous d’ailleurs ?
P. : Dans Mapuche, la question de la vérité et du doute est, me semble-t-il, omniprésente ? Le besoin de savoir pour pouvoir faire son deuil, comme les fameuses Mères de la place de Mai qui veulent découvrir ce qu’il est advenu de leurs disparus ; la vérité sur les origines des milliers d’enfants adoptés, des enfants arrachés à leurs parents durant le Processus... Faut-il toujours connaître la vérité ?
C. F : « La vérité est comme l’huile dans l’eau », disent les Grands-Mères de la Place de Mai : « elle remonte toujours à la surface ». Un pays sans vérité est un pays sans mémoire, et donc sans Histoire. C’est valable pour les enfants de disparus adoptés par des proches du pouvoir, comme pour les parents ou amis des victimes : sans corps, pas de deuil possible. Le combat de ces femmes depuis plus de trente ans est exemplaire, formidable de pugnacité. Je m’en remets à peine.
P. : À la lecture du chapitre intitulé « Le cahier triste », la terrible puissance des mots m’a ébranlé. Comment garder foi en la nature humaine lorsque l’humanité semble avoir quitter les hommes ?
C. F : Je n’ai malheureusement rien inventé pour ce qui concerne l’épouvante des conditions de détention des « subversifs ». Cette question d’humanité (ou non), je me la suis longtemps posé avec Auschwitz. Puis j’ai lu la biographie d’Hitler de Kershaw : pas de doute, tout ça est bien de l’Homme. C’est ce qui est pénible avec notre espèce. Le meilleur et le pire.
P. : L’empathie semble être votre moteur. Comment expliquer autrement la belle humanité de vos personnages, Jana la Mapuche ou Rubén le rescapé ? L’amour reste-t-il toujours le plus fort ?
C. F : Pas plus fort, non – et c’est un autre malheur – mais il reste le moteur, vous l’avez dit. L’empathie est une forme d’amour que je revendique, justement pour ne jamais sombrer vers la barbarie, mais aussi pour tenter de vivre en harmonie avec nos proches ou les gens qu’on peut côtoyer. Écouter c’est déjà comprendre. Et se coucher chaque jour moins bête qu’on s’est levé. Tous les gens que j’ai rencontrés depuis quatre ans pour ce livre m’ont donné beaucoup. J’espère leur rendre au maximum.
P. : Si je peux me permettre de donner mon avis, je crois que Mapuche est le plus beau cadeau que vous pouviez leur faire ! Mais vous, l’écrivain, comment arrivez-vous à vous remettre au travail après un tel investissement personnel et humain ?
C. F : Merci pour eux. J’espérais me reposer un peu (je travaille trop à mon goût) mais j’ai très vite été happé par des projets « reculés » par le retard de Mapuche que j’espérais sortir en octobre – une BD, la suite de Krotokus (roman jeunesse), un projet de série pour Canal... et un imminent voyage d’agrément au Japon. Mais c’est vrai que mon cœur est toujours argentin – et pour un moment je crois.
P. : Pour terminer, le libraire que je suis est curieux de savoir quelles sont les lectures qui vous font avancer, arrivent à vous émouvoir, vous étonner ou vous secouer... et vous font « vous coucher chaque soir un peu moins bête que vous ne vous êtes levé » ?
C. F : Raoul Vaneigem, toujours, un de mes maîtres à penser (pour garder votre image), j’ai aussi adoré Cavalier seul de Patricio Manns (Chili), plus récemment j’ai beaucoup aimé la « Série Noire » de Karim Madani, passée trop inaperçue.
P. : Pour terminer, je citerai justement votre Maître, Vaneigem : « La seule façon de ne pas s’atrophier dans une société qui débonde en destructions absurdes la rage de ne pas vivre, c’est de construire des situations où créer son bonheur quotidien enseigne à créer une société toujours plus humaine. » Aller à la rencontre, grâce à vous, de Jana, Rubén, des Mères de la place de Mai, c’est partager l’espoir d’une société toujours plus humaine…Merci Caryl Férey.