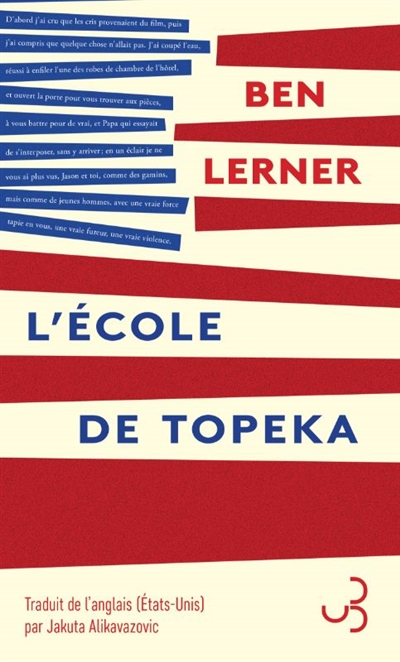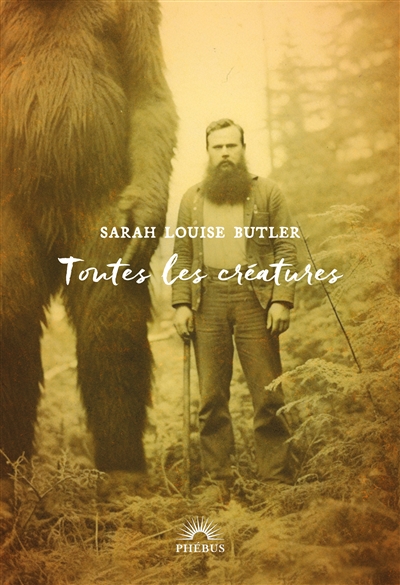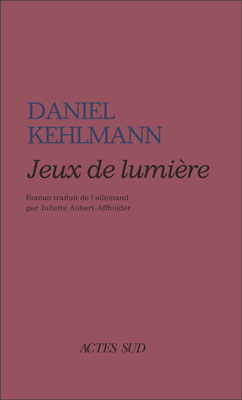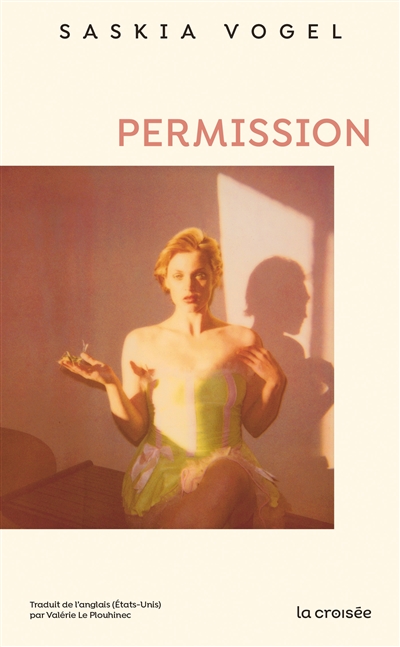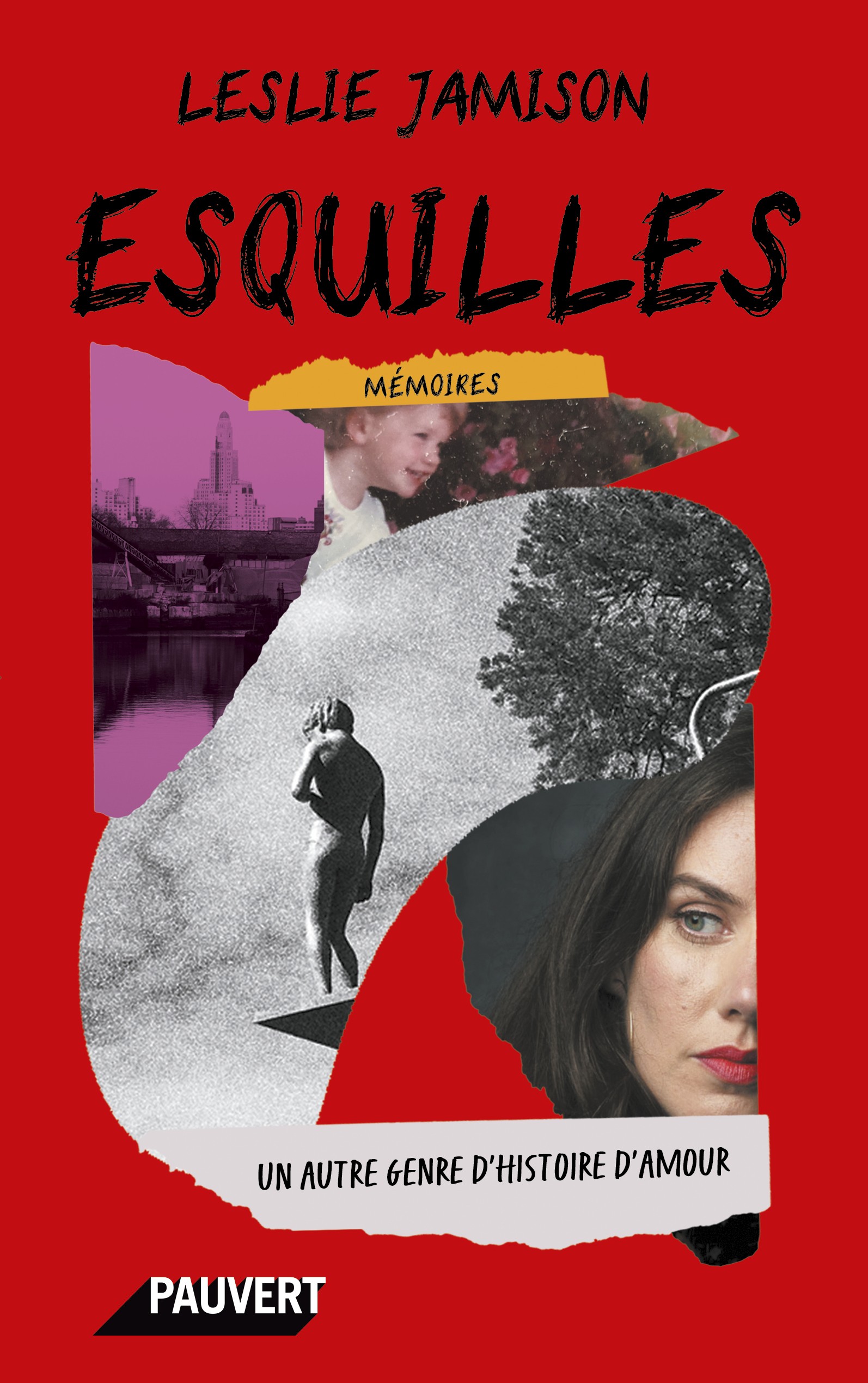Quel a été le point de départ de ce roman qui foisonne de sujets ?
Ben Lerner - Peut-être lorsque je suis devenu parent et qu’il m'est devenu possible d'imaginer mon enfance du point de vue de mes parents. Comme lorsque vous regardez un bonsaï et que vous vous imaginez à la fois sous l'arbre et flottant au-dessus. Ce dédoublement de perspective est partout dans ce roman : j'écris depuis le présent en tant que parent mais je suis aussi redevenu un enfant à Topeka. Devenir parent m'a également fait prendre conscience de l'étrangeté de la transmission – comment vous communiquez toujours plus à vos enfants que vous ne le souhaitez et comment vous devenez plus conscient que jamais de la façon dont votre propre voix est une construction intergénérationnelle sur laquelle vous n'avez qu'un contrôle limité.
Pourquoi avoir choisi les années 1990 ?
B. L. - Les années 1990 ont été une décennie au cours de laquelle le libéralisme américain avait soi-disant triomphé. On parlait beaucoup de la « Fin de l'Histoire ». Avec la chute de l'Union soviétique, il y avait cette affirmation que l'idéologie était finie et que les technocrates du baby-boom allaient résoudre tous les problèmes. Et pourtant, tout n'allait pas bien en Amérique – un symbole de la maladie était l'incroyable violence nihiliste qui circulait parmi les hommes blancs de la classe moyenne, quelque chose de central dans mon roman, quelque chose que ma génération associe au massacre de Columbine comme un signe avant-coureur. Maintenant que la guerre froide est de retour, le triomphalisme des années 1990 est d'autant plus fascinant et absurde.
Comment avez-vous écrit sur la langue qui est, peut-être, le véritable personnage principal°?
B. L. - Peut-être que le véritable point de départ de ce roman est quand j'ai mesuré que mes expériences avec des types de discours extrêmes à Topeka en tant qu'adolescent – la compétition des débats, les freestyle d'enfants blancs, mon amour de la poésie – étaient en relation intéressante avec la faillite radicale de discours politique, les représentations vides presque dadaïstes de la parole par les politiciens américains. Et la propagation écrasante et débilitante de Twitter, des vagues sans fin de (dés)information. C'est un livre qui essaie de mettre ma propre relation à la parole face aux bégaiements de la parole publique en Amérique ; et qui interroge aussi le fait de grandir entre deux cultures distinctes de cette parole : Adam Gordon est élevé par des thérapeutes qui sont à Topeka parce qu'ils travaillent dans un célèbre institut psychothérapeutique mais la culture qui l'entoure croit que parler – à moins que vous ne disiez de la merde – est une sorte de faiblesse. Je crois que la conversation est un des grands sujets des romans. Je pense à l'incroyable attention ethnographique de Proust, à la façon dont les différences de discours expriment les différences de classe, de milieu, etc.
Les hommes, par la colère, par la violence, semblent sous pression. D'où cela vient-il ?
B. L. - Je ne pense pas qu'il y ait une seule réponse mais peut-être que pour deux jeunes hommes dans le livre – Adam et Darren – la réponse est que la masculinité blanche EST souvent cette pression, celle de passer pour un homme, un vrai. Malgré toutes leurs différences, ils sont tous les deux défigurés par ce désir d'être assez cool, assez durs et par leur terreur que l’on se rende compte qu’ils ne le sont pas. Et cela les conduit tous les deux à des performances de violence (et à des appropriations tragi-comiques).
Le livre révèle pourtant un côté positif.
B. L. - Oui : l'espoir qu'Adam a appris beaucoup plus que la simple domination, voire militarisation, de l'éloquence, qu'il est curieux de connaître la généalogie de sa propre voix et la possibilité de relations qui ne soient pas régressives (au sens individuel comme au sens politique). L'espoir est que le livre lui-même soit un exemple d'utilisation du langage pour autre chose que de la démagogie – une petite chose que la littérature peut faire est de modéliser des possibilités alternatives de langage et d'écoute. Mais bien sûr, le livre n'est pas seulement diagnostique – il est personnel et étrange et, espérons-le, aussi drôle et chargé de diverses manières.
À propos du livre
Nous sommes au cœur des années 1990, les États-Unis dominent le monde comme jamais et le futur semble tout tracé. À Topeka, ville du Kansas, Adam Gordon grandit. Fils de thérapeutes de la Fondation, un établissement de recherche en psychiatrie, il est aussi un champion de concours de débats au travers desquels s'affrontent les universités. Mais ses dons ne l'empêchent pas de se heurter au passage à l'âge adulte. L'école de Topeka réussit le pari d'être autant cérébrale (la question de la parole est un des sujets essentiels du roman) que physique (les rapports de force sont omniprésents), interrogeant avec brio la masculinité américaine, ses vertiges, les colères qui irrémédiablement conduiront à l'effondrement démocrate et l'arrivée de Trump. Imaginez un Jonathan Franzen fasciné par En Thérapie mais qui n'aurait pas pour autant abandonné l'idée d'écrire son Fight Club.