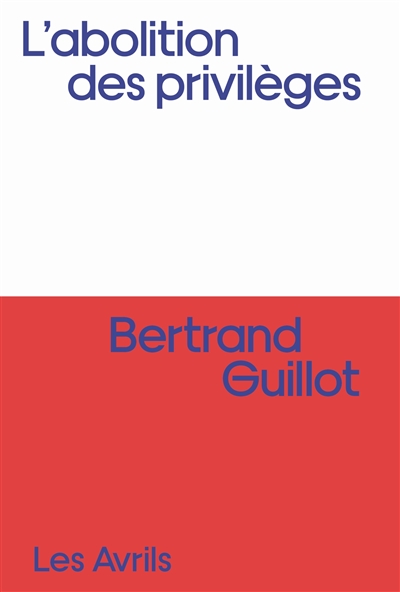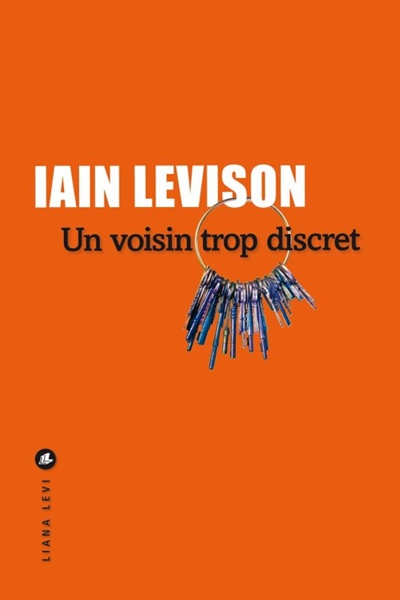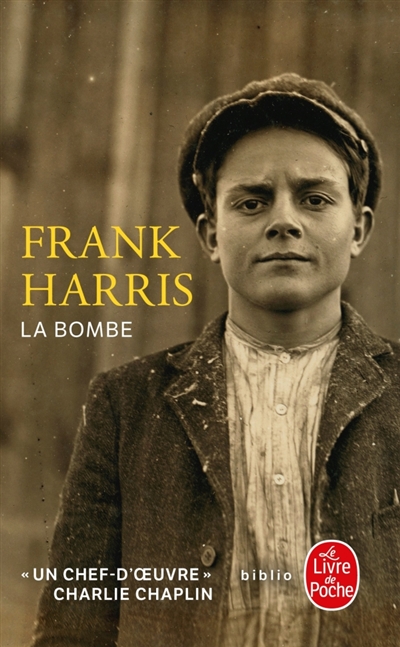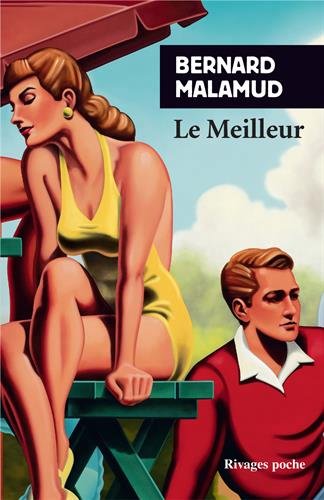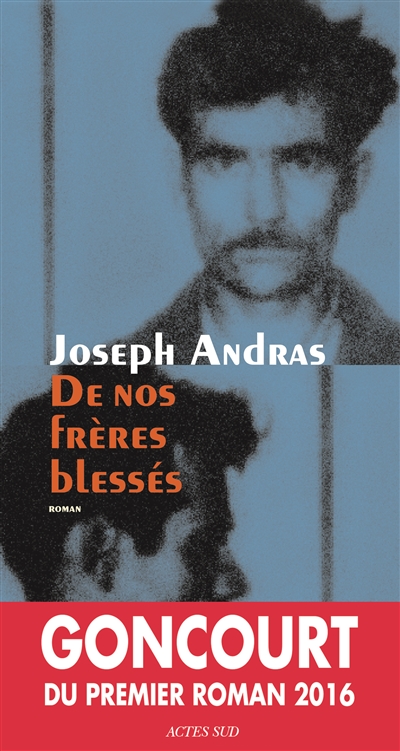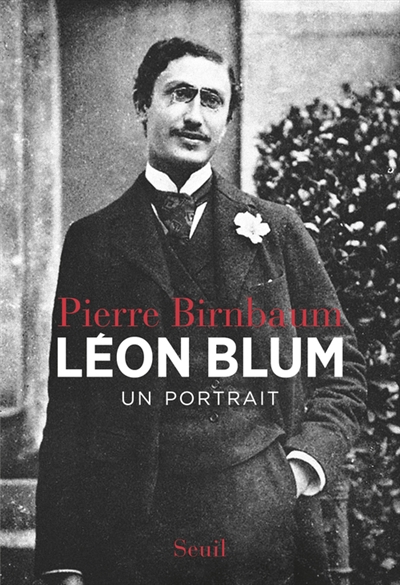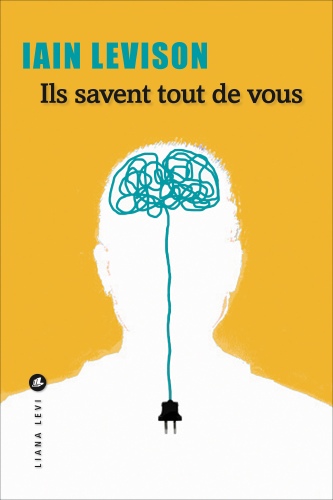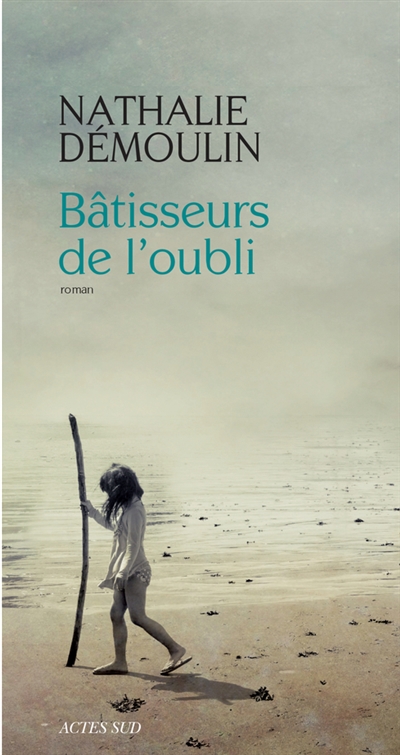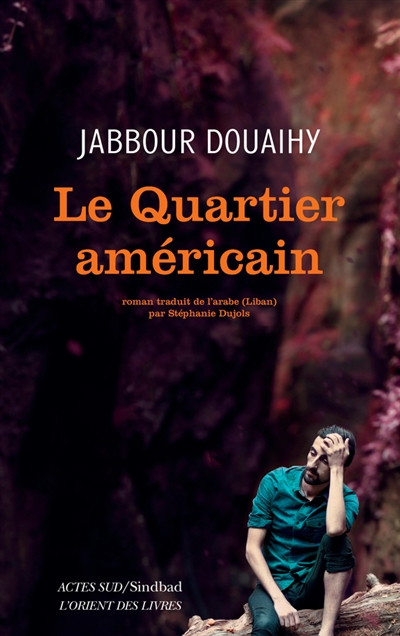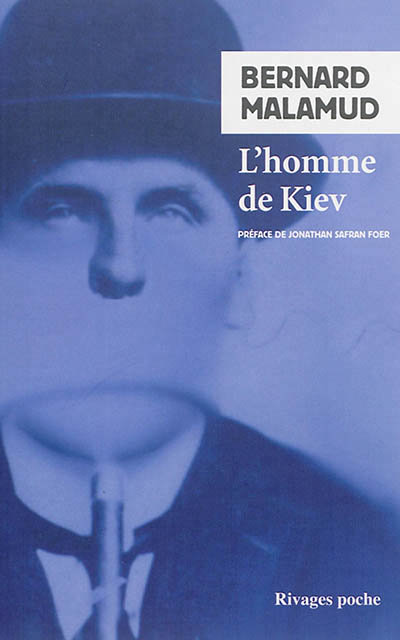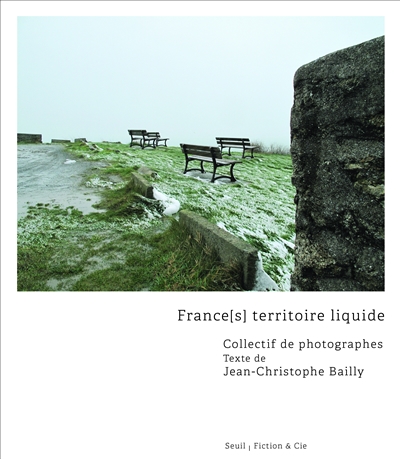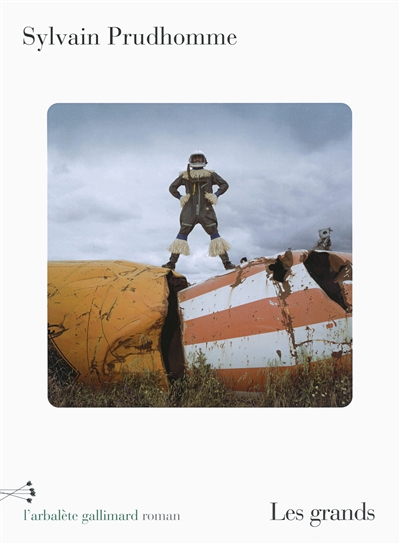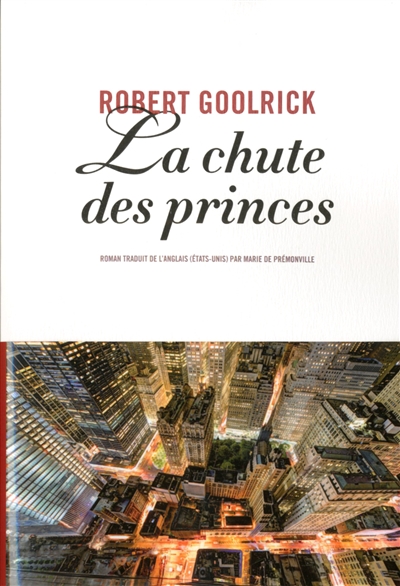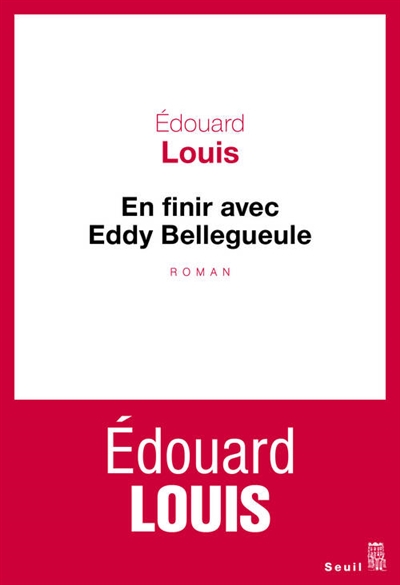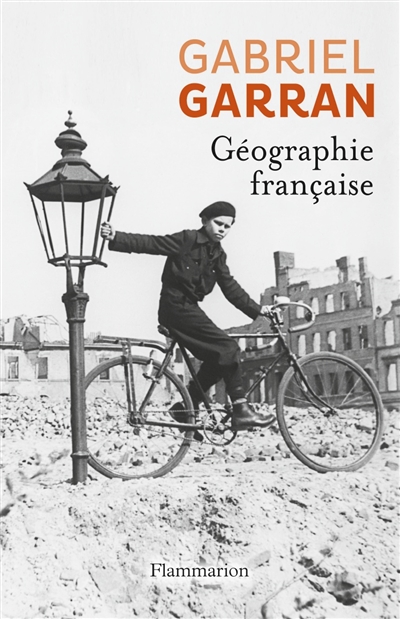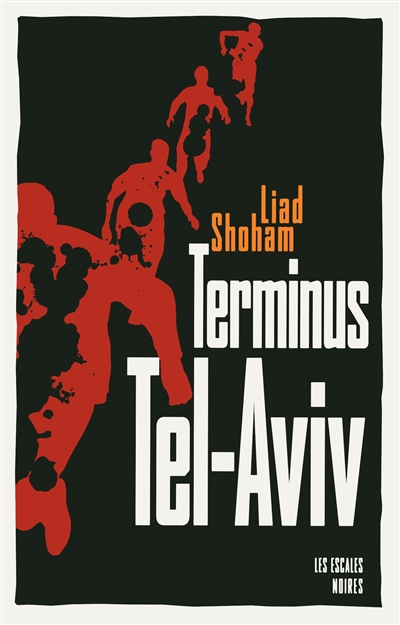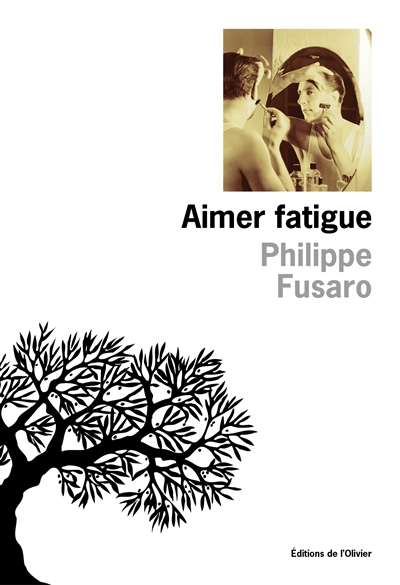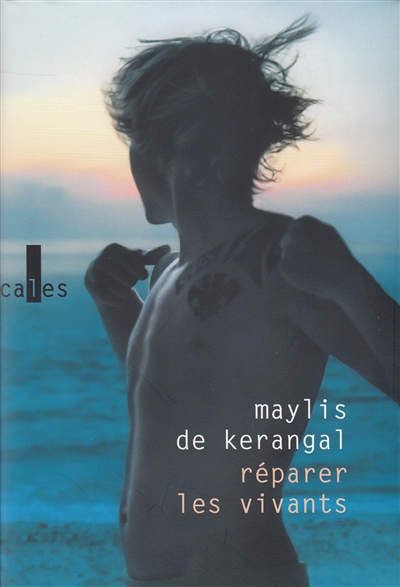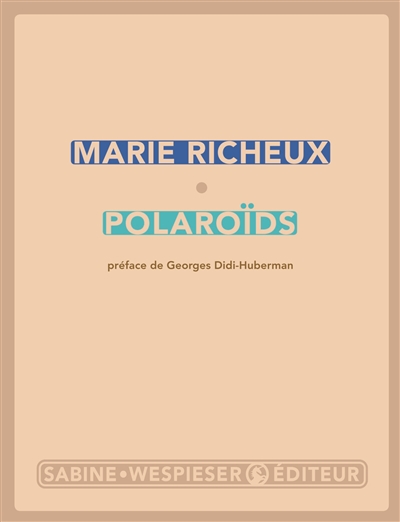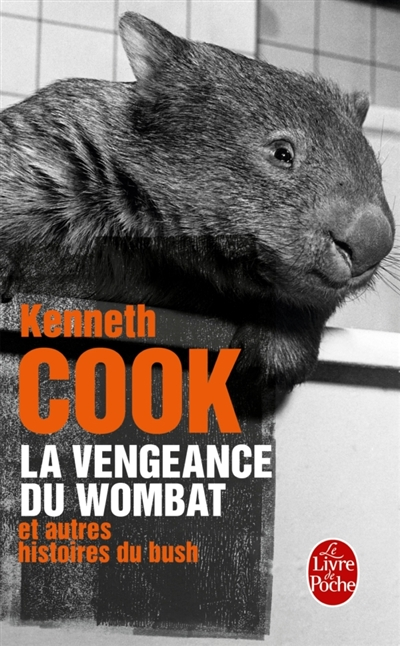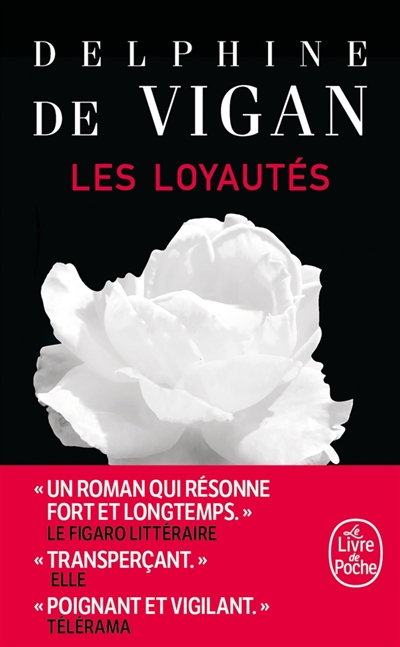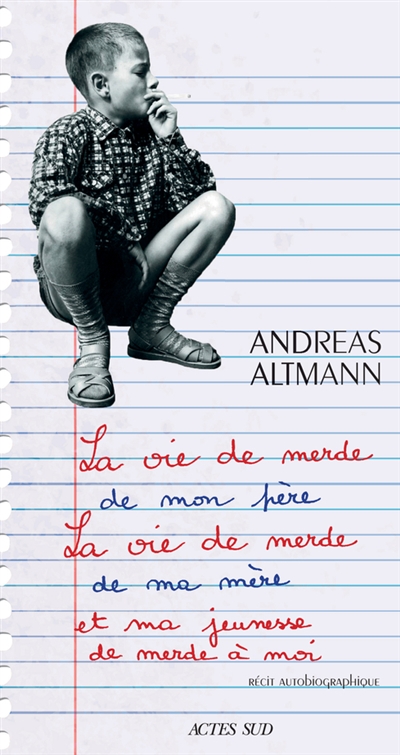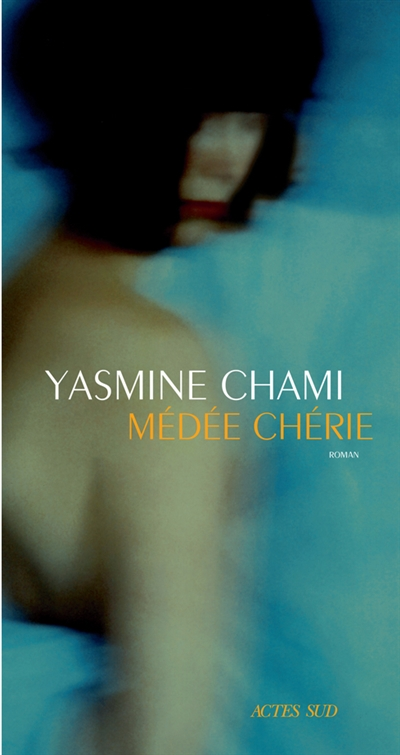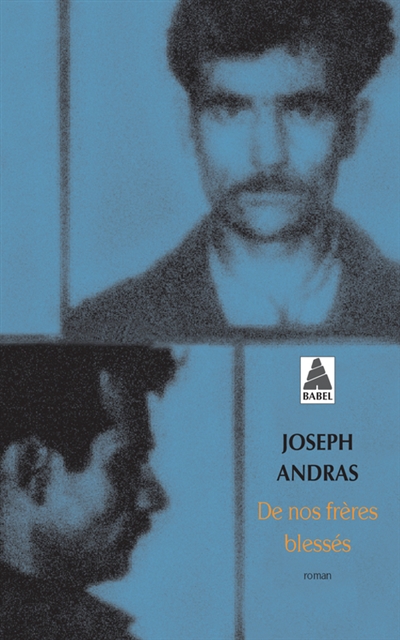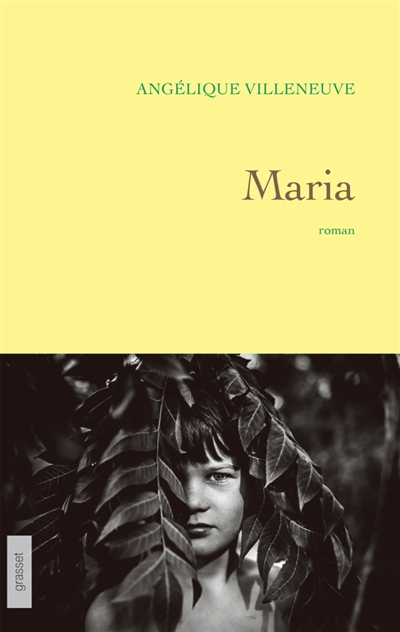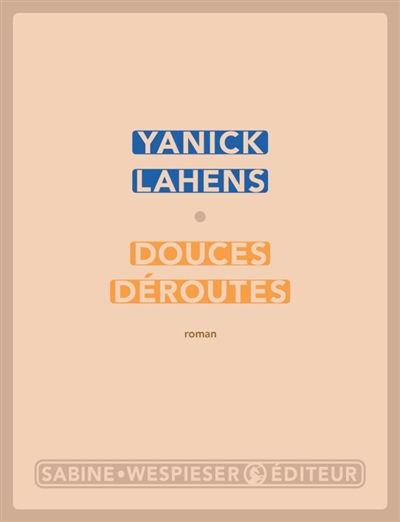Littérature française
Delphine de Vigan
Les Loyautés
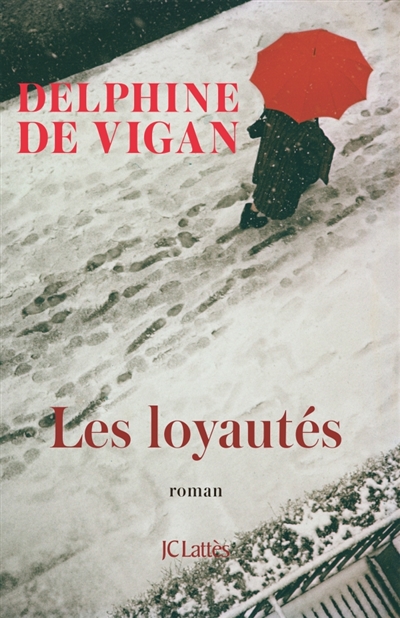
-
Delphine de Vigan
Les Loyautés
JC Lattès
03/01/2018
208 pages, 17 €
-
Chronique de
François Reynaud
Librairie des Cordeliers (Romans-sur-Isère) - ❤ Lu et conseillé par 47 libraire(s)
✒ François Reynaud
(Librairie des Cordeliers, Romans-sur-Isère)
Pourquoi certaines personnes sont-elles plus sensibles que d’autres à la souffrance et la détresse muette qui les entourent ? Dans Les Loyautés, Delphine de Vigan répond à cette question en nous offrant un roman que l’on lit dans un sentiment d’urgence absolue, sur les traces d’un collégien à la dérive.
Parce qu’elle a été violentée par son propre père durant des années et parce qu’elle-même a su le cacher aux yeux de ses professeurs et de ses camarades de classe en se faisant plus transparente qu’un fantôme, Hélène, devenue professeure de français d’un collège parisien reconnaît tout de suite Théo comme « l’un des siens ». Ce qu’elle reconnaît en cet élève, c’est ce mutisme, ces yeux rouges liés au manque de sommeil et l’attitude fuyante de celui qui ne veut pas attirer l’attention. Ils sont pourtant nombreux les collégiens qui ne dorment pas assez et se font tout discret au fond de la classe dans cet établissement. En quoi le comportement de Théo serait-il plus inquiétant que celui de son camarade de banc qui offre le même visage fatigué à cause, certainement, d’une surconsommation nocturne de jeux vidéo ? Certes, l’infirmière de l’établissement a signalé cet élève comme « fragile », mais aucune suite n’a été donnée à cette affaire. C’est qu’il faut avoir un radar intime particulièrement sensible comme celui d’Hélène pour intercepter certains signaux de détresse. C’est ce que Delphine de Vigan appelle les « loyautés ». Ces « liens invisibles qui vous attachent aux autres […] des promesses, des fidélités silencieuses […] des lois de l’enfance qui sommeillent à l’intérieur de nos corps… ». C’est une attention aux autres qui ne s’apprend pas, quelque chose d’instinctif qui précède le verbe, quelque chose d’irrationnel, le pressentiment d’un précipice qui approche. Le lecteur familier de l’œuvre de Delphine de Vigan ne connaît que trop cette impression d’une écriture qui file en permanence sur un fragile chemin à flanc de falaise et résiste comme elle le peut à l’appel du gouffre. Et le gouffre dont il est question dans ce nouveau roman, c’est celui de l’ivresse alcoolique, de son bonheur quand il ressemble à l’oubli. Objet d’un divorce vraiment « pourri », Théo a trouvé dans l’alcool une façon de mettre le monde à distance. Il est tantôt l’éponge d’un père enfermé – verrous et volets – dans une dépression sans issue et le dévidoir à rancœurs d’une mère emplie de haine envers son ex-mari parti pour une autre. Il n’a pas plus d’existence à leurs yeux que celle d’un tampon coincé entre deux souffrances. Devenu expert en la manière de se procurer une bouteille de vodka ou d’autre chose, il se cache dans les couloirs du collège et, à l’abri des regards, partage le goulot avec son camarade Mathis. Il plonge alors dans un univers bienveillant, une « matière hydrophile, invisible, qui le protège » enfin. Il a 12 ans, il est alcoolique. Dès la première ligne de ce roman, le lecteur est saisi. Le tour de force de Delphine de Vigan est de nous faire ressentir l’urgence de la situation et de nous entraîner aux côtés d’Hélène dans une course contre la montre. Nous tournons les pages comme dans un sprint espérant, peut-être, prendre de vitesse l’affreux pressentiment qui se dessine au loin. Arriverons-nous à prendre la main de Théo avant que l’irréparable n’advienne ?