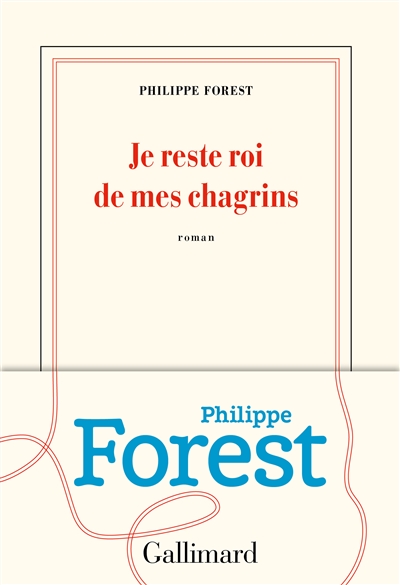Une passionnante anecdote peu connue du grand public, un personnage central devenu une légende : tout cela aurait pu fournir assez de matière à un roman historique de facture classique avec la présentation de ses protagonistes, son déroulé, ses conclusions a posteriori. Oui mais même si tous ces éléments trouvent leur place ici, s'accompagnant d'un délicieux suspens quant à l'issue pour le moins incertaine du récit, ils n'en constituent pas moins qu'une partie. En effet, Philippe Forest convoque le monde du théâtre et certains de ses codes, invite la peinture à prendre une place essentielle dans le déroulé, dispose ici et là de redoutables jeux de miroir et installe un narrateur de prime abord mystérieux qui commente le roman de l'intérieur. Il conduit ainsi la confrontation de ces deux hommes que tout semble opposer jusqu'à des territoires insoupçonnés, d'une rare beauté, signant ce qui est sans doute son meilleur roman depuis Le Siècle des nuages.
PAGE — Pouvez-vous nous présenter les deux personnages qui sont au cœur du livre ?
Philippe Forest — Le premier est Winston Churchill qui va fêter ses 80 ans. Il est sur la fin de sa carrière politique mais toujours Premier ministre du Royaume-Uni. Le livre raconte sa rencontre avec un peintre, Graham Sutherland, oublié aujourd’hui mais qui, à l’époque, est considéré comme le grand peintre britannique avec Bacon. Sutherland est chargé par le parlement britannique de réaliser un portrait de Churchill à l’occasion de l’anniversaire de celui-ci.
P. — Cela ressemble à un cadeau empoisonné : vous avez affaire à quelqu’un qui a passé une grande partie de sa vie à construire lui-même sa légende.
P. F. — Oui et il s’agit aussi de représenter un homme qui se pique d’être lui-même peintre et qui a un regard assez critique sur ce que la peinture contemporaine est devenue. Churchill peint à la manière des impressionnistes : son maître, son Dieu, c’est Monet, alors que Sutherland est un peintre d’après Picasso. Le traitement qu’il va réserver à la figure un peu majestueuse de Churchill ne va pas tout à fait convenir au principal intéressé !
P. — Toute cette histoire est vraie et vous allez vous servir de cette confrontation comme cadre du roman. Sauf que vous avez décidé de ne pas faire un roman historique !
P. F. — Oui, ce qui lui donne un caractère insolite, un peu dans l’esprit de Sarinagara dans lequel j’avais raconté ma propre vie au miroir de l’existence de trois artistes japonais, en essayant d’importer dans le roman français des modèles qui venaient de la littérature japonaise classique et moderne. Là, je me sers de modèles qui concernent à la fois la peinture et le théâtre, plus particulièrement le théâtre shakespearien. Je raconte donc cette histoire en la décomposant à l’aide de ces différents instruments de narration. L’idée que j’exprime dès le début du livre, c’est qu’un tableau est un peu comme un miroir qui réfléchit l’image de celui que le portrait montre mais qu’il réfléchit aussi les traits de celui qui regarde le tableau : ce dernier se regarde dans le miroir que ce tableau lui propose. À partir de là, il y a tout un jeu qui se développe dans le livre autour de ce qui est présenté comme une sorte de pièce de théâtre racontée à l’intérieur d’un roman.
P. — Et le livre va prendre toute son ampleur avec l’intervention d’un narrateur qui raconte la pièce mais qui fait aussi des commentaires, imposant un regard extérieur qui, et c’est l’une des grandes forces du livre, ne démine jamais le sujet mais l’amplifie.
P. F. — Le modèle qui m’a inspiré est le théâtre shakespearien où vous avez l’histoire qui se raconte mais qui ne cesse de se commenter, employant des jeux de miroir notamment par l’intermédiaire d’acteurs qui viennent rajouter leur propre parole au récit. Dans mon roman, il y a ainsi une voix qui flotte un peu dans cette espèce de vide que compose la scène théâtrale qui est aussi la scène romanesque. Cette voix est peut-être celle de l’auteur qui parle de lui-même à travers les personnages qu’il présente. C’est peut-être celle d’un des acteurs ou d’un des personnages.
P. — Un des grands personnages du livre est aussi l’Histoire.
P. F. — Oui, l’Histoire que Churchill incarne plus qu’aucun autre de ses contemporains et l’Histoire saisie en un moment particulièrement pathétique parce que Churchill est vieillissant, qu’il a bien conscience que tout le monde le pousse vers la sortie alors qu’il ne veut pas prendre sa retraite. Il est en ça tout à fait semblable à ces grands rois du théâtre shakespearien qui vont être privés de leur couronne. C’est d’ailleurs ce qui donne son sens à la citation dont j’ai fait le titre de mon roman et qui vient de Richard II : celui-ci vient de perdre sa couronne et dit qu’on peut tout lui ôter mais qu’on ne lui ôtera pas ses chagrins. C’est peut-être ce qui rapproche ce théâtre de la littérature japonaise, l’idée que l’éternité est une sorte de mirage : chacun d’entre nous est comme un fantôme dont les traits se perdent dans un miroir si bien qu’au bout du compte, rien ne reste que le souvenir de ce que l’on a aimé et de ce que l’on a perdu.