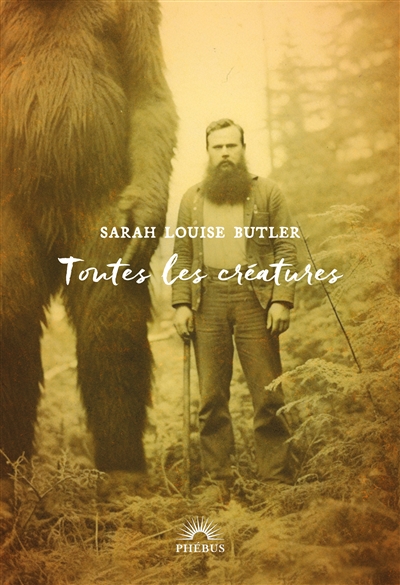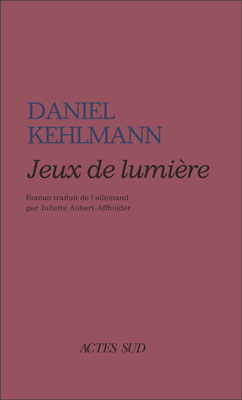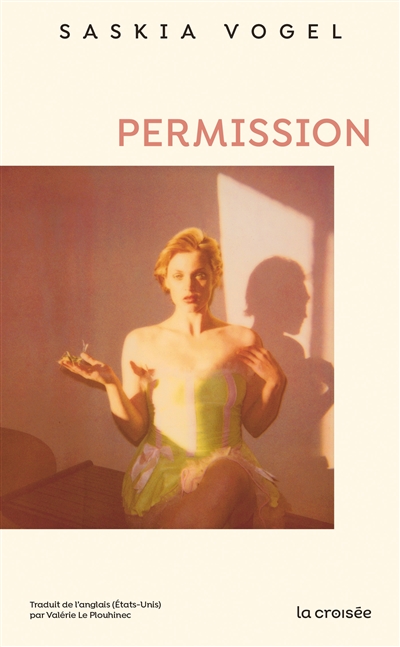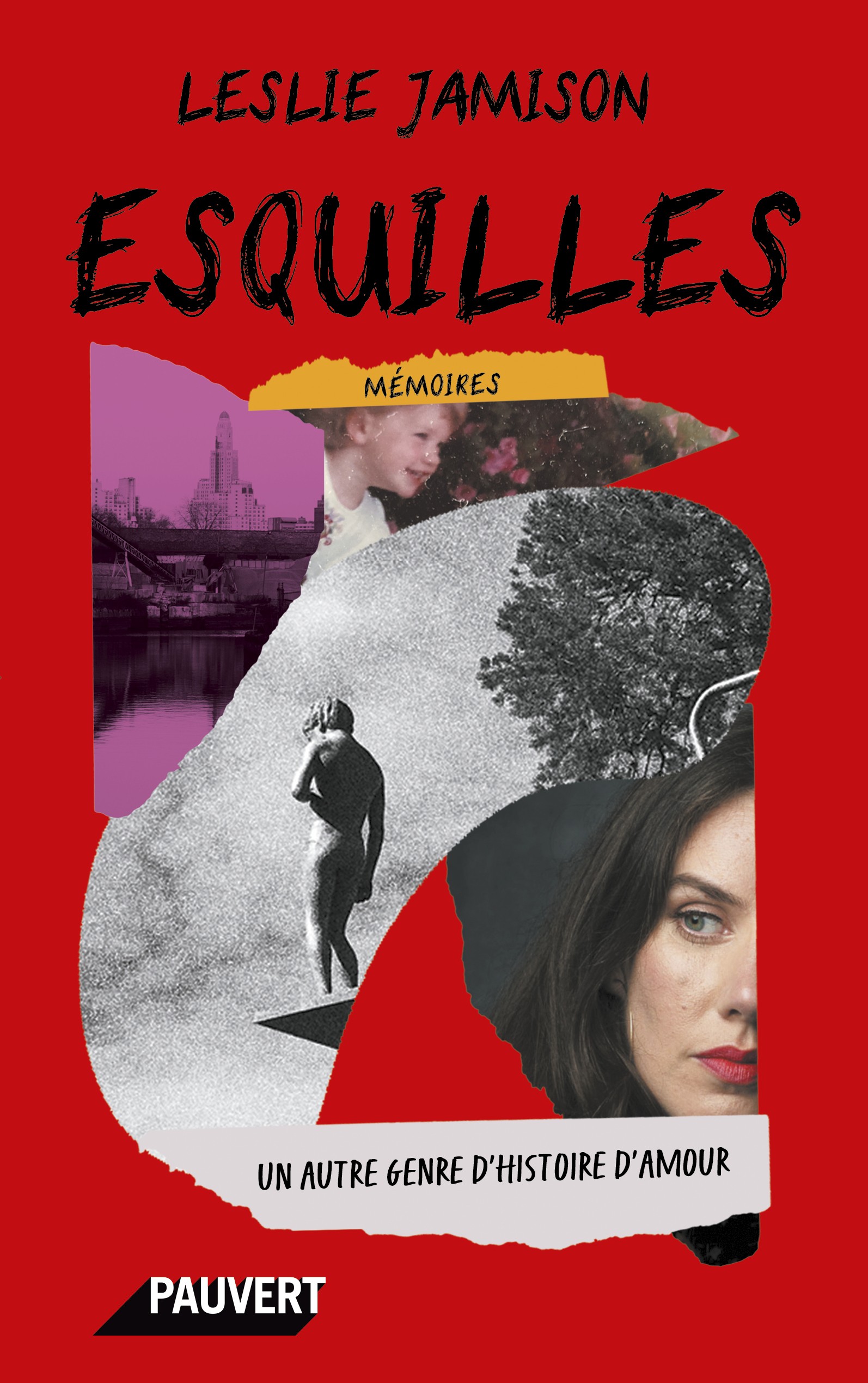Il vit avec sa femme Remedios, qui est un remède évident à l’amour, et Jesús rêve de devenir maire à la place du maire. Mais nous sommes au Mexique où rien n’est simple. Et quand Jesús est mis sur la touche, non par l’opération du Saint-Esprit, mais par un parti cadenassé par les narcotrafiquants, que fait-il ? Il se prend une cuite monumentale, conduit jusqu’au bout de la nuit où il lève un transsexuel tellement mignon qu’il en tombe raide dingue. Mais comme un narcotrafiquant cache toujours un autre narcotrafiquant, le second discrédite le premier, son concurrent le plus proche, et voilà que notre Jesús repart de plus belle à la conquête de la mairie. Oui mais… – car il y a toujours un « oui mais » dans les romans mexicains. Tenter de cacher son homosexualité latente alors qu’on veut concourir pour le maire le plus beau et le moins corruptible, c’est compliqué ! Surtout si l’un des plus gros narcotrafiquants est le jumeau de votre chérie. C’est énorme, foisonnant, beau comme de l’Almodovar grand cru !
Comment avez-vous imaginé ce roman ? Est-ce qu’il suffit de regarder la réalité mexicaine actuelle, de lire les journaux, pour en faire ce livre fou et beau à la fois ?
Enrique Serna — Le point de départ de mon roman fut d’imaginer ce qui arriverait si j’étais un politique honnête et que j’aspirais à gouverner Cuernavaca, qui est la ville où je vis, et cela à une époque où régnait la terreur engendrée par la complicité entre le pouvoir politique et le crime organisé. Mais les vrais héros irréprochables, si parfois ils existent, ne m’ont jamais intéressé en tant que personnages littéraires. C’est pourquoi je souhaitais que mon protagoniste, Jesús Pastrana, traîne depuis son adolescence un acte de lâcheté qui le condamnerait à rester à « l’étage inférieur de sa destinée ». Les investigations journalistiques lancent régulièrement des accusations très claires et concrètes. Actuellement au Mexique, le journalisme est devenu une activité dangereuse, qui nécessite un grand degré de courage. Je pense que la peur a un effet avilissant quand les peuples s’habituent à la supporter pendant longtemps. Le sujet principal de mon roman n’est autre que la peur et ses ravages, et la nécessité de la surmonter, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie civile.
C’est un livre extrêmement drôle, mais aussi terriblement grave sur la politique mexicaine. L’humour est-il la meilleure manière – ou la seule qui reste – pour parler de cette société gangrenée par les narcotrafiquants ?
E. S. — L’humour noir est la colonne vertébrale de mon œuvre. Il y a une intention satirique très claire dans certains passages, car les tribulations sexuelles de Jesús, un père de famille catholique et conservateur qui, à l’âge de 47 ans, ose enfin reconnaître son homosexualité, possèdent un caractère comique que je ne pouvais éviter. Par exemple, j’ai ri aux éclats en écrivant la scène où Leslie le sodomise. Mais je ne pense pas que ce soit une frivolité que d’observer la société mexicaine à travers le spectre de l’humour, malgré toutes les tragédies qui nous accablent. L’esthétique du grotesque a pour but de créer un effet ambigu dans lequel l’horreur se mêle au rire.
C’est aussi un formidable roman d’amour fou entre Jesús et Leslie. Il va enfin découvrir l’amour que lui refusait Remedios, sa femme légitime. Mais n’était-ce pas un peu risqué de raconter cette histoire au Mexique, dans un pays de vieille tradition catholique ?
E. S. — Il est possible que la folle histoire d’amour de Jesús et Leslie m’ait fait perdre des lecteurs, car l’homophobie est très forte au Mexique. Beaucoup de gens rejettent d’emblée les « romans de putes ». Ils ne les ouvrent même pas. J’aime écrire sur les conflits que les gens « décents » préféreraient faire disparaître sous le tapis : c’est, d’après moi, la fonction civilisatrice et cathartique du roman dans le monde moderne. Peut-être est-ce utopique de s’acharner à croire qu’il est possible de moderniser la société mexicaine à travers la littérature, mais je veux insister sur le fait qu’il est urgent pour nous d’être plus tolérants à propos des dérives charnelles qui, finalement, ne nuisent qu’à ceux qui les commettent. Il serait plus utile de se montrer intransigeant avec la corruption politique. Celle-ci génère depuis dix ans des cauchemars : 180 000 morts, des centaines de charniers disséminées dans tout le pays…
Le roman est écrit comme une farce, comme un Don Quichotte moderne, où Jesús Pastrana lutte à sa manière contre la corruption et la mégalomanie de la politique mexicaine. Était-ce votre propos de revisiter le mythe de la littérature hispanique ?
E. S. — En effet, Jesús est un personnage chevaleresque à la façon de Don Quichotte. Beaucoup pensent que la politique est une espèce de maladie vénérienne qui corrompt automatiquement ceux qui la pratiquent, mais je crois que penser ainsi est dangereux et fataliste. Qui plus est, cela signifie perdre complètement l’espoir que les choses s’améliorent. Tout n’est pas pourri au Mexique. Il existe aussi des politiques intègres, comme Jesús Pastrana. C’est pourquoi je pense que notre démocratie naissante pourra se régénérer avec le temps.