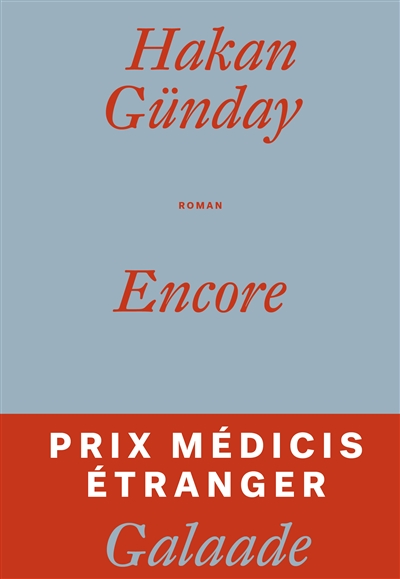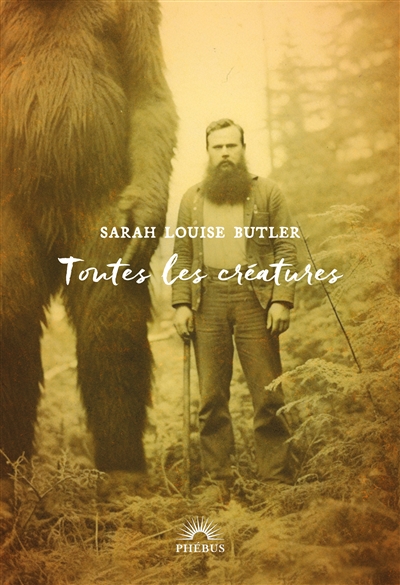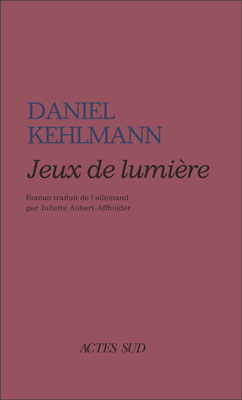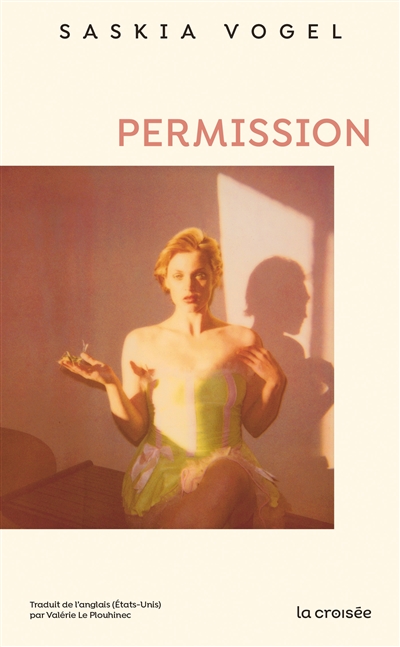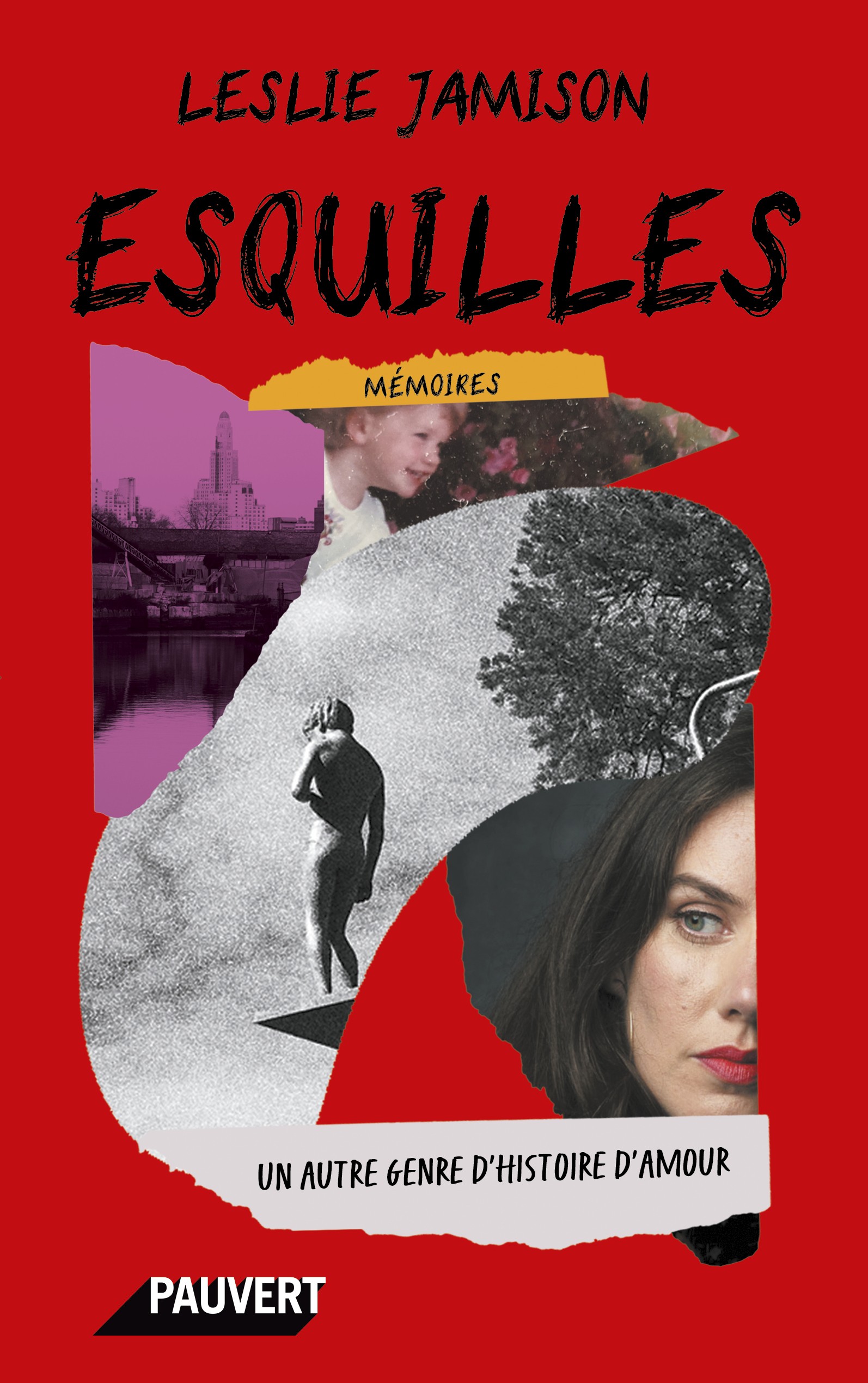En refermant Encore, le dernier roman d’Hakan Günday, il faut prendre le temps de s’ébrouer. Mais les effets de la gifle reçue peinent à s’estomper tant le choc est considérable. À partir d’un sujet brûlant, le sort atroce réservé aux migrants, Günday choisit de dynamiter notre innocence de pacotille. Comment ? En culbutant le lecteur dans l’enfer mental du passeur, plus précisément du fils d’un trafiquant, Gâza, un enfant que le mal va grignoter comme une gale jusqu’au point de non-retour. Porté par une écriture à l’intelligence narrative hors du commun, Encore réussit un pari compliqué : explorer par un subtil jeu de renversements tous les aspects de la condition humaine soumise aux effets pervers de la domination. Un roman politique ? Oui, mais seulement parce que ce n’est pas son intention première. Écrire reste la meilleure façon de penser. Il faut se rendre à l’évidence : avec ce voyage au bout de notre nuit, la Turquie a donné naissance à son Louis-Ferdinand Céline.
Page — La littérature, réagissant à une actualité dramatique, s’empare depuis quelques années de la réalité du trafic d’êtres humains. Encore va un peu plus loin en plaçant le lecteur du côté des passeurs. Ce qui apparaît comme un pari intrépide pour l’écrivain, n’est-il pas aussi une manière de dynamiter les codes de la satire sociale ?
Hakan Günday — Je pense que nous sommes tous des variations du même être. En chacun de nous, il y a tout. Vous n’avez pas besoin de connaître mille personnes pour raconter une histoire. Il suffit d’essayer de se connaître soi-même. Les clandestins et les passeurs sont à peu près les mêmes personnes, elles sont simplement placées dans des contextes différents. La question n’est donc plus sociale, elle est humaine. Il y a satire humaine à chaque fois que les personnages prennent une décision, à chaque fois qu’ils changent de camp. Une histoire qui dit que les schémas que l’on s’invente pour vivre n’existent pas. La guerre n’est pas contre les autres, elle est en nous.
P. — Puissamment hypnotique, la lecture d’Encore n’en est pas moins inconfortable. Dans quel état êtes-vous lorsque vous écrivez un tel roman ?
H. G. — Je n’arrive pas à mélanger la vie quotidienne et l’écriture ! Il m’arrive de regarder le vide ou le plafond pendant des mois et, d’un coup, je commence à écrire. Sans rien faire d’autre, jusqu’à ce que je termine le livre. C’est comme retenir mon souffle pendant trois mois. Une sorte de rêve dont je me réveille avec une histoire entre les mains. Et comme j’évolue en fonction de ce que j’écris, à chaque phrase j’entre dans un nouvel état.
P. — D’un extrême l’autre (Galaade) et Encore renvoient l’image terrible de personnages incarcérés dans leurs propres chairs, avec comme seules issues la folie et la mort. Le lecteur attentif remarquera néanmoins que l’amour et la compassion tentent d’audacieuses percées, comme en témoigne une fameuse petite grenouille en papier. Tout n’est donc pas si noir ?
H. G. — Je crois que la source du malheur et du bonheur est la même : la volonté de vivre malgré tout. Il est difficile de discerner ce qui est noir et ce qui ne l’est pas. Mais c’est vrai que la recherche de l’amour et de la compassion dure jusqu’au dernier souffle.
P. — Comment l’écriture romanesque peut-elle nous aider à comprendre les mécanismes de la domination et de la violence qui régissent les sociétés humaines ?
H. G. — Je pense que les mécanismes de la domination et de la violence ont tendance à se dissimuler dans la vie quotidienne et à se vaporiser. Et petit à petit, ils deviennent l’air qu’on respire. C’est alors que les romans entrent en jeu. Ils montrent ce qu’on a oublié de regarder. Ils remettent en question la perception que nous avons de cette réalité dans laquelle nous avons la sensation d’être enterré vivant. C’est avec l’aide de toutes ces histoires qu’on essaie de rester éveillé. Parce qu’on sait très bien qu’une fois endormi, les rêves qu’on va faire ne seront pas les nôtres.