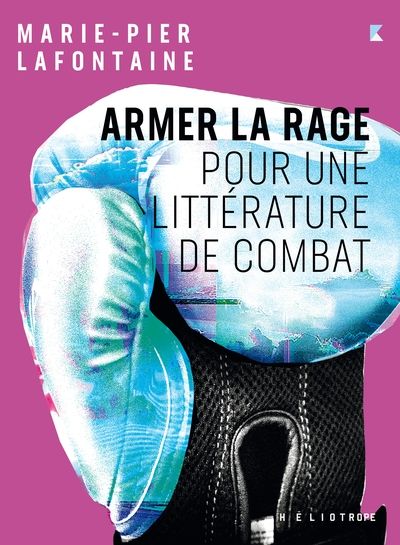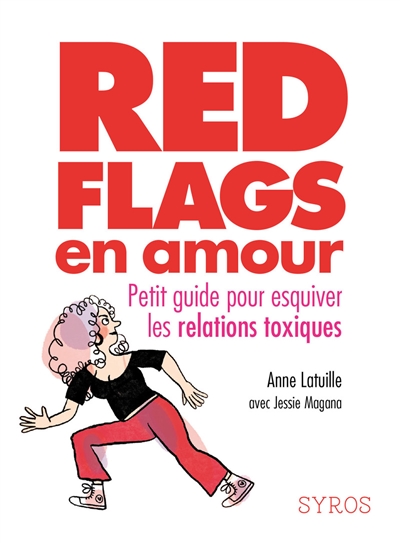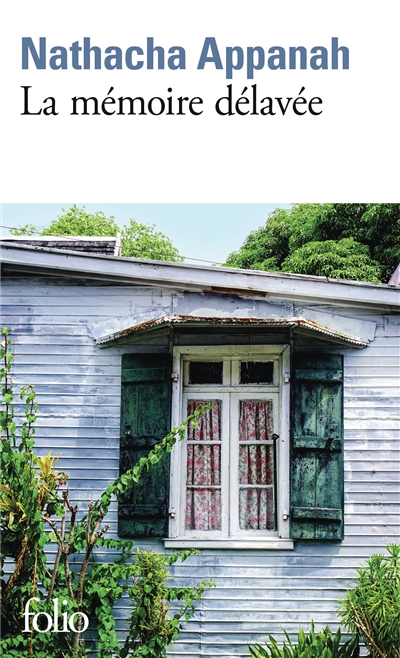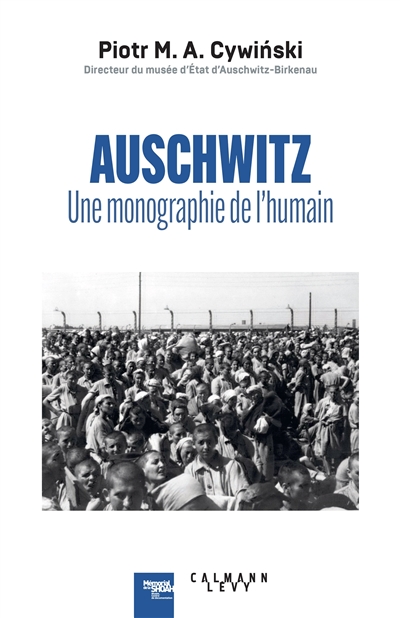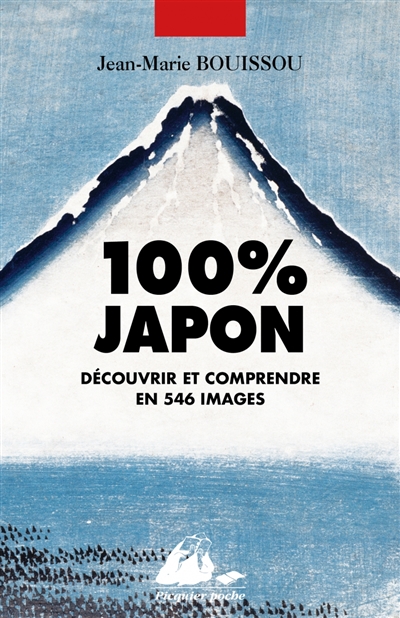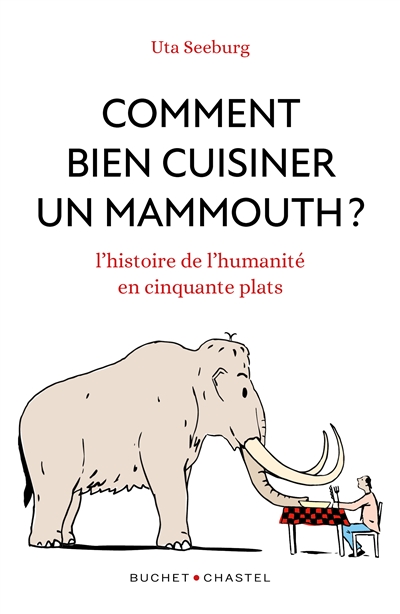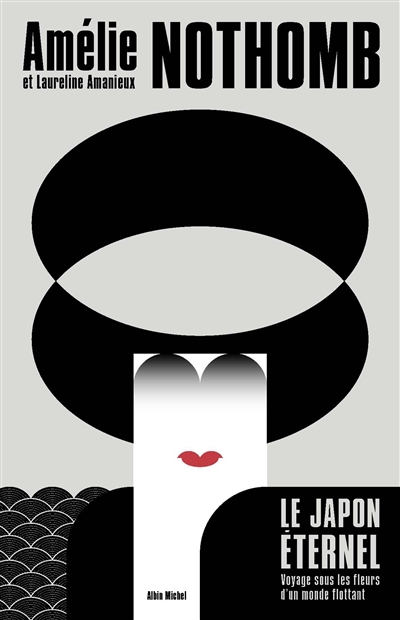David Le Breton est sociologue. Il ne se penche pas sur les questions psychologiques ou thérapeutiques qui viseraient à soigner l’absence au monde ou la difficulté à soutenir ses identités dans le monde. Son ouvrage relève en quelque sorte de l’empathie. Chercher à comprendre la souffrance sans en employer le terme. Poser des mots qui favorisent l’acceptation. Englober les diverses façons de disparaître à soi et les relier à ce que la vie porte d’essentiel : le souffle. L’auteur s’adresse à tous, reconnaissant les motifs profonds des désirs de solitude ou d’absence. On pense à La Fatigue d’être soi (Odile Jacob) d’Alain Ehrenberg, mais aussi à des ouvrages complémentaires, axés sur les sollicitations excessives subies par l’individu : 24/7, Le Capitalisme à l’assaut du sommeil (La Découverte) de Jonathan Crary, ou encore La Société de la fatigue (Circé) de Byung-chul Han. « La disparition de soi n’est jamais une fatalité, souligne David Le Breton, si certaines circonstances l’ont induite, d’autres peuvent l’annuler. »
Page — Disparaître de soi. Est-il possible que personne ne soit épargné, dans le courant de son existence, par cette tentation contemporaine ?
David Le Breton — Si, bien entendu. Je crois que la tentation est grande, mais elle n’est pas absolue. On peut aimer la vie et éprouver la nécessité intérieure de ne jamais perdre un instant, ou se sentir partagé, selon les moments, entre le désir d’être là et celui de s’effacer. Cependant, nombre de nos contemporains aspirent à relâcher la pression qui pèse sur leurs épaules, à la suspension de cet effort à fournir sans cesse pour continuer à être soi au fil du temps et des circonstances, toujours à la hauteur des exigences envers soi et envers les autres. Même quand aucune difficulté ne pèse, la tentation émerge parfois de se déprendre de soi, ne serait-ce que pour un temps, afin d’échapper aux routines et aux soucis. Toute décharge est propice pour lâcher prise un instant. L’identité est devenue une contrainte, nous aspirons à nous en libérer de temps en temps, parfois durablement. Pour certains, la marche est une formidable échappée belle. D’autres ne sentent pas leur place, ils se sont souvent sentis à l’écart en essayant de s’en accommoder, mais ils n’en ont plus la force, ou ne l’ont jamais eue. Le monde leur échappe. Certains quittent alors leur univers professionnel ou domestique, ils s’effacent, sortent de moins en moins, ne se soucient plus de leur voisinage ni même de leurs propres affaires. Les autres, ceux de leur entourage, s’éloignent également, trouvant un moindre intérêt à leur fréquentation ou s’agaçant de leur manière d’être toujours ailleurs. Ils ne veulent plus être quelqu’un pour le lien social ou leur famille. Ils sont là sans y être. Ils ont pris congé de leur ancienne personnalité et ils sont devenus délibérément méconnaissables. Certaines personnes se défont ainsi de leur centre de gravité, se laissent glisser dans le non-lieu. D’autres partent sans laisser d’adresse et se reconstruisent ailleurs. Disparaître de soi est une réflexion sur les manières d’échapper aux contraintes de l’identité.
Page — Ces différentes formes de disparitions sont-elles finalement des formes avancées de ruses contre une société qui oublie ou nie la nécessité de la pause, la nécessité de s’extraire, de se soustraire, de se retrancher, de trouver une distance propice avec le monde ?
D. L. B. — Dans une société où s’impose la flexibilité, l’urgence, la vitesse, la concurrence, l’efficacité, etc., être soi ne coule plus de source dans la mesure où il faut à tout instant se mettre au monde, s’ajuster aux circonstances, assumer son autonomie. Être soi devient difficile et exige un effort qui n’en finit plus. L’existence ne se donne plus toujours dans l’évidence, elle est souvent une fatigue, un porte-à-faux. La blancheur répond au sentiment de saturation, de trop plein éprouvé par l’individu. Recherche d’une relation amortie aux autres, elle est une résistance aux impératifs de se construire une identité dans le contexte de l’individualisme démocratique de nos sociétés et, surtout, du néolibéralisme qui imprègne même les relations sociales. La blancheur est souvent aussi un sas pour se reconstruire, disparaître un moment, pour revenir plus tard avec des forces renouvelées.
Page — Le simple constat que vous établissez, parce que vous l’établissez, contient un effet salvateur. Reconnaître un état de fait et tenter de le comprendre n’est-t-il pas simplement une avancée ?
D. L. B. — Oui, poser des significations sur des comportements au statut ambigu est une manière de les comprendre et donc, éventuellement, d’agir sur eux ou de mieux ajuster son attitude à leur égard. Je n’ai jamais voulu qu’un livre se renferme sur lui-même, il est un chemin, une porte vers un ailleurs, même s’il est rédigé avec rigueur. L’anthropologie n’est pas une contemplation, mais une tentative de transformer le regard, de le décaler, de dépayser l’évidence pour y introduire un trouble de penser qui rende la vie plus propice.
Page — Quelle a été, dans la continuité de vos travaux sur le corps, le visage et la marche (pour ne citer qu’eux ), l’observation qui a déclenché votre réflexion sur la disparition et impliqué la nécessité d’en parler ?
D. L. B. — L’un de mes proches a choisi de disparaître ainsi, alors qu’il avait une vingtaine d’années. Il n’a plus jamais quitté l’institution qui l’hébergeait, entre psychiatrie et foyer d’accueil, comme s’il s’agissait de son ermitage. Il a renoncé au lien social, il ne voulait plus se donner aux autres, mais demeurer en retrait, ne plus s’engager, se démettre de soi. Il y est encore aujourd’hui, plus de trente-cinq ans après. Il me semble l’avoir toujours compris, car j’ai souvent éprouvé moi-même cette tentation de l’absence. J’y ai cédé plus jeune en partant un jour pour le Brésil, dans une rupture radicale avec la société française d’alors et la tentation folle de l’Amazonie, un lieu parfait pour disparaître. Mais j’ai vite découvert que je m’étais emmené avec moi. Ce qui est en continuité avec mes autres livres, c’est une analyse des relations ambivalentes au monde qui caractérisent, par exemple, les adolescents emportés dans les conduites à risque ou des personnes touchées par la douleur. Vivre n’est pas une évidence, c’est parfois une conquête. Cet ouvrage plonge dans la subjectivité contemporaine et en analyse l’une des tentations les plus vives, celle de se défaire enfin de soi, de ne plus avoir à rendre de compte, serait-ce pour un instant.
Page — Dans vos textes, les références littéraires foisonnent : Moby Dick d’Herman Melville, Un homme qui dort de Georges Perec, Le livre de l’intranquillité de Pessoa... Vous citez encore Nabokov, Kundera et bien d’autres. La littérature, qui pour le lecteur est un moment de fuite en soi, ne porterait-t-elle donc que la question de l’identité, de la difficulté à être ? N’est-elle pas seulement un point d’appui, qu’on lirait en miroir de sa propre existence ?
D. L. B. — Oui, une part de la littérature contemporaine est hantée par l’absence, la disparition, la blancheur. Elle autorise ainsi des heures où nous-mêmes, lecteurs, nous nous dépouillons des contraintes de notre identité pour glisser dans la peau de personnages énigmatiques, parfois sans épaisseur, parfois doté d’une solide identité. Dans cet espace intérieur s’élabore un apprivoisement du rapport au monde, un ajustement pour s’y intégrer en acteur. L’expérience littéraire est la création d’une enveloppe protectrice où déposer la part nocturne de soi pour l’affronter sur un terrain plus propice. Elle permet de composer avec elle en en prenant le contrôle jusqu’à un certain point. Elle est une voie royale pour déprendre les perceptions, pour ressaisir d’autres modalités d’approches. Comme l’anthropologie pour établir la connaissance, la littérature est un détour pour apprendre à voir, à interpréter le monde. La littérature invente des vies possibles en miroir. Elle déroutinise la pensée, elle appelle au dépouillement des schèmes anciens d’intelligibilité, afin d’ouvrir à un élargissement des manières de comprendre. Elle brise les facilités du regard pour amener à voir autre chose, elle est une leçon sur le voir, comme par ailleurs un film ou un poème, un texte de philosophie ou d’anthropologie font voler en éclats la familiarité des choses et amènent à une autre pensée sur le monde. Comme l’anthropologie, la littérature est ouverture à la pluralité des mondes et à leur compréhension.
Page — Quel livre important à vos yeux pourriez-vous citer ?
D. L. B. — Je suis trop multiple, trop passionné de littérature pour n’en citer qu’un. Je lis toujours avec passion Philip Roth, Paul Auster, Haruki Murakami, Joyce Carol Oates, tant d’autres…