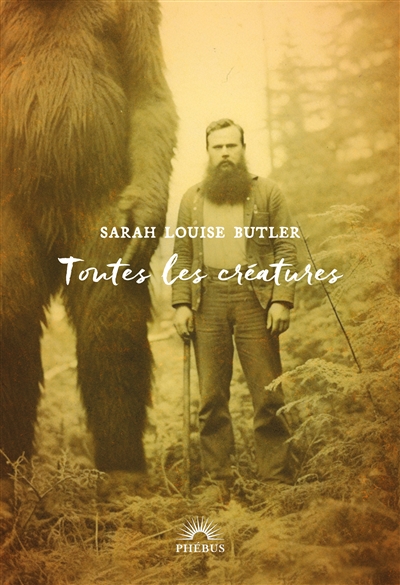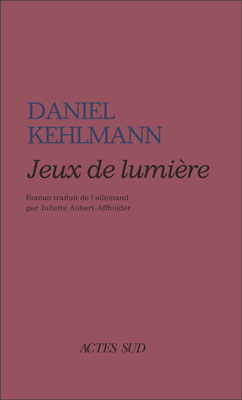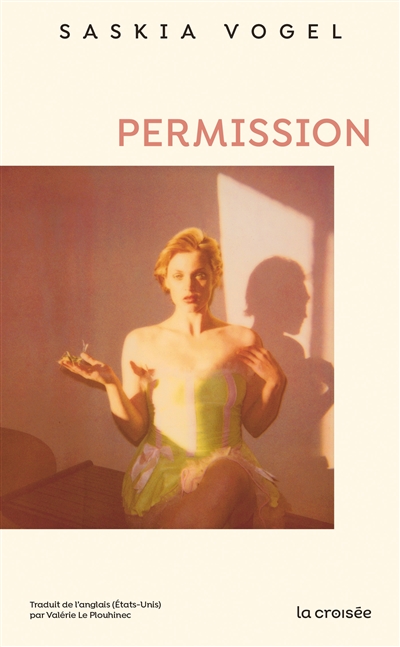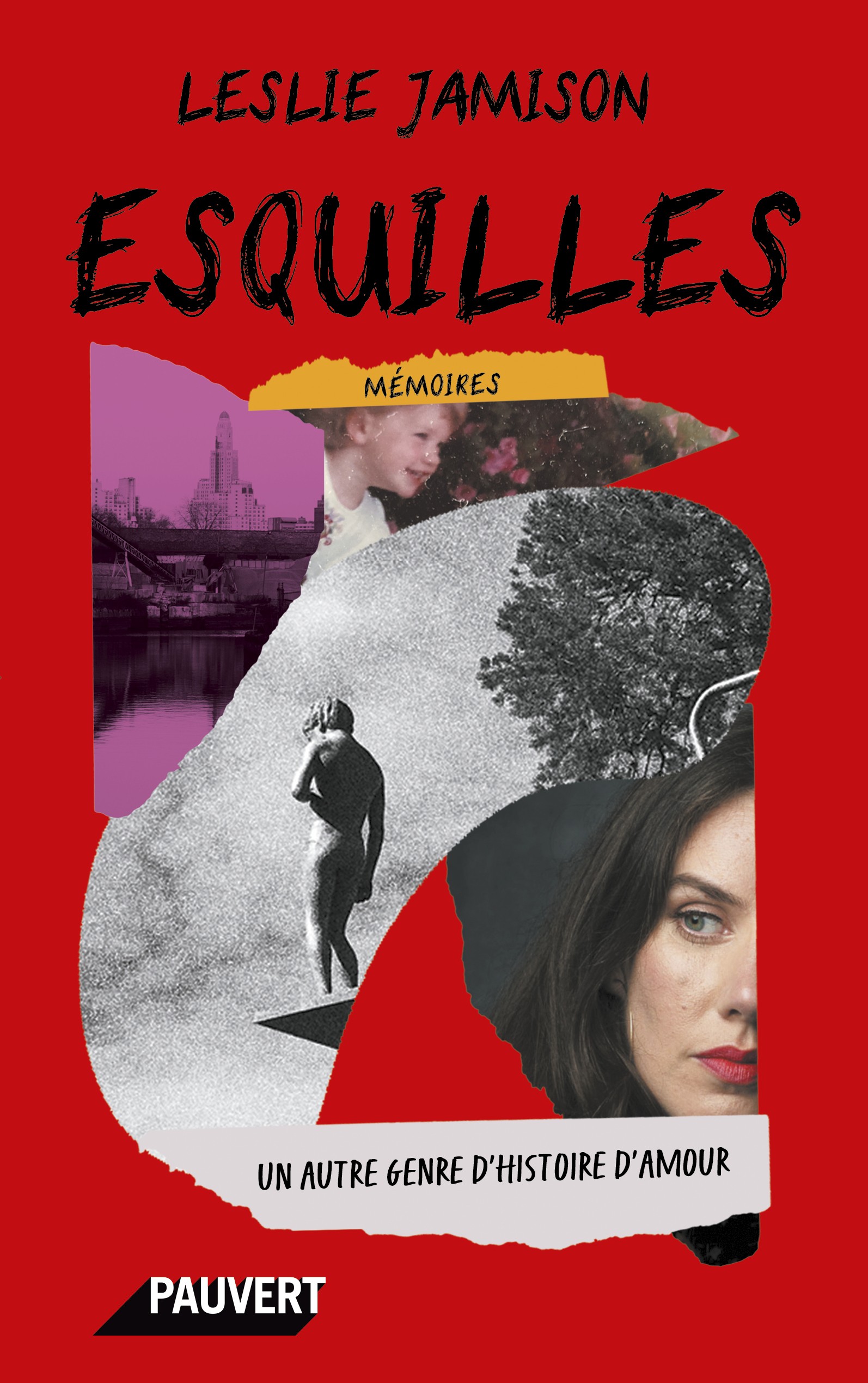D’un côté, un roman, un vrai, par la voix tendre et sensuelle de Milena Agus. De l’autre, tête-bêche, l’histoire, le contexte du roman, par la voix impétueuse et rigoureuse de Luciana Castellina. Nous sommes en 1946 dans les Pouilles et les sœurs Porro del Quadrone vivent retirées loin des réalités du monde, dans leur palais à Andria, petite ville agricole. Elles appartiennent à une famille de propriétaires terriens, de celles qui ne lâchent rien et exploitent sans scrupules une main-d’œuvre agricole nombreuse et misérable. Milena Agus fait pénétrer le lecteur dans l’intimité ouatée des sœurs, à travers une amie des héroïnes, issue du même milieu qu’elles, bienveillante et néanmoins provocatrice insatisfaite. Le drame va survenir : Caroline et Luisa Porro seront lynchées par une foule en colère. Victimes innocentes (ou coupables) d’un aveuglement volontaire ? Luciana Castellina éclaire et replace cet événement oublié dans un contexte historique incendiaire.
Page — Commençons par le début : comment naît l’idée de ce livre ?
Milena Agus — Luciana Castellina connaissait cet épisode de longue date. Elle en avait entendu parler très peu de temps après les faits par un camarade de parti. Il y a environ deux ans, lors d’une conversation amicale avec son éditrice Ginevra Bompiani, qui est aussi la mienne, elle évoque l’histoire du lynchage des sœurs Porro. Celle-ci en est particulièrement frappée et, réfléchissant à la meilleure manière de la faire connaître, elle propose cette idée : demander à Luciana, qui est journaliste et femme politique, de faire le travail de recherche historique, de documentation sur le terrain, en me confiant ce que je sais le mieux faire : un roman. Nous ne nous connaissions pas, Luciana et moi, mais nous avons accepté ce projet en toute confiance. J’ai d’abord reçu de Luciana une valise pleine de documents. J’y ai ajouté quelques lectures. Et puis m’est parvenu le premier texte écrit par Luciana, pour moi absolument fondamental. Mes premières versions étaient pleines d’erreurs, Luciana me corrigeait, et le roman est aujourd’hui réaliste. Tout ce que j’ai inventé est plausible et sérieux. Tout comme l’a fait Manzoni dans Les Fiancés (Folio classique - loin de moi l’idée de me comparer à lui, bien sûr !) Les documents historiques ne peuvent pas tout dire. On a besoin du roman pour rendre compte de l’invisible, de l’intime. Que peut-on savoir de la vie de quatre vieilles filles recluses derrière les lourdes portes de leur palais ? C’est pourquoi j’ai introduit ce personnage fictif, cette amie qu’elles agacent beaucoup mais qui les aiment néanmoins.
Luciana Castellina — Je trouve formidable et très drôle cette idée qu’a eue Milena de faire fantasmer sa narratrice autour du personnage bien réel de Giuseppe Di Vittorio, parlementaire communiste, antifasciste, homme mesuré et héros pour les ouvriers agricoles.
Page — Ce projet, qui mêle personnages réels et inventés, est donc un projet voulu par trois femmes… Au fond, il s’agit d’une tragique histoire de femmes ?
L. C. — En effet, les sœurs Porro sont les victimes de leur propre classe. Si elles avaient été des hommes, ou s’il y avait eu un homme dans la maison, elles ne se seraient pas trouvées à Andria ce jour-là. La situation était extrêmement tendue et dangereuse : elles ont été littéralement oubliées par leur propre famille. Quelle importance avaient-elles pour que l’on se préoccupe de leur sort ? Aucune. Mais elles n’ont bien sûr, elles-mêmes, pas voulu voir ce qui se nouait autour d’elles. Elles ignoraient jusqu’à la nature précise de leur patrimoine ; elles ignoraient ce que représentait leur richesse en termes de coût humain. Coupables d’ignorance, certes, mais aussi victimes. Victimes de la foule qui les a massacrées, victimes de leurs semblables.
M. A. — Les documents en attestent : elles ont probablement été lynchées par des femmes… Des femmes qui voyaient mourir leurs enfants de faim et de maladie. Le livre refuse tout manichéisme. Les raisons des uns nourrissent la partie historique, celles des autres, la partie narrative. Et le choix de notre éditrice française, Liana Levi, d’opposer les deux parties en renversant le livre est très parlant et judicieux.
Page — Les événements que vous décrivez se déroulent en mars 1946, à la veille de la première célébration de la fête de la Femme. Les jours précédant le 8 mars ont été le cadre de troubles très graves. Il y avait déjà eu beaucoup de morts et il y en aura d’autres par la suite. Cette période – dans le Sud de l’Italie et en particulier les Pouilles – semble totalement oubliée par les manuels d’Histoire.
L. C. — Les Alliés ont débarqué en Sicile pendant l’été 1943 et les Allemands se sont lentement retirés vers le Nord. Les troupes britanniques se sont installées à Tarente dès septembre 1943. Les faits que nous racontons surviennent donc presque trois ans après la fin des combats. Et les habitants de cette partie de l’Italie attendent depuis déjà très longtemps un changement de leurs conditions misérables. La situation de l’agriculture est différente de celle du reste du Sud de l’Italie, où règnent les grands propriétaires terriens et où les ouvriers agricoles vivent isolés sur leurs terres. Dans les Pouilles, l’agriculture s’est développée selon un système de production de type capitaliste. Et il y a donc de très nombreux ouvriers agricoles, journaliers vivant regroupés au sein de petits centres urbains, dans une misère noire. Leur nombre et leur concentration rendent la situation potentiellement explosive. En 1943 et pendant les années qui ont suivi, la politique d’opposition, et tout spécialement de la gauche, s’est concentrée sur l’idée de chasser les Allemands et de lutter contre le fascisme. Les journaliers, eux, une fois les Allemands partis, ont espéré, avec une force inouïe, une redistribution des terres, ou au moins du travail et du pain pour tous – une logique de lutte de classe était à l’œuvre. Leur désir de liberté, leur soif de justice, ont été trahis. Les propriétaires n’ont respecté aucune des obligations qui leur avaient été soumises. Et rien n’a bougé. Les réactions ont donc été extrêmement violentes. Les forces de l’ordre tiraient sur les masses en révolte, tandis que celles-ci répondaient par des lynchages de propriétaires ou de ceux qui étaient à leur solde. Cette guerre civile a été oubliée ; probablement aussi refoulée par la politique, la presse, l’Histoire officielle.
Page — Votre livre résonne étrangement aujourd’hui, vous ne trouvez pas ?
M. A. — On se croit en sûreté en se calfeutrant chez soi, on érige des murs dont on pense qu’ils seront assez hauts pour nous sauver… Alors qu’il faudrait aller vers les autres et s’entraider. Les sœurs Porro sont mortes d’avoir ignoré la réalité qui les entourait.
L. C. — Et, pour ne parler que des Pouilles, si ce ne sont plus des journaliers crève-la-faim et analphabètes italiens qui attendent à l’aube un éventuel engagement pour une journée ou deux de travail pénible, ce sont aujourd’hui les immigrants africains qui subissent la loi des caporali mafieux.
Page — Quel livre vous a marqué et pourquoi ?
M. A. — Dora Bruder, Patrick Modiano
Sans hésitation, ce sera un roman de Patrick Modiano. On ne trouve ses livres que depuis peu en Italie et je crois que le premier à avoir été traduit est Dora Bruder. J’en suis tombée amoureuse, j’ai adoré ce livre ! J’aime qu’il ne finisse pas, qu’on ignore le sort qui attend l’héroïne. J’aime l’idée que Modiano se serve d’un annuaire du téléphone pour trouver ses personnages. J’aime qu’il ait été aussi élégamment surpris de recevoir le prix Nobel. J’aime sa simplicité et ses personnages ordinaires, éclairés un bref instant par son écriture. Il fait partie des grands.
L. C. — Les Derniers Jours de la classe ouvrière, Aurélie Filippetti
Je garde un souvenir vif d’un livre intrigant : je venais de rencontrer Aurélie Filippetti, alors ministre de la Culture. Prise de curiosité, je me suis procuré et ai lu Les Derniers Jours de la classe ouvrière. J’aime les témoignages intimes se mêlant à la grande Histoire et, dans ce livre qui ne pouvait que me toucher, elle révèle le passé de sa famille, l’engagement politique de son père mineur de fond dans l’Est de la France, et parle avec justesse de l’immigration italienne.