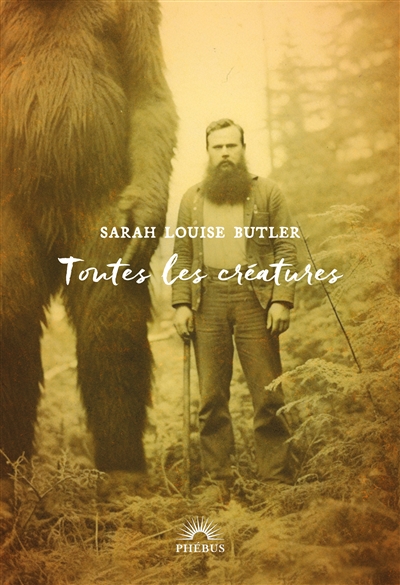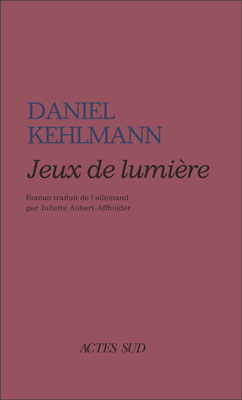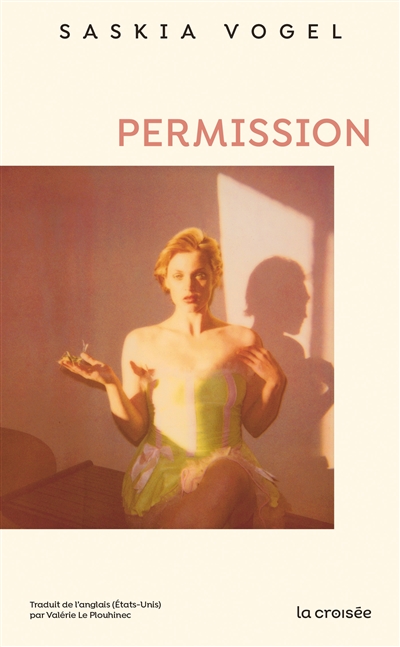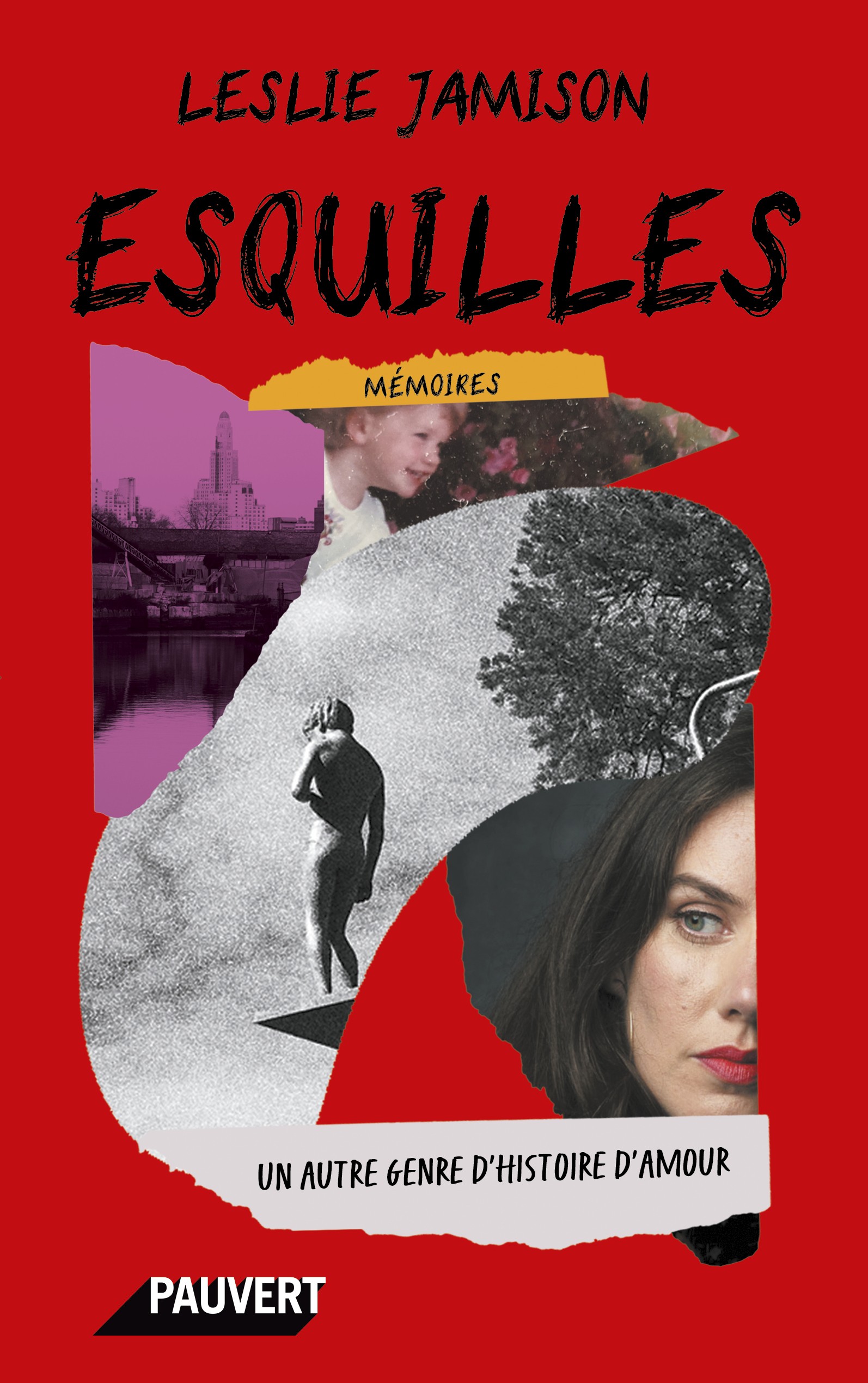Page — En 1945, un groupe hétéroclite fuit, poursuivi par les nazis. Présentez-nous les membres de ce groupe.
Andrea Molesini — Se trouvent dans ce groupe deux enfants de 10 ans : Dario et Pietro. Dario appartient à une famille cultivée et aisée de tradition hébraïque, qui connaît et aime les chiffres. Dario garde en lui, dans l’estomac, les paroles et les mots afin de ne pas nuire. Pietro, le protagoniste, est le narrateur. Il est rusé, s’exprime vivement et librement, il est sensible et plein d’esprit. Ensuite, il y a deux vieilles pharmaciennes juives, un moine énergique « planté comme un énorme rocher au milieu du chemin… », un pêcheur qui vit « comme une mouette » et Elvira, une belle jeune femme déguisée en religieuse qui tient un journal. Elle est l’autre narrateur.
Page — Dans une interview vous avez évoqué « l’exil de la beauté », une peur que vous avez et une raison d’écrire pour lui rendre hommage et la sublimer. Le Printemps du loup est-il un rempart à la fuite ?
A.M. — Aujourd’hui, le monde dans lequel nous vivons est marqué par « l’exil de la beauté », par la simplification de la langue. Cependant, la littérature existe pour répondre à la question de la complexité de l’esprit humain. « Là où est votre trésor, là aussi est votre cœur ; et notre trésor est là où bourdonnent les ruches de notre connaissance », a dit Nietzsche. Nous ne pouvons pas nous contenter d’un monde simplifié par la communication de masse. Nous avons besoin, chaque jour, de l’amour que vouent Pietro et de Dario à la vie, de leur cri : « Je veux être je » !
Page — La littérature est pour vous une formidable terre d’inventions et de libertés (liberté des êtres, des situations, de la langue). Pietro est au carrefour de cela. Comment l’avez-vous rêvé, espéré ? Marche-t-il encore aujourd’hui à vos côtés ?
A.M. — Pietro sera toujours avec moi. Et peut-être plus encore le silencieux, le muet Dario. Ses mots qui ferment le livre, « Tu es comme eux », sont un cri de révolte, le cri désespéré de celui qui, une fois vaincu le nazisme, le mal absolu, sait qu’il sera là, toujours, seul, à affronter le Mal qui s’incarne encore et encore dans l’Histoire des hommes. Le Printemps du loup est aussi un hommage à la noblesse, au courage et, finalement, à la solitude immense de l’âme hébraïque.
Page — Dans votre précédent roman, Tous les salauds ne sont pas de Vienne (Le Livre de Poche), le narrateur avait 17 ans. Dans celui-ci, Pietro a 10 ans. Vous sentez-vous mieux dans la peau d’un jeune narrateur, comme un pied de nez aux obligations adultes ?
A.M. — Oui, parce que la curiosité est au cœur de la vie intellectuelle. Seul un jeune peut avoir l’audace, l’effronterie, l’ingéniosité nécessaire pour s’émerveiller jusqu’à la fin. Avec l’âge, il est inévitable que les amertumes de la vie rendent cynique, de moins en moins capable d’émerveillement, d’étonnement.
Page — Au cours de sa fuite, le groupe croise un déserteur allemand. Il se révèle profondément émouvant dans son comportement avec les enfants. Est-ce une lueur d’espoir dans cette période barbare ?
A.M. — Chaque personnage est caractérisé par les contradictions qui l’habitent. L’homme « violent », qui porte l’uniforme des « mauvais », est aussi un « bon ». Nous ne devons jamais oublier que nous sommes tous, toujours, des individus capables de choix. Les uniformes uniformisent, mais sous ceux-ci se trouvent des hommes qui ont un père, une mère, des frères et sœurs, des soldats habités d’anciennes et nouvelles amours. Bref, il y a des hommes… Je crois que la littérature sert à défendre le mystère de l’individualité, qui reste inexpugnable, mais que la langue a le devoir d’honorer.