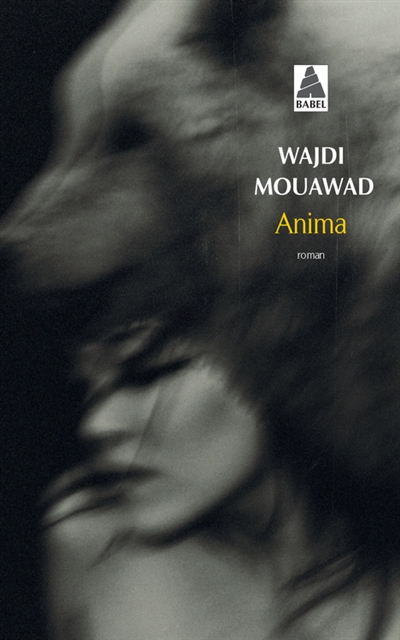PAGE — L’homme de théâtre que vous êtes a choisi la forme romanesque. Il semble que l’écriture d’Anima ait été précédée d’une très longue maturation. Quelle a été la genèse de ce texte ?
Wajdi Mouawad — Un jour, j’ai écrit un début qui est exactement celui d’Anima. Une scène violente, terriblement désespérée. Une femme est morte. Un meurtre effroyable que je voulais le plus effroyable possible. Qui constitue le point de basculement, d’une précision aveuglante, entre un avant et un après. Un homme rentre chez lui et découvre sa femme sauvagement assassinée. Cet homme, le voilà foudroyé. J’ai écrit ces lignes à la suite d’interminables autres amorces d’histoires que je laissais en plan. Ce que j’appelle le tâtonnement. J’y crois toujours au début, puis, deux ou trois jours plus tard, je laisse tomber. Mais cette fois, quelque chose me tenait fermement arrimé. Je voulais rester avec cette histoire. Je voulais continuer à la côtoyer. Dans l’écriture même de ce premier chapitre, je m’étais posé la question du narrateur. J’ai pensé à un chat avec une sorte d’évidence. Sans que je sache très bien pourquoi, il m’apparaissait essentiel que le récit soit transmis par la voix d’un être normalement mutique. Je me souviens encore parfaitement m’être posé la question du chapitre suivant et d’avoir eu envie de faire parler les oiseaux. J’ai ressenti une joie d’écriture intense à l’idée de passer par une narration véhiculée par des créatures muettes. Quelque chose me ressemblait sans que je comprenne tout à fait en quoi. Je ne voulais plus quitter cet univers. Ce n’est qu’au bout des cinq premières années, c’est-à-dire à ce qui correspond à l’entrée de Wahhch dans la première réserve amérindienne, que j’ai commencé à construire plus consciemment le récit, à voir plus loin dans le fil narratif, à commencer à pressentir les soubassements de l’ensemble.
PAGE — Faire porter la narration par la voix d’un oiseau migrateur, d’une fourmi ou d’un loup s’avère une idée saisissante. Notre regard sur le monde et sur notre part animale s’en trouve dérangé, décentré. Est-ce le goût pour la métamorphose du comédien qui vous a poussé à vous glisser dans une peau de bête ?!
W. M. — Je n’y avais jamais pensé. Peut-être. Il est vrai que ma lecture des Métamorphoses d’Ovide et de La Métamorphose de Kafka ont plongé la question animale dans les flaques les plus sensuelles de mon esprit : odeurs, cris, relations aux intempéries, puissance et sauvagerie n’ont cessé depuis lors de hanter mon imagination. D’un autre côté, la lecture du Silence des Bêtes d’Élisabeth de Fontenay m’a profondément marqué par cette manière de poser le mutisme des bêtes comme lieu d’hébètement d’une minorité assujettie au pouvoir d’une force brutale qui l’écrase. Mais pour revenir à la question que vous posez à propos du théâtre et du jeu du comédien, je réalise combien il y a un merveilleux malentendu entre le fait d’être reconnu comme artiste de théâtre et ma sensation intime d’être depuis toujours un romancier. Ce paradoxe a toujours été très important, faisant du roman le secret qui me protège du reste. Quand j’étais enfant, il arrivait souvent à mon père de me gronder très sévèrement. Je devais rester debout et essuyer, de longues et interminables minutes, une terrible colère. Lors de l’une de ces pénibles séances, fouillant dans mes poches, j’ai trouvé un petit coquillage que j’avais dû ramasser quelques jours plus tôt. Plus rien n’était pareil ! Je me disais : « Mon père peut bien déverser sur moi toute sa violence, il ne sait pas que je tiens, en ce moment, un petit coquillage. » Le roman, depuis toutes ces années, a été comme ce coquillage que je tenais et dont je ne parlais jamais. Être un homme de théâtre m’a permis d’être un romancier tout à fait tranquille, et je dois dire que cette confusion entre ma réalité publique et ma réalité intime est à l’image de l’exil dans lequel la guerre a jeté ma famille, effritant les lignes et rendant impossible toute identité qui serait liée à une nationalité précise. Cette porosité des lignes est à l’image aussi de mon prénom, que la plupart du temps, les gens ne parviennent pas à écrire, inversant le plus souvent le j et le d, écrivant Wadji au lieu de Wajdi. Cette inversion des deux lettres est à l’image de l’inversion entre théâtre et littérature. Pour bien écrire mon nom, il faudrait d’abord dire littérature, ensuite théâtre. C’est le roman qui m’a donné envie d’écrire et c’est le roman qui s’est imposé à moi comme rêve à atteindre. J’ai très précieusement conservé une lettre d’Eugène Ionesco et une autre de Michel Tournier, toutes deux adressées en réponse à un courrier que je leur avais envoyé pour leur demander s’ils accepteraient de lire mes rédactions afin de me donner leur avis. Comme quoi, à 14 ans on n’a peur de rien. Ils ont tous deux pris la peine de me répondre. Voici un extrait de celle de Tournier : « En matière de littérature les conseils sont faits pour n’être pas suivis. » Leurs merveilleuses réponses m’ont confirmé dans l’amour que je porte depuis toujours à la forme romanesque. Le théâtre a surgi d’une autre nécessité. Celle de l’immédiateté. Le roman est, pour ce qui me concerne, un processus très lent, dévoreur de temps. Un temps mécanique pour travailler la phrase et un temps littéraire, comme si je devais m’éloigner de l’instant où le récit m’est apparu pour être en mesure de le saisir. C’était un temps trop long pour moi, pour l’adolescent que j’étais, qui avait un besoin pressant de prendre la parole. Le théâtre m’est apparu comme le geste éclair, l’attaque, le blitz où il était possible de s’exprimer sans trêve. Cela a contribué à créer deux courants, l’un plus visible et plus officiel que l’autre.
PAGE — La question de la violence originelle parcourt le récit, qui s’ouvre sur un crime effroyable. Wahhch Debch, dans sa quête éperdue, se trouve souvent confronté à la bestialité, littéralement, des hommes. Les descriptions cliniques, d’une précision parfois insoutenable, signifient-elles une tentative d’exorciser une barbarie que l’Histoire répète ? W. M. — Je ne crois pas qu’il s’agisse d’un exorcisme, car l’exorcisme signifierait chasser un monstre d’un corps. Il ne s’agit pas, du moins consciemment, d’une entreprise pareille. Il se trouve qu’adoptant le point de vue des animaux, les observant et les étudiant au cours de ces dernières années, l’idée de l’infaillibilité de leur instinct m’est apparue comme une évidence. Les animaux entretiennent avec le présent un rapport dénué de tout jugement. Pour l’animal, ce qui est, est. L’animal ne se détourne pas de l’horreur, comme nous le ferions spontanément. Cela exigeait du coup une description précise, clinique. Je devais à chaque fois visualiser la chose, ensuite trouver les mots, le rythme pour la décrire telle que l’animal la perçoit. Le boa qui dévore le lapin ne pense ni ne ressent la même chose que le lapin qu’il est en train de dévorer. Mais là où l’homme ferme les yeux « pour ne pas voir ça », le lapin, autant que le boa, gardent leurs yeux ouverts. La traversée des grands espaces de l’Amérique du Nord, les nuits étoilées, la rencontre des lucioles, « poussières anciennes d’innocences oubliées », permettent respiration et apaisement en face de la peur et de la souffrance. La conscience de la beauté du monde comme antidote à la noirceur de la nature humaine ?
W. M. — Oui, sans aucun doute. Et le fait qu’il est toujours ahurissant de constater que la barbarie peut se manifester dans les plus beaux paysages, sous des cieux idylliques. L’indifférence de la beauté aux souffrances et aux injustices. La beauté du ciel n’appartient qu’à l’humain qui la regarde, qu’il est seul en mesure d’appeler « beauté ». Pourtant, cet esprit humain capable de percevoir les ciels sublimes, est aussi capable d’égorger ses propres enfants. La nature se détache, s’évanouit. L’écrivain est peut-être celui qui la retient.