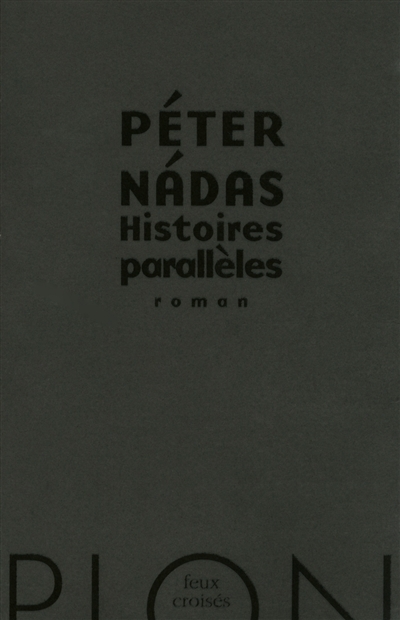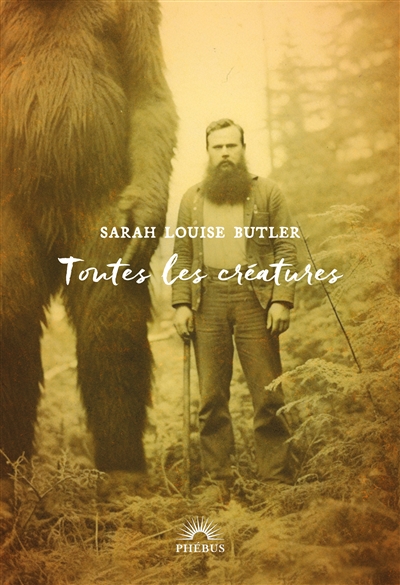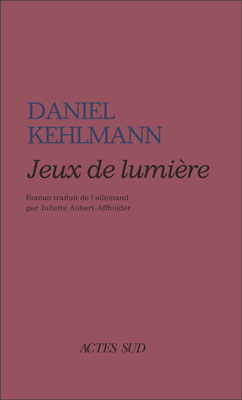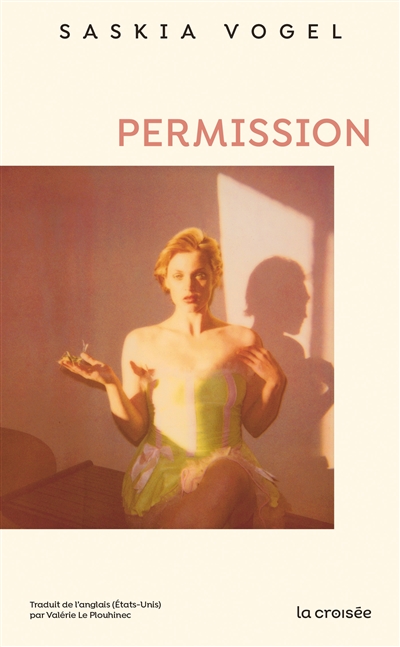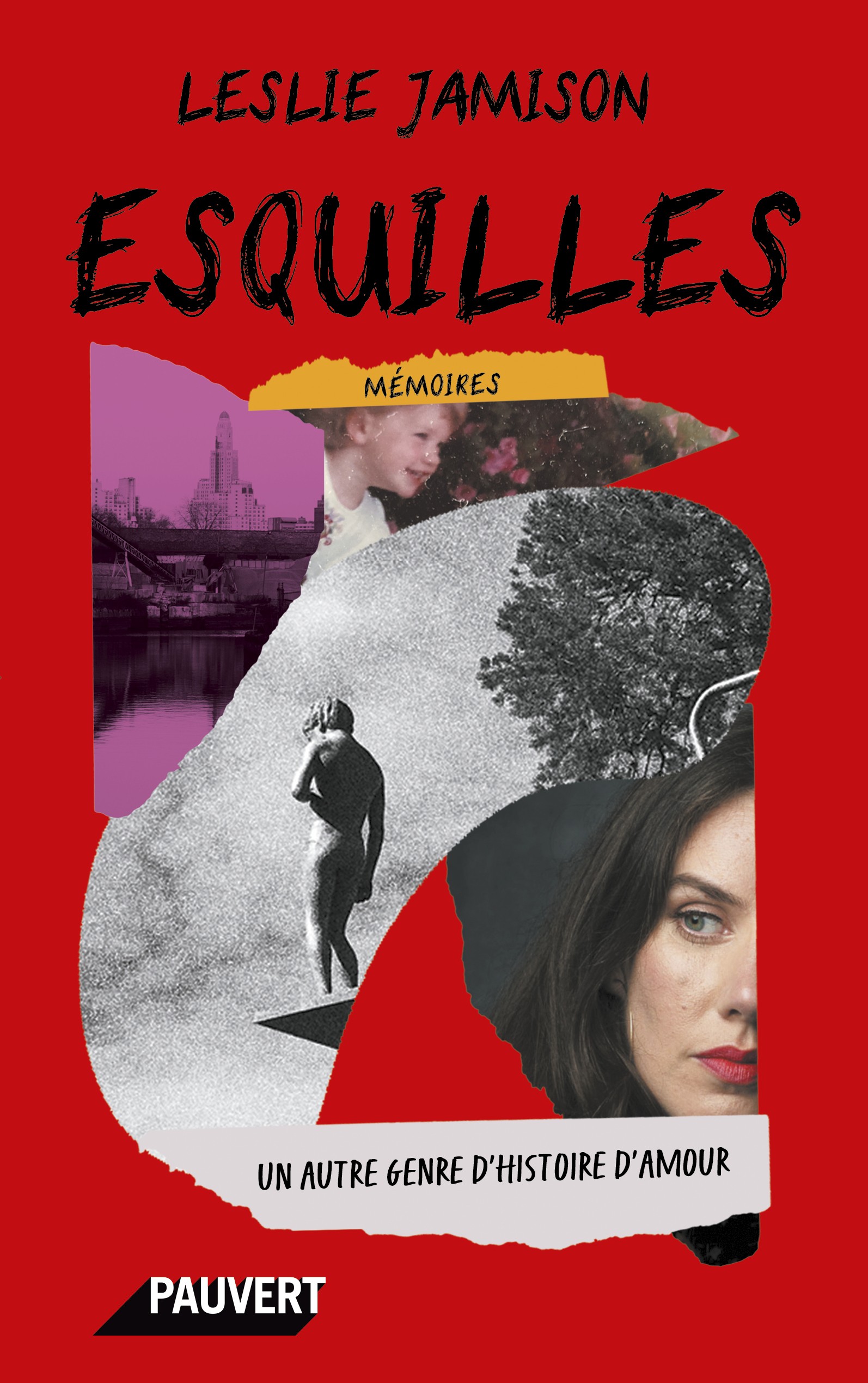PAGE : Je voulais commencer par quelques chiffres. 1 135 pages en français, dix-huit ans d’écriture, cinq ans de traduction. C’est très impressionnant. Un vrai roman monstre. Ces années d’écriture ont-elles été suivies ? Interrompues ? Écriviez-vous toute la journée ou à certains moments de celle-ci ?
Péter Nádas : En fait, c’est vingt ans. Je l’ai commencé en 1985 et fini en 2005, mais je l’ai interrompu pendant un an, entre 1988 et 1989 alors que j’écrivais Almanach *. J’ai senti que je ne pouvais plus continuer à écrire de fiction alors que ce qui se passait dans la rue était si extraordinaire. Alors j’ai recommencé à écrire en 1989. J’ai eu un infarctus en 1993 ; il m’a fallu six mois avant de me remettre à écrire. Donc, sur les vingt ans, il y a bien eu un an et demi d’interruption. C’est pourquoi je dis dix-huit ans. En fait, j’ai aussi écrit d’autres choses au cours de ces années, mais je le faisais l’après-midi ou pendant mes soirées. Et comme n’importe quel employé qui commence à travailler à 7 heures, je me mettais à ma table avec un grand mug de café et écrivais jusqu’à 13, 14 ou 15 heures. Ensuite, je prenais mon petit déjeuner. Ma règle de base était de ne plus du tout me préoccuper de ce que j’avais écrit durant la matinée. En revanche, tout ce qui relevait de la documentation et des lectures, je m’en occupais l’après-midi. Je ne prenais pas de notes : ce que j’avais oublié, tant mieux si je l’avais oublié.
P. : Ces deux moments de rupture, celui qui précède et celui qui suit la chute du mur sont-ils liés ? Puisque vous êtes un écrivain physique, votre infarctus a-t-il modifié votre façon d’écrire ?
P. N. : J’ai eu un infarctus parce que tout a changé. Il y avait un lien direct. De l’isolement total où je me maintenais, j’ai dû sortir dans le monde. La différence était très importante et j’ai dû l’intégrer. Il s’est trouvé que la réalité n’était pas exactement telle que je me la représentais ; il a fallu tout remettre à sa place**. Une semaine avant l’infarctus, j’ai donné une conférence à la Deutsche Bank, à Francfort, au 36e étage, celui de la direction. Il y avait une immense table, aussi vaste à elle seule que cette salle ! Chaque membre de la direction occupait une surface équivalente à la moitié de cette table et ils étaient ainsi espacés tout autour de la table. Il y a eu un grand débat, très dur. Une semaine plus tard, j’ai fait mon infarctus. Ensuite j’ai publié la conférence et le débat dans une revue hongroise, puis dans une revue allemande. Entre l’isolement et le 36e étage de la tour, il y avait une très grande différence. Mais il n’y a pas eu de changement de structure dans l’écriture du roman. J’ai quand même dû tirer les conséquences de cet infarctus et, du coup, j’ai écrit tout de suite après toutes les scènes à Berlin afin de les insérer aux premières pages. Avant, elles n’apparaissaient pas au début du livre.
P. : Quel est donc le véritable début du livre ? Son incipit, sa matrice ?
P. N. : Justement, je ne voulais pas qu’il y ait de début à ce roman. Mais je n’ai pas réussi ! [Rires]. Le début, c’était le chapitre « Une maison de maître ». J’avais l’idée de ce parallèle entre la famille allemande et la famille hongroise, sauf que la famille hongroise devait figurer avant et la famille allemande après. Puis j’ai inversé. Je me suis rendu compte que c’était une question de « casting » : si je commençais avec la famille hongroise, ça n’irait pas car c’est de la famille allemande que tout découle. C’est une histoire parallèle, comme par exemple en 68 la révolte des étudiants en France et la révolte pour la liberté à Prague. Des événements se déroulent donc en parallèle en deux endroits de l’Europe. Malgré tout, le rythme est donné par l’Europe occidentale.
P. : Lorsque vous dites que vous ne vouliez pas de début à votre roman, c’est que vous aviez un désir d’infini, d’autant que les parallèles, par définition, ne se croisent jamais. Vous vouliez une structure infiniment ouverte ?
P. N. : Je l’ai conçu comme un tissu. Le tissu se compose d’une trame dans laquelle on tisse de grands fils verticaux. La trame, ce sont les parallèles ; ce sont les fils qui se tissent et qui tiennent l’ensemble.
P. : C’est votre côté Pénélope ?
P. N. : [Rires. Puis, en français] : Je reste vingt ans ! Je fais le tissu.
P. : Ce qui est frappant, c’est cette interpénétration d’éléments entre eux, des corps, des identités, notamment par le rêve. L’identité n’est pas fixe. Les personnages sont aussi autres, traversés par d’autres. Les parallèles ne se touchent pas et sont pourtant liées entre elles par les personnages.
P. N. : C’est très important ce que vous dites, parce que ça reprend les différents niveaux des actions et leurs variations. Le fait que quelqu’un pénètre quelqu’un d’autre physiquement ou qu’il ne fasse que rêver de pénétrer ou d’être pénétré par quelqu’un, c’est exactement la même chose.
P. : Vous mettez en place un statut du rêve bien particulier. Nous ne sommes, il me semble, ni dans une logique jungienne, ni dans une logique strictement freudienne.
P. N. : Nous nous trouvons très précisément au milieu. Les deux ont eu beaucoup d’influence sur moi – Jung avant Freud, bizarrement. C’est en lisant Jung que je me suis mis à lire Freud ; les deux m’ont abondamment servi, bien que je n’aie pas fait d’analyse. Je reste vraiment au milieu, car je crois que l’inconscient collectif joue pour un individu autant que son propre inconscient. C’est comme deux fils dans le tissu qui ne peuvent exister l’un sans l’autre. C’est intéressant de voir les querelles entre Freud et Jung, mais moi, ce qui m’intéresse davantage, c’est ce qui en a résulté. Par ailleurs, travailler ces notions sous une dictature a été déterminant ; ce qui est collectif est haïssable, ce que l’on tente de m’imposer est insupportable. Ce qui me prive de ma liberté est infâme. J’ai moi-même dû me persuader qu’il existe une différence entre collectivisme et collectivité.
P. : Il m’a semblé déceler dans votre traitement des sexualités (hétéro et homosexuelles) des proximités avec Proust – même si, chez vous, cela ne repose pas sur un système d’inversion généralisé des signes et des sexes.
P. N. : Proust l’a résolu à sa manière.
P. : Je pense à cette très belle scène entre deux femmes. En faisant l’amour, toutes deux ont cette image de plaisir, ou ce rêve, d’être pénétrée par un homme plutôt que touchée par l’autre femme.
P. N. : Je suis à peu près parti du même point que Proust, mais je suis arrivé ailleurs. Il est difficile d’expliquer pourquoi, il y a plusieurs raisons à cela. Par exemple, Proust et moi partons du même point : l’observation des détails de détails. Cette observation sert chez Proust à construire les souvenirs. Chez moi, il ne s’agit pas seulement d’une observation avec ce que l’on voit ou ce que l’on entend, mais aussi ce que l’on sent, goûte, touche. De mon point de vue, c’est la qualité sensorielle qui compte et qui fait que l’on est vraiment une collectivité, non pas politique, mais sensorielle. Proust a une prodigieuse influence sur moi. Lorsque je le lisais, j’ai pu rentrer jusqu’au bout dans ce système d’associations qui est le sien. Il a découvert ce que Freud aussi avait découvert. Ce sont des lois psychologiques – bien qu’il s’agisse plutôt pour moi d’une sorte de loi sensorielle. Nos cinq sens nous rendent plus égaux que l’égalité politique, par exemple. De l’égalité découle aussi l’empathie. Une part de l’humanité possède cette empathie qui lui permet d’entrer dans l’Autre – pénétration absolument indépendante du sexe, bien sûr ! ; du sexe, ou plutôt du genre***. Je crois par exemple que fixer l’autre dans les yeux afin de tenter de déterminer s’il ment ou non est un acte érotique. Et peu importe que chacun s’adonne à cet acte, les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes, les pères avec leurs fils, les mères avec leurs enfants –… sans oublier les pédophiles.
P. : Vous faites un parallèle avec Proust qui lui aussi travaille essentiellement sur la sensation dans cette longue scène de coït de 200 pages, et dans une autre dont on a parlé tout à l’heure : les personnages pensent à autre chose pendant l’acte et vous restituez ces pensées, parfois incongrues, qui leur traversent l’esprit.
P. N. : J’ai besoin de cette énorme pelote de fils qui fait grossir le roman ; c’est grâce à ça que je parviens à créer l’espace dans lequel l’événement a lieu. Il y a un espace intérieur et un espace extérieur, et j’ai besoin de voir par quel angle, quel point de vue se passent les choses. Heureusement, il y a cette découverte littéraire du xix e siècle qui consiste à suspendre l’action au terme d’un chapitre (d’un épisode) et à un moment clé de l’action pour ferrer le lecteur en lui donnant l’envie de poursuivre sa lecture. Elle m’est d’un fantastique secours.
*Inédit en français.
** Marc Richard, le traducteur, intervient : « Si je peux me permettre une note en bas de page : son livre La Mort seul à seul parle de cet infarctus. »
***Le traducteur précise qu’en hongrois, il n’y a pas de genre, il faut une description physique, même minimale, pour savoir si l’on parle d’un homme ou d’une femme. Histoires parallèles joue beaucoup sur ces confusions.