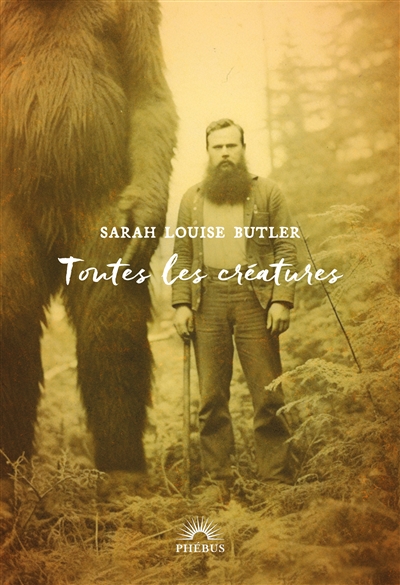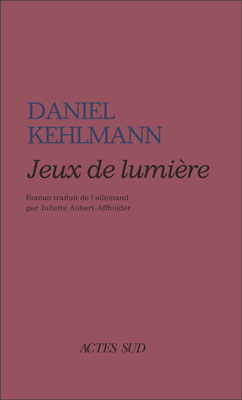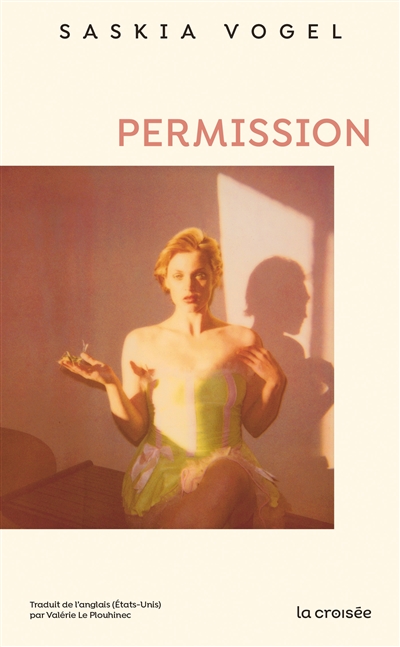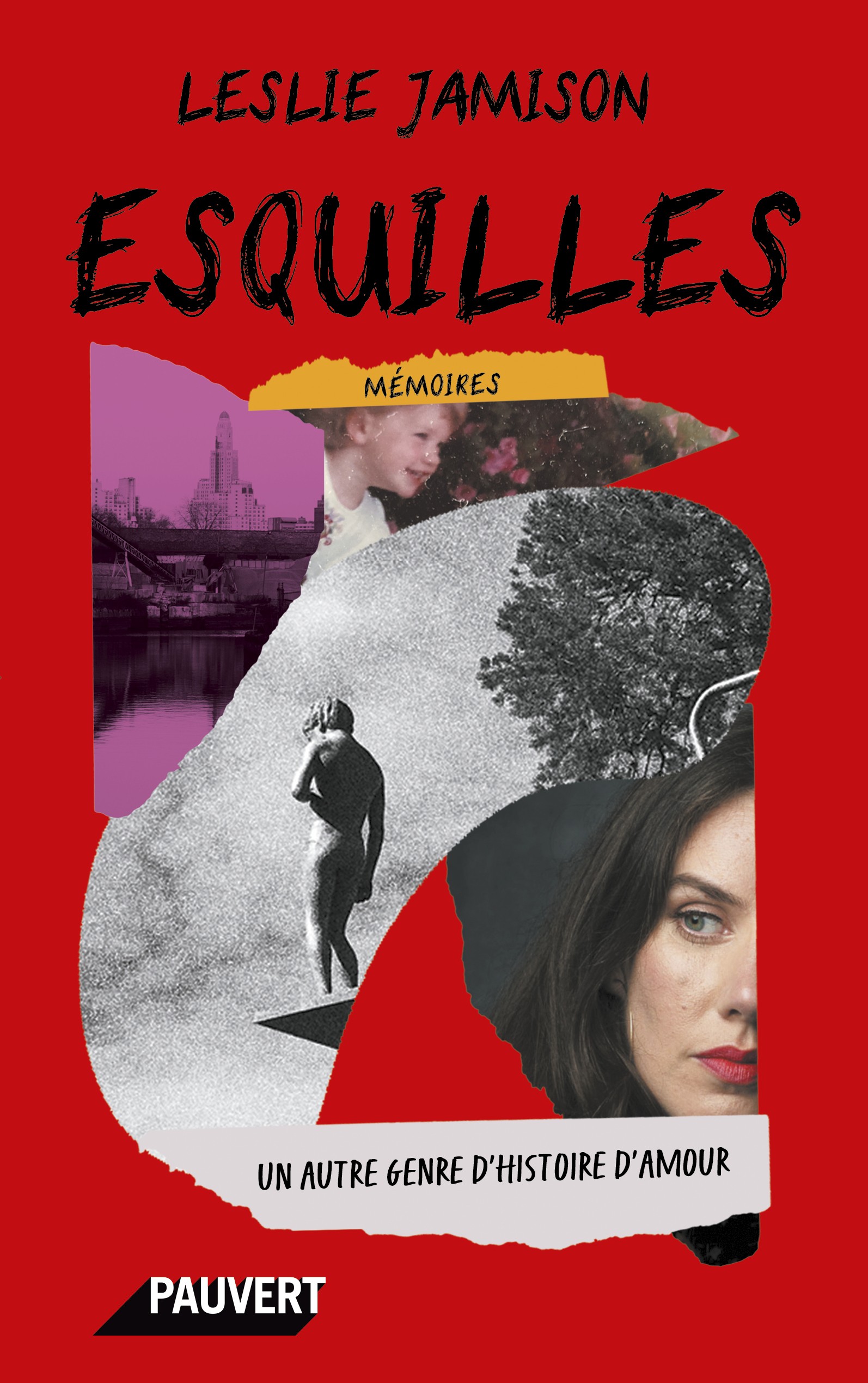PAGE : Les Mille Automnes de Jacob de Zoet est un récit historique éblouissant, un roman d’aventure que le lecteur dévore fébrilement, une histoire d’amour profondément émouvante et une étude très subtile sur la collision des cultures, tout cela en même temps. Quel a été le point de départ de ce projet ambitieux ?
David Mitchell : L’île de Dejima elle-même a été le point de départ de ce roman. Je l’ai découverte par hasard en 1994 alors que je flânais autour de Nagasaki à la recherche d’un endroit pas cher pour déjeuner. Le site est différent de celui qu’il devait être à l’époque de Zoet, le projet de remise en valeur du lieu l’ayant éloigné de la mer, mais les bâtiments sont aux deux tiers semblables – les entrepôts, la résidence du chef, la rue principale, la Place du Drapeau, et les différentes portes sont toutes reconstruites. Alors si vous avez aimé le livre, vous pouvez aller à Nagasaki et parcourir ces rues ! Plus tard, d’autres thèmes se sont rajoutés, comme le christianisme caché et la situation désespérée des Hollandais pendant l’interrègne napoléonien, quand les Britanniques perturbaient les lignes de ravitaillement de l’Empire hollandais à travers le monde. Je voulais aussi montrer comment les Japonais voyaient les étrangers à cette époque. être soi-même l’objet d’un léger racisme permet de se soigner de manière homéopathique de la xénophobie.
P. : En lisant ces fascinantes informations sur un épisode peu connu de l’Histoire, à un endroit rarement visité dans la littérature, on se dit que la documentation n’a pas dû être évidente à obtenir. Quelle part ont eu dans ce projet les recherches que vous avez faites et comment avez-vous procédé ?
D. M. : J’ai dû recréer le monde du roman en utilisant des sources qui lui étaient contemporaines. Cela incluait quelques journaux de chefs hollandais et les livres écrits par les visiteurs plus instruits de Dejima, le plus souvent des médecins, et la plupart de la fin du XVIIIe et du tout début du XIXe siècle, quand la Compagnie néerlandaise des Indes orientales prenait conscience que des hommes ayant une certaine finesse diplomatique étaient nécessaires au Japon, et pas simplement des marchands voyous n’ayant aucun intérêt pour toute autre langue ou culture. J’ai aussi utilisé les travaux d’historiens modernes et de spécialistes du Japon, dont C. R. Boxer et le magnifiquement nommé Timon Screech ( screech veut dire hurler). Des séries historiques de mangas japonais (la série Lone Wolf and Cub tout spécialement) m’ont été précieuses pour recréer des scènes d’intérieur (jamais décrites dans les textes universitaires). Enfin, les romans maritimes de Patrick O’Brian m’ont beaucoup aidé pour la partie concernant la marine britannique. Pour des questions plus spécifiques, comme l’histoire de la crème à raser et la topographie des lieux, Wikipedia et Google Earth ont aussi été des sources d’information utiles.
P. : La langue est un élément essentiel de votre roman, pour les informations factuelles échangées entre les personnages japonais et hollandais, et comme révélateur de la personnalité des différents protagonistes. Avez-vous mis un soin particulier à la recréation de ces divers modes de langage ?
D. M. : C’est le travail de tout romancier de distinguer chaque personnage des autres, et c’est particulièrement important quand ils sont nombreux dans un roman. Un des meilleurs moyens, c’est de les faire parler différemment. Un personnage peut être construit à partir de la langue – notre vocabulaire, correction grammaticale, notre accent et nos relations en général avec la langue en dit long sur nous. Dans Les milles automnes, j’ai créé six groupes linguistiques principaux : le hollandais instruit, le hollandais des ouvriers, l’anglais instruit, l’anglais des marins, le japonais des hommes, celui des femmes. Il a fallu après les transposer en anglais. Et ensuite, mon exceptionnel traducteur français Manuel Berri a dû rendre tout cela en français. Ce type mérite une médaille !
P. : Depuis vos premiers romans jusqu’à celui-ci, vous semblez prendre plus de distance avec le « terrain expérimental » et être plus intéressé par le fait de raconter une histoire. Pouvez-vous nous parler de cette évolution de votre style ?
D. M. : Je préfère ne pas penser à ma propre évolution comme auteur parce que mes livres plus anciens me font mal aujourd’hui par leur maladresse (ne répétez surtout pas à mon éditeur que j’ai dit ça), et parce que ce serait du narcissisme intellectuel de trop penser à moi-même. Si des universitaires voulaient le faire, j’en serais honoré et flatté, mais ce n’est pas mon boulot. À propos du style, une fois encore, je ne pense pas plus que ça à son évolution dans ma carrière. Cependant, j’essaie consciemment de mettre de la distance d’un roman à l’autre – dans le temps, l’espace, les thèmes, les mots – pour me dissuader de me répéter. Je veux que chacun de mes romans aient une forte individualité. Chaque livre, par conséquent, se présente dans le style qui lui va le mieux. Les mille automnes a mis du temps à trouver son style. Une narration non omnisciente à la troisième personne, un présent nerveux, une grammaire simple et des dialogues fournis, poétiques et précis, presque comme des haïkus.
P. : En écrivant ce roman, vouliez-vous aussi rendre hommage à certains auteurs ? Plus généralement, quels sont les écrivains qui vous ont le plus influencé dans votre travail ?
D. M. : Mince ! Faire un livre avec ce gros poisson glissant était bien suffisamment difficile – rendre hommage en même temps à un autre écrivain ne m’a pas traversé l’esprit, très honnêtement ! Cependant, les auteurs en compagnie desquels j’ai navigué durant les quatre années qu’il m’a fallu pour écrire ce livre comprennent Junichirô Tanizaki, Shusakû Endô, Patrick O’Brian et Henry Fielding. (Sir) Walter Scott pourrait prétendre au titre d’inventeur du roman historique moderne et c’est une bonne référence, bien qu’il puisse sembler très prolixe au lecteur d’aujourd’hui. D’autres écrivains qui m’ont influencé ? Il y en a tellement. Pour parler des français, Flaubert, Perec et Alain-Fournier. John Cheever, Richard Ford, Don DeLillo et Raymond Carver parmi les américains. Des russes, Boulgakov, Tolstoï (qui savait une ou deux choses sur le roman historique) et plus que tout Tchekhov. Tchekhov que je désignerais comme mon saint patron. Mais il détesterait cette idée. Peut-être que l’on pourrait simplement partager une soupe de potiron.