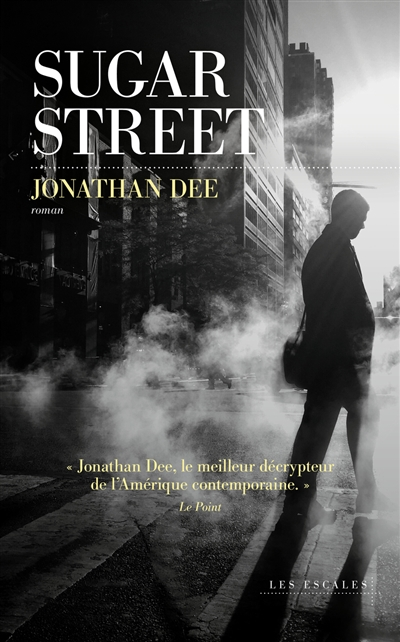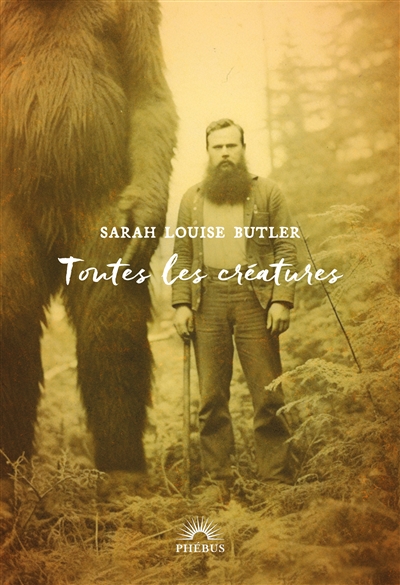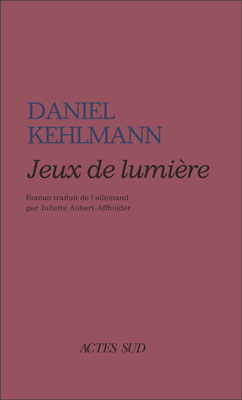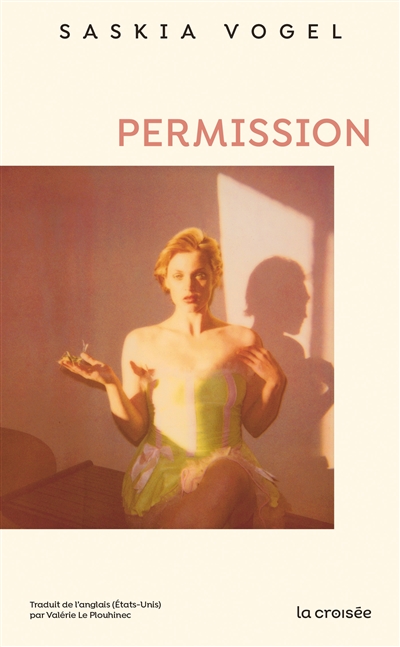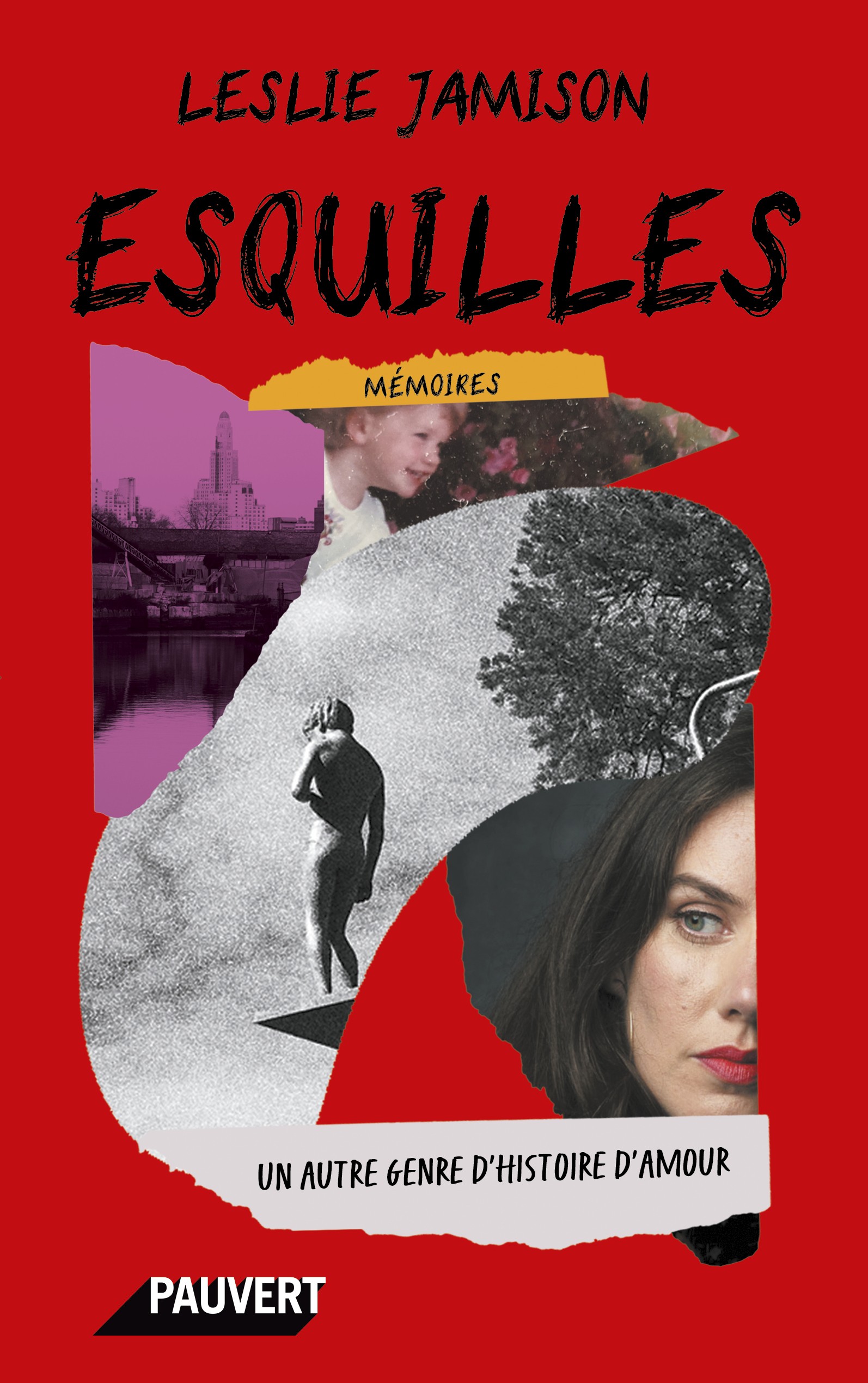De Howland, la bourgade au nord-est de New York qui servait tout autant de cadre que de personnage principal à votre précédent roman, Ceux d'ici (Plon et 10/18), à cette Sugar Street anonyme, quel a été votre cheminement ?
Jonathan Dee - Je n'ai pas prémédité le voyage vers Sugar Street, les besoins du narrateur de mon roman s'en sont chargés. Ses questionnements pour résoudre l'énigme de la disparition de sa propre vie l'ont en effet conduit dans une petite ville américaine sans charme et déprimée (d’un point de vue économique mais aussi, comme le lecteur le découvrira, à tous points de vue). Nombreuses sont les villes de ce type à travers les États-Unis. La différence entre cette ville sans nom et la petite ville de Howland est paradoxale : dans la première, vous êtes tellement entouré de gens que personne ne vous voit ; dans la seconde, vos quelques voisins sont bien trop intéressés par tout ce que vous faites.
Un homme en fuite ouvre le livre avec ses réflexions sur le réseau routier américain. Il sera le narrateur omniscient, jamais nommé. Pouvez-vous nous le présenter ?
J. D. - C'est un homme blanc d'âge moyen qui a réussi, un mari et un père, un Américain qui a le rêve le plus traditionnel des Américains : se réinventer. Bien sûr, une telle évasion ne consiste plus, comme autrefois, à prendre un train et à se rendre dans l'Ouest ; dans l'État de surveillance moderne, même parmi les étrangers, votre visage est une forme d'identification. Il doit trouver le moyen d'échapper au panoptique qu'est devenu le monde.
Vous utilisez les codes du roman policier dès l'entame de Sugar Street (la fuite, l'argent liquide, la recherche de l'anonymat) mais vous allez très vite les pervertir tout en conservant cette tension inaugurale, en la maintenant le long du récit jusqu'au final. Pourquoi ?
J. D. - C'est le personnage lui-même qui raconte sa propre histoire, qui s'éprend un peu de l'image du hors-la-loi, de la figure du mystère. Plus on apprend à le connaître, plus on comprend ces premiers tropes de roman policier comme une forme d'auto-flatterie.
En vous lançant dans ce nouveau livre, aviez-vous l'idée d'une histoire aussi compacte, loin du volume plutôt imposant de Ceux d’ici ?
J. D. - Je savais dès le départ que l'histoire devait être compacte afin de maintenir la tension narrative car une grande partie de cette tension est intérieure plutôt que dramatique. Une grande partie de l'action du roman, après tout, concerne un homme seul dans une pièce.
Ce qui est également frappant à la lecture, c'est la façon dont vous utilisez les paragraphes qui semblent fonctionner souvent avec leur propre narration, s'enchaînant comme autant de micro chapitres au gré des pensées du narrateur.
J. D. - Le style de narration fragmenté et discontinu (que je n'avais jamais essayé auparavant) semblait bien correspondre à l'état d'esprit instable de ce personnage. J'ai imaginé chaque paragraphe non pas comme un morceau d'écriture mais comme une sorte de transcription d'un homme parlant dans sa tête à un public imaginaire.
Comment avez-vous cultivé l'ambiguïté du personnage central, de son regard, cet homme qui apparaît à la fois volontaire dans cette fuite et peu organisé pour autant ?
J. D. - Au début, cette ambiguïté tient à ce que le narrateur lui-même choisit timidement de cacher au lecteur. Peu à peu, elle devient une fonction plus inconsciente de ses propres contradictions intérieures.
Vous avez évoqué Émile Zola et l'influence qu'avait eu votre lecture de Germinal au moment de la publication de Ceux d’ici. Peut-on évoquer Dostoïevski pour Sugar Street ?
J. D. - Absolument ! La narration est parsemée de références à certains des personnages classiques de la littérature américaine qui ont inspiré ce personnage ‒ Thoreau, Tom Joad, Gatsby ‒ mais en fin de compte, son ancêtre littéraire le plus direct est l’homme du souterrain de Dostoïevski. Lui aussi est un dissident, lui aussi est dérangé par l'isolement, lui aussi est sans nom et invisible au cœur de la ville.
S'ouvrant avec une réflexion acide sur le mythe du réseau autoroutier américain (« Route 66, Jack Kerouac, toute cette merde »), Sugar Street détonne d'emblée par sa narration en pointillé, ce flux intérieur que déverse un narrateur qui apparaît autant en quête de lui-même que d'une destination où, paradoxalement, il pourrait disparaître. Paradoxalement car il ne cherche pas l'anonymat des grands espaces mais celui d'une ville. Il va finir par trouver une chambre et se confronter alors aux jours qui passent. Grand chroniqueur d'une société malade d'elle-même, Jonathan Dee poursuit, avec ce nouveau roman, sa peinture d'un monde qui ne semble plus constitué que d'une accumulation de fractures.