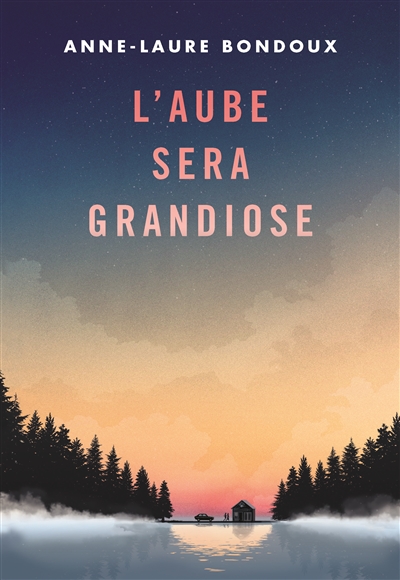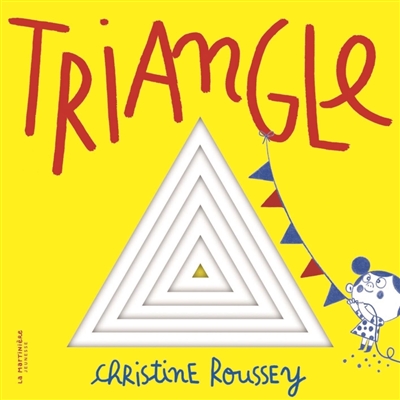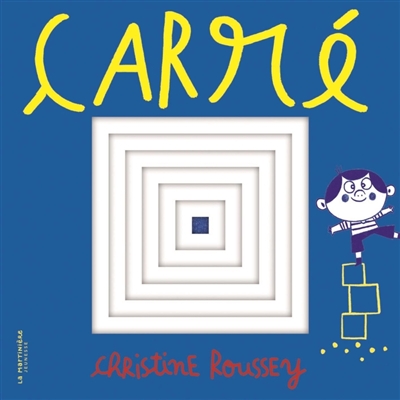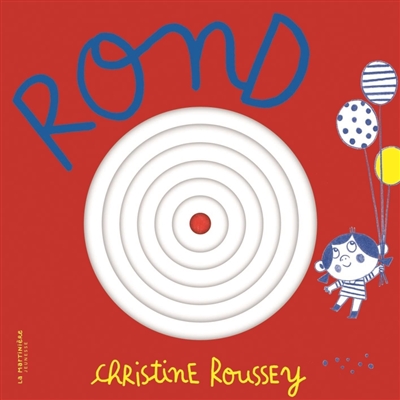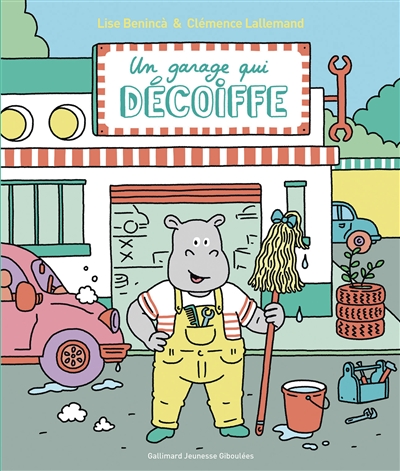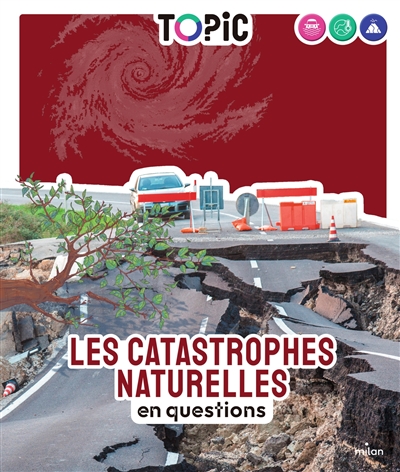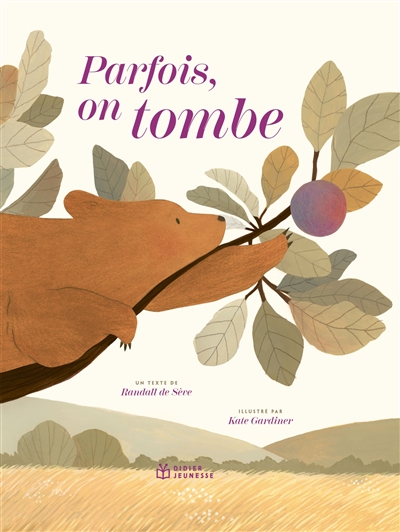PAGE — Le temps d’une nuit, on est immergé dans les années 1970 et 1980. Comment vous est venue l’idée de plonger dans cette époque, que l’on sent imprégnée de vécu ?
Anne-Laure Bondoux — J’ai grandi dans les années 1980. Quand j’ai commencé à publier, en 2000, je n’étais pas si loin de l’adolescence et j’avais l’impression de parler le même langage que mes jeunes lecteurs. Puis le temps a passé et la révolution numérique a modifié en profondeur la culture de la génération montante. Le roman s’est nourri de mes réflexions autour de cet écart générationnel. D’où ce dialogue entre Titania et Nine et cette envie de reconstituer par petites touches l’époque dans laquelle j’ai grandi. Je vois ce livre comme un rendez-vous entre mes lecteurs et moi, mais aussi entre mes lecteurs et leurs parents. Et je fais le pari que le plaisir sera partagé : les plus âgés se souviendront d’avoir joué au jokari, porté des sacs U.S., enregistré des cassettes, et les plus jeunes trouveront dans ces détails une certaine poésie ! Mais l’essentiel, les personnages, les émotions et l’intrigue du roman, tout cela est intemporel.
P. — Les relations familiales, et particulièrement la relation mère/fille, sont au cœur de votre roman, avec l’idée de transmission et de complicité. Quel regard portez-vous sur ce thème ?
A.-L. B. — Là aussi, j’ai puisé dans mon expérience. Il y a dix ans, ma fille avait l’âge de Nine quand nous avons appris un secret de famille qui nous a bouleversées. Il s’agissait de l’histoire de ma mère, qui faisait directement écho à la nôtre. La levée de ce secret nous a beaucoup rapprochées. Depuis, je suis fascinée par les dits et les non-dits qui façonnent les individus et les familles. Dans le livre la mère offre à sa fille les clés de l’histoire qui précède sa naissance. C’est un cadeau un peu lourd à porter pour Nine, mais Titania la respecte et la croit assez solide pour encaisser le choc. Leur relation évolue au fil de la nuit. Pour Titania, c’est une sorte d’accouchement. Pour Nine, une deuxième naissance. Cela ne va pas sans difficultés, mais c’est un acte de délivrance et une fois la parole libérée, le rapport entre mère et fille sera plus juste.
P. — Votre personnage est écrivain comme vous, et votre propre fille a réalisé les illustrations intérieures de votre roman. Comment ces jeux de miroir se sont-ils faits ?
A.-L. B. — J’ai adoré créer ce personnage d’écrivain : une romancière à qui j’ai donné quelques années de plus que moi et une bibliographie très différente puisqu’elle écrit des polars. J’ai joué avec nos ressemblances, bien sûr, mais je la vois plutôt comme une sorte de Fred Vargas fictive. Quant aux illustrations, j’en ai eu l’idée dès le début, notamment parce que j’ai travaillé à partir d’un vieux catalogue Manufrance. À la fin de l’écriture, il m’a paru évident de demander à ma fille de faire quelques croquis. Coline a réalisé une douzaine de planches façon catalogue. Notre collaboration donne à ce roman une couleur particulièrement affective, et un sens encore plus fort à l’histoire.
P. — Le récit se déroule depuis une cabane isolée. Cet endroit secret a un rôle de refuge, en pleine nature. Comment avez-vous eu l’idée de ce lieu ?
A.-L. B. — Ce lieu a été la matrice du roman. Il y a vingt ans, j’ai lu un livre d’Annie Dillard, En vivant, en écrivant (Christian Bourgois) où elle racontait ses séjours en solitaire dans une cabane au bord de l’océan, sur la côte américaine. Après cette lecture, j’ai rêvé d’avoir une cabane à moi pour y écrire. Finalement, je m’en suis fait un refuge imaginaire où je peux aller quand je veux, en pensée. Très naturellement, j’en ai fait le cocon de ce roman.