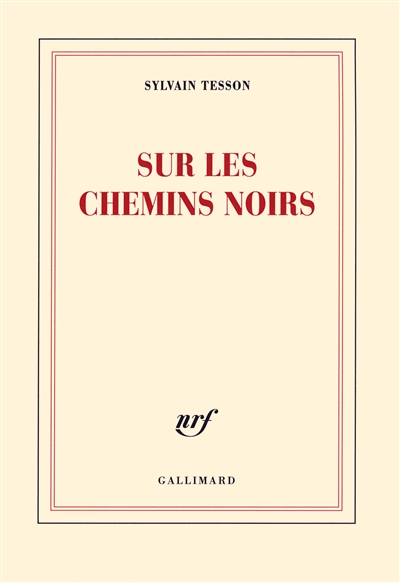Un an après une chute gravissime qui aurait pu lui coûter la vie, Sylvain Tesson entreprend une grande traversée pédestre de la France, du Mercantour jusqu’au Cotentin. S’éloignant des grands chemins, c’est entre « ruines et ronces », le long de sentes oubliées, délaissées ou abandonnées, qu’il évolue, traçant une diagonale buissonnière à travers des territoires considérés comme « hyper-ruraux ». Un cheminement en toute liberté qui révèle des paysages sublimes, souligne les nuances de lumières et de couleurs, s’émerveille de la faune et de la flore, de tout ce qui bruisse, invitant le lecteur à un nouveau regard, à une nouvelle attention sur son environnement. Cette géographie intime des chemins perdus fait surgir l’histoire de parfois territoires vidés de leur population. Les rencontres y sont peu nombreuses et les hommes et femmes croisés en chemin peu diserts. Le regard de Sylvain Tesson, attentif à toute chose, est d’une grande beauté. Il dévoile un cheminement intérieur et littéraire tout aussi passionnant.
PAGE — Vous nous surprendrez toujours ! Alors qu’on vous imagine en homme des grands espaces, qu’on vous attendait revenant d’un périple à l’autre bout du monde, c’est par « ruines et ronces », sur les sentiers les plus modestes de la France, que vous nous entraînez. Comment vous est venu ce désir de traverser ainsi la France à pied ?
Sylvain Tesson — Après un accident (une chute d’un toit), je devais faire de la rééducation. C’est le mot qu’emploient les médecins pour signifier la reconquête de ses forces. Aller à pied du Mercantour au Cotentin me semblait une idée acceptable. En outre, je trouvais que c’était un peu absurde d’avoir passé tant de temps en Sibérie et au Tibet sans connaître L’Indre-et-Loire.
P. — Cette traversée depuis le col de Tende jusqu’à la pointe de la Hague est pour le lecteur un étrange et beau paradoxe. Au plus près d’un territoire apparemment connu, les chemins que vous empruntez sont inattendus. Souhaitiez-vous ainsi porter notre attention sur ces parties du territoire finalement méconnues, oubliées, délaissées, et qui sont, aujourd’hui, aussi éloignées de nous que les forêts de Sibérie ?
S. T. — Je ne souhaite ni délivrer un message ni signaler quoi que ce soit. Je me contente de montrer que le territoire français dispose encore d’un réseau de sentes oubliées et de chemins de silence où l’on peut rencontrer des bêtes, des fantômes, la trace d’un passé somptueux et des points de vue sublimes. Pour cela, il suffit d’une carte au 25:000 et d’une paire de godillots. Mais il faut aussi avoir un minimum de sens de l’orientation, de sens de l’Histoire, et être davantage passionné par la course d’un vautour au bord d’une falaise que par le destin politique des candidats des Primaires.
P. — Sur les chemins noirs est un magnifique éloge de la fuite. Mais cette fuite est le contraire de la fuite en avant et aveugle de notre monde contemporain. Cette fuite « sur les chemins noirs » est une fuite éveillée, une fuite qui dessille, interpelle, réveille. Fuir est-il ainsi la meilleure façon de se retrouver ? Faire un pas de côté est-il le chemin le plus court pour trouver l’essentiel ?
S. T. — Vous avez là une lecture bien élogieuse d’une chose plus simple : fuir, c’est aller sur des chemins qu’on s’est choisi soi-même. Et le fait de se savoir responsable de la direction que l’on prend est une preuve que la direction est bonne. C’est une vieille idée, un vieux penchant que cette envie de se tenir dans la coulisse. Diogène, dans son tonneau, et Syméon, sur sa colonne, poursuivaient la même chose. Parfois il est vital de se tenir derrière l’orée du monde. Et puis fuir devient une urgence. Rendez-vous compte que près de 70 % de la population mondiale vivra dans les villes en 2050. Déjà, résonnent les mesures de « The Fairy Queen » de Purcell : « Let us leave the town ! »
P. — Il y a une très belle résonance entre votre cheminement pédestre et le cheminement littéraire de Sur les chemins noirs. Votre récit prend lui aussi des chemins inattendus, comme si marcher et écrire étaient indissociables, l’un et l’autre se nourrissant mutuellement, en permanence. Marcher et écrire relèvent-ils ainsi du même geste ? Est-ce aussi un geste politique ?
S. T. — Marcher dans la nature nous offre l’occasion de pratiquer l’un des plus beaux et des plus difficiles exercices de l’existence : celui d’être autonome. L’écriture aussi le permet. Mon expression « chemins noirs » a un caractère politique. Je veux dire par là qu’on peut emprunter des voies de traverse, se dissimuler, s’écarter du bruit et de la fureur, fermer les écoutilles. On peut considérer qu’on n’a rien en commun avec l’époque, pas même assez pour s’y opposer. C’est cela « se tenir sur les chemins noirs ». Un anarchiste de Notre-Dame-des-Landes a un programme idéologique, un Credo, une volonté politique. Sans le projet de construction de l’aéroport, il ne peut exprimer son projet. Donc, les uns ont besoin des autres, le promoteur et le destructeur. Le rebelle autoproclamé s’appuie, pour exister, sur le mur qu’il entend faire tomber. Il ne se tient pas sur un chemin noir. En réalité, il crève d’envie d’être dans la lumière. Celui qui a recours aux chemins noirs préfère dire « Goodbye everybody », avant de sauter par-dessus bord.
P. — Sur les chemins noirs est un titre sombre pour un texte lumineux qui en appelle aux sens, souligne les nuances de la lumière, des couleurs, de la végétation, du relief… C’est aussi un texte des émotions et des douleurs intérieures. Est-ce aussi cela ce cheminement qui est le vôtre : faire sourdre la lumière de la noirceur de la vie ?
S. T. — Je suis un être sombre (et non qui se donne des « airs sombres », j’espère, comme disait le Sanders des Épées – Coll. « L’Imaginaire », Gallimard –, de Nimier), mais j’ai un grand appétit pour certaines choses très précises de la vie. L’escalade des rochers, l’alpinisme non doloriste, la rencontre avec les bêtes sauvages (insectes, mammifères ou oiseaux), la contemplation des tableaux figuratifs, de la Renaissance à la fin du XVIIIe siècle, la lecture de tout texte imprimé, « et toutes ces sortes de choses », comme disent les Anglais. Le fait de savoir parfaitement ce qu’il me faut et ce qui est nécessaire à ma vitalité, corrige ma noirceur intérieure. D’ailleurs, comment ne pas être sombre dans un monde qui sera peuplé bientôt de 10 milliards d’êtres humains, dont le secret espoir, quoi qu’ils en disent, est de vivre aussi confortablement qu’un Californien ?