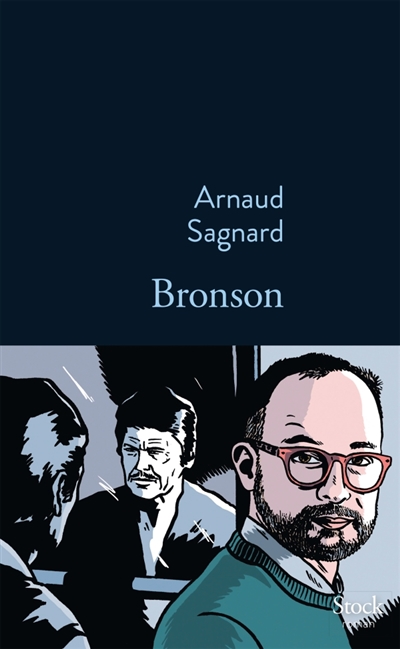Cinéphile ou pas, amateurs de western et de série B... peu importe ! Le Bronson d'Arnaud Sagnard est le roman d'un homme vrai dont on a tous en tête le visage fermé, dur, raviné par un feu intérieur. Derrière l'acteur hollywoodien, derrière la filmographie où les rôles de méchant et de brute tiennent le haut de l'affiche, le romancier décortique l'homme. Derrière la cuirasse, il raconte un Charles Buchinsky, onzième enfant d'une famille d'origine tatare lituano-polonaise. Confronté très jeune et de façon quasi rituelle à la mort, à la pauvreté, Buchinsky devient Bronson grâce au cinéma et à ses rôles de tueur, de dur à cuire mutique et déterminé. La force du roman d’Arnaud Sagnard est de décrypter les rouages d'identification entre un spectateur et une idole de cinéma. Identification, chemins de vie et de mort, le transfert s'opère entre la star et le narrateur. Comme une filiation, grâce aux mots, à la langue âpre qui libère une parole, qui comble des failles et raconte la mort, pour enfin la tenir à distance.
Bronson. Un titre efficace qui claque comme un coup de feu dans la sierra. Quelle image de l’acteur a déclenché l’écriture du roman ?
Arnaud Sagnard — J’ai vécu une expérience commune à beaucoup d’entre nous. Un soir, on se laisse aller devant le programme télé. Je suis tombé sur Le Flingueur, un titre français qui fait fuir. Le titre anglais est bien plus intéressant. The Mechanic date de 1972. Il commence par une scène à l’opposé de tout ce que le cinéma d’action, de série B ou Z, est censé faire. Charles Bronson, cheveux longs et moustachu, prépare un attentat. La scène dure quinze minutes sans qu’il ne soit prononcé un seul mot. Sans la moindre musique. C’est une parenthèse complètement hypnotique. Elle m’est restée en tête, m’a bouleversé. Je me suis dis que j’allais essayer de raconter l’histoire d’un homme vivant ce moment-là, cette vision-là. Le narrateur du roman commence donc à enquêter sur cet acteur de mauvaise réputation... capable de captiver un spectateur sans parler. J’ai trouvé que c’était un geste extrêmement littéraire.
Grosso modo, sa vie s’est jouée en deux lieux. Sa région d’origine, la Pennsylvanie industrielle et ouvrière. Il était mineur de fond dans une famille de quinze enfants d’une grande pauvreté. Il est allé très peu à l’école. Ce n’était pas un intello, c’était un physique. Le second pôle de son existence est l’exact contraire. Il avait la plus grande maison à Los Angeles dans le quartier de Bel Air. Elle faisait face au 18e trou du golf, possédait dix salles de bain. Cela m’intéressait de raconter comment, issu d’un environnement pauvre avec une enfance parsemée de morts, il en est arrivé là. La mort l’a suivi du début jusqu’à la fin. Hors écran et à l’écran. À la fin de sa vie, quand il jouait dans la série de films Un justicier dans la ville, il passait son temps à tirer sur des dealers. À ce moment-là, son fils est mort d’une overdose ! Hormis sa carrière cinématographique, mon enquête portait sur la façon dont il a été lié en permanence à la mort, dans sa vie, dans ses rôles, qu’il soit inconnu ou l’acteur le mieux payé d’Hollywood.
Comment avez-vous construit le livre ? Et notamment la double narration : l’enquête sur Bronson et celle plus intimiste du narrateur face à l’acteur ?
A. S. — J’ai construit le personnage du narrateur avec des morceaux de moi et des morceaux venus d’ailleurs. Pendant l’enquête, ses zones d’ombre ont fait remonter en moi mes propres zones d’ombre qui coïncidaient avec des événements personnels. Enfant, j’ai assisté à la rupture d’anévrisme de mon père. Quand j’ai commencé l’écriture du livre, mes enfants sont nés dans des conditions très compliquées. Pour la deuxième fois dans ma vie, j’étais face à une mort inachevée. Quand on croit à la mort et qu’elle se dérobe, on rentre dans une autre sensation, dans une sorte de choc dilué et étrange. Je raconte une histoire dans laquelle, bien que les robinets des souvenirs et des drames soient fermés, ils commencent à ruisseler tout autour du narrateur.
Charles Bronson, homme et acteur mutique, drapé dans une posture. Comment avez-vous choisi vos mots, votre langue pour en faire un être de papier ?
A. S. — Le travail sur l’écriture, la langue, m’a le plus intéressé. J’ai mis du temps à écrire ce livre. Il y a, en gros, deux ans d’enquête, deux ans d’écriture, et un an de coupe et de gommage. Je voulais trouver une langue qui corresponde à ce bloc de silence. Une langue très sèche, très blanche. J’ai gommé les adjectifs, les mots en trop pour qu’elle soit le prolongement de cette figure que l’on connaît par ses films, bons ou mauvais, sur les affiches, etc. J’ai mené un travail de rétrécissement de l’expression, trouvé les mots qui restituent son espèce d’expressivité... inexpressive.
Arnaud Sagnard, Charles Bronson. Il y a un troisième homme dans votre livre. Qui était Wallace Beery ?
A. S. — Wallace Beery est un acteur du début du xxe siècle. Il a démarré dans le muet. Il était l’idole de Charles Bronson. Lui qui était mineur de fond a voulu marcher sur ses traces et a tenté une carrière au théâtre. Il voulait le faire aussi pour l’argent – qu’il aimait beaucoup. Wallace Beery était un acteur physique, comme Bronson. Il avait la particularité, outre d’avoir remporté un Oscar et d’avoir eu une grande carrière, d’être une ordure totale. Je raconte une anecdote dans le livre qui nous relie à la mort, à celle des enfants. Trentenaire, Wallace Beery a pris sous son aile une jeune actrice qui deviendra célèbre par la suite. Il l’a violée le jour de leur mariage. Elle avait 16 ans. Enceinte, il la fait avorter de force. Dix jours après, ils tournaient ensemble une histoire d’amour !
Alors Hollywood, un univers impitoyable ?
A. S. — Bronson était fasciné par Beery qui avait la réputation d’être un cogneur. C’était une force physique flamboyante, qui, au contraire de Bronson, parlait beaucoup. Il avait des rôles de m’as-tu-vu, de clowns... Wallace Beery était mal considéré par la critique. Sa figure permet de raconter l’envers d’Hollywood. C’est une machine qui fabrique de l’obscurité, de la noirceur. Au début de sa carrière, chaque studio disposait d’un médecin avorteur pour les starlettes qui ne devaient pas gaspiller leur temps en accouchant. Il représente les pans les plus noirs d’Hollywood : le culte de l’argent, la célébrité, les femmes faciles, la toute-puissance des studios. Quand on lui demandait de participer à un film, bon ou mauvais, il le faisait. Il incarne tout ce qu’on tait sur le bel édifice hollywoodien.