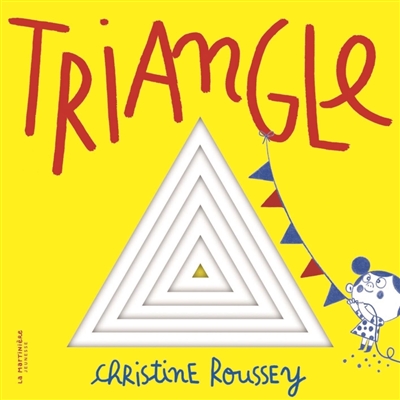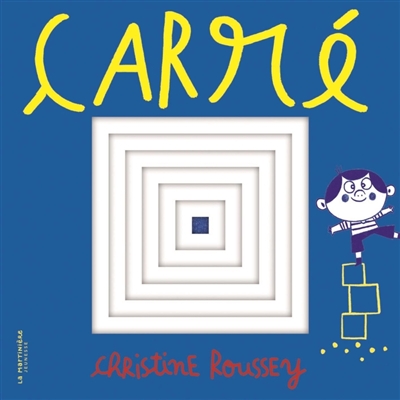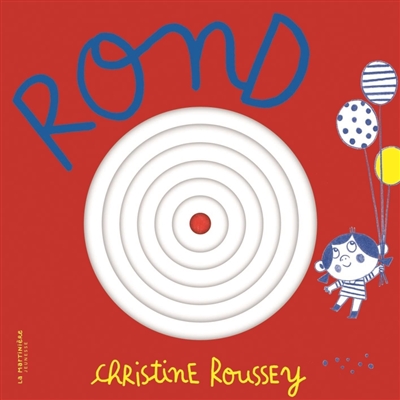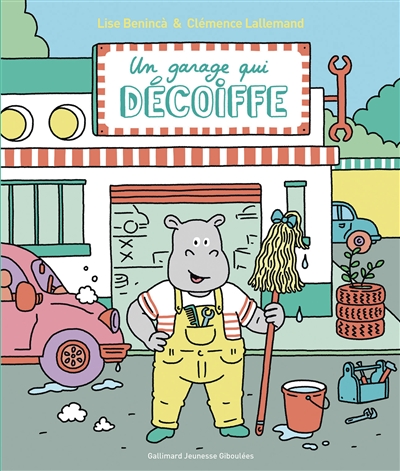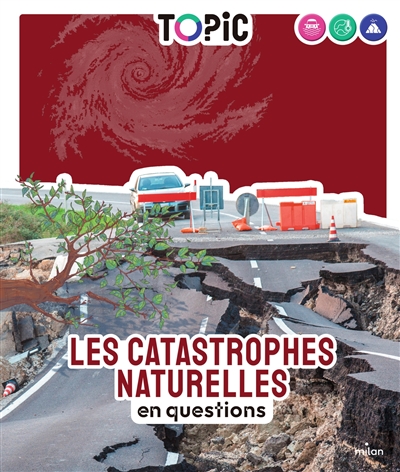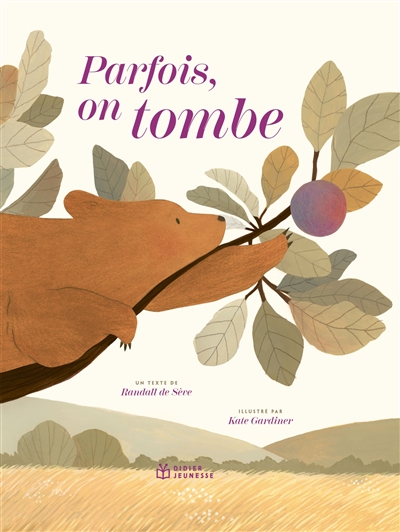Page — Quand Christopher Carandini, journaliste sans emploi suite à une sale affaire, se présente au 30 Portobello Road, il est loin de se douter qu’il vient de sonner à la porte de l’extravagant détective Banerjee, dont les méthodes sont loin d’être conventionnelles dans ce milieu : Banerjee utilise ses rêves pour résoudre ses enquêtes… Pensez-vous que nos rêves puissent nous apporter les réponses à nos questions ?
Éric Senabre — Je ne sais pas si les rêves apportent des réponses. Je serais plus d’avis de penser qu’ils permettent, comme le Yi King chinois, de mettre le doigt sur les vraies questions ; questions que l’on a parfois du mal (par peur, confusion ou autre) à formuler très clairement durant l’éveil. Il n’y a que les vraies questions qui appellent les vraies réponses ! Si les rêves servent à cela, c’est déjà beaucoup.
P — Dans Le Dernier Songe de Lord Scriven, vous frôlez parfois le mystique sans jamais tomber dans la surenchère ou la caricature, est-ce difficile de respecter une certaine frontière ?
É. S. — Ne m’en parlez pas ! Je suis passionné d’arts martiaux orientaux et de tout ce qui gravite autour. La dimension mystique n’est jamais loin ; le charlatanisme non plus. La difficulté, avec le personnage de Banerjee, c’est qu’il évolue dans la sphère du « plausible » ; il fait des choses hors du commun, mais la plupart du temps, celles-ci restent à peu près concevables. En cela, il était délicat de ne pas me faire le chantre de certains fantasmes qui enflamment les Occidentaux dès que l’on parle d’Orient, de méditation, etc. En l’état, j’espère que la dimension « fantastique » du livre est apparente, mais il est vrai aussi que je préfère le fantastique dans sa définition un peu universitaire (une place laissée au doute, pour résumer).
P — Vous êtes journaliste et auteur, comment vous est venue l’envie d’écrire pour la jeunesse ?
É. S. — Pour être tout à fait franc, mon activité de journaliste est totalement déconnectée de celle de romancier, et ne vaut vraiment pas qu’on s’y attarde. Pour ce qui est de votre question plus large, elle est d’autant plus épineuse que je n’ai pas vraiment de culture en littérature jeunesse ; du moins au sens « marketing » que le terme revêt aujourd’hui. Enfant, j’en ai peu lu, je suis passé directement de Fantômette à la littérature populaire pour adultes. Beaucoup de science-fiction, de fantasy et surtout de fantastique et policier, par des auteurs qui, vivants, morts ou en passe de l’être, faisaient déjà figure de « classiques ». C’est ce goût pour cette littérature de genre, cette littérature populaire qui m’a donné envie d’écrire. Aujourd’hui, il se trouve que les collections dites « jeunesse » se sont emparées de ces univers : cela me va fort bien. Je suis ravi d’être lu par des adolescents sans doute proches de celui que j’ai été, mais durant l’écriture, je ne me suis pas focalisé sur le public que je crois être le mien, et j’espère m’adresser au plus grand nombre.
P — La musique est un élément essentiel de votre écriture. Est-ce important pour vous de rythmer votre récit ainsi ?
É. S. — La disparition de mon idole David Bowie m’a permis de mesurer à quel point sa musique, et celle de quelques autres (Paul McCartney, Stravinsky, Eric Dolphy, etc.), avait pesé dans la construction de mon imaginaire, comme la littérature, la peinture ou la poésie avaient pu imprégner le leur. Toutes les sensations sont bonnes à prendre, et on leur rend hommage à travers la forme d’expression que l’on maîtrise le mieux. Le rythme ! Je dirais que c’est au niveau de la phrase, plus que du texte dans son ensemble, qu’il me préoccupe. Je crois être débarrassé de la tentation du « style pour le style », mais j’ai vraiment besoin qu’une phrase sonne. Pas forcément qu’elle « claque », mais qu’elle ait en effet, un équilibre rythmique, qu’on ait du plaisir à l’entendre résonner dans sa tête. Peut-être que par un jeu de fractales, on retrouve cette préoccupation au niveau du récit. Mais spontanément, j’aurais pensé être un peu plus empirique.
P — Un personnage du nom de Mordred apparaît dans votre récit. Les légendes et l’Histoire en général sont-elles des inspirations pour vous ?
É. S. — Les légendes arthuriennes, puis gréco-romaines, ont beaucoup compté pour moi, c’est un fait, mais je ne dirais pas qu’il s’agit d’inspirations ; elles m’ont donné à rêver - ce qui n’est déjà pas mal - et je leur fais un clin d’œil de temps en temps. L’Histoire, en revanche, c’est autre chose. Dans mes projets plus ou moins immédiats, il n’y a rien dont l’action nous soit contemporaine. Mais comme Lord Scriven (et contrairement à Elyssa de Carthage), ces projets seront davantage des « romans en costumes » que des romans historiques. Au fond, ma préoccupation, c’est bien davantage l’intemporalité que l’Histoire. Notre époque se distingue avant tout par l’omniprésence de la technologie. Or, non seulement la technologie moderne me convainc peu sur le plan esthétique (oui, même dans un roman), mais en plus, elle évolue bien plus vite que les auteurs ne produisent. Si l’on est imprudent, sa présence peut rendre un texte moderne pendant six mois… et ringard le reste de l’éternité. En choisissant d’emblée le passé, j’ai par définition davantage de recul – et de contrôle – sur cet aspect.
É. S. - Parfois, quand je regarde mon chat – qui est une véritable teigne – je me demande : « s’il était plus gros, est-ce qu’il essaierait de me bouffer ? ». Certains enfants m’inspirent des sentiments du même type. On parle beaucoup de l’innocence de l’enfance, qui est sans doute une réalité, mais innocence ne rime pas nécessairement avec bienveillance. La bienveillance me semble être une qualité qui, bien qu’innée chez certains, s’acquiert plutôt avec l’âge, l’expérience… et c’est parfois en toute innocence que les enfants sont malveillants. Mais je préfère ne pas trop théoriser tout de même : les enfants que je connais, que j’ai connus, sont tous adorables. Enfin… Presque tous.