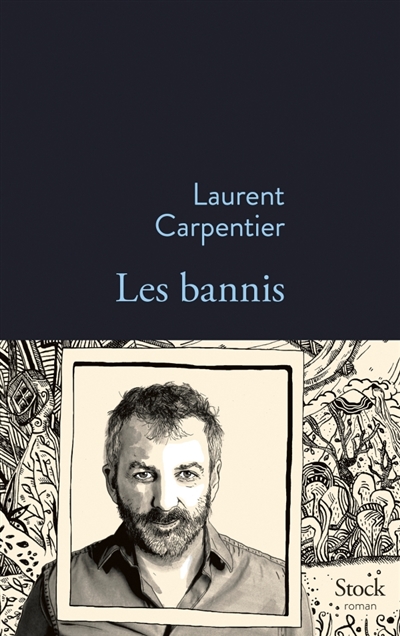Entretien avec Laurent Carpentier from PAGE des libraires on Vimeo.
Entretien avec Laurent Carpentier à l’occasion de la sortie de son roman Les bannis, Ed. Stock
Des histoires, des secrets, des mythes, il y en a dans toutes les familles. Mais, lorsque Laurent Carpentier évoque la sienne, c’est pour nous entraîner dans une « ballade des pendus ». Déportation, exclusion, exécution, rejet, exil… tous portent « le sceau rouge des bannis ». Sous sa plume, cette galerie de portraits s’anime et s’illumine. Pas besoin d’arbre généalogique, car même si s’entremêlent les histoires des mères et des fils, des grands-pères et des oncles, des arrière-grands-mères et des sœurs, plus que la lignée, c’est la singularité de chaque destin de Laurent Carpentier a voulu faire revivre ici une dernière fois avant de laisser aller ses fantômes, pour (enfin) vivre sa vie et libérer sa descendance de cette malédiction des bannis. Mettre sa famille en mots, lui construire un mémorial de papier, c’est trouver sa propre place, son chemin personnel. Un premier roman d’une absolue humanité porté par la sensibilité, la sincérité et la poésie d’un homme qui a choisi de vivre délesté du passé.
Page — Quel a été le point de départ de l’écriture de ce roman dans lequel vous évoquez tour à tour différents membres de votre famille ?
Laurent Carpentier — Je suis sur une autoroute de Bretagne avec ma compagne et je vois un panneau : Saint-Jean-Kerdaniel. Je commence à lui raconter l’histoire de mon grand-père qui a été excommunié de ce village, avec sa mère, de façon assez bizarre. Je me retourne un peu plus sur mon passé et je me rends compte qu’au même moment mon père, qui a été viré du Parti communiste en 1966, est réhabilité par Marie-Georges Buffet ; et je vois un exclu. Ensuite, je vois mon grand-oncle qui a été fusillé par les Allemands au début de la guerre : c’est un exécuté. Puis je vois mon arrière-grand-mère qui est partie à Sobibor : c’est une exterminée. Et je me rends compte que toutes ces histoires racontent une histoire de bannissement. Dans cette voiture, je me mets à pleurer. Pourquoi je pleure alors que, cette histoire, je l’ai racontée cent fois ? Pourquoi d’un seul coup, c’est tellement émouvant ? Justement parce que je comprends que je ne cherche pas à raconter l’histoire d’une famille, je cherche à raconter l’histoire d’un bannissement. À l’origine du roman, il y a aussi un rêve que je faisais à ce moment-là : je suis dans un train qui va en Sibérie, j’arrive, je marche dans la neige, dans un bois de bouleaux. Dans ce bois, il y a un mémorial et je comprends que j’en suis le nouveau gardien.
P. — Vous êtes journaliste, spécialiste des portraits et des entretiens, ce n’est peut-être pas sans rapport avec votre roman ?
L. C. — Effectivement, mon boulot c’est de faire des reportages, mais les portraits c’est un peu ma spécialité. Et quand je fais des portraits, ce qui m’intéresse, c’est le côté « psy », c’est-à-dire que j’aime bien savoir comment fonctionnent les gens, quelle est leur blessure, qu’est-ce qui fait qu’on avance dans la vie, qu’est-ce qui bloque, quelle est la chose qu’on ne raconte pas, de quoi on a peur… Et, à ce moment-là, je crois que j’ai été ému parce que j’avais trouvé ma faille. J’ai commencé à me tourner vers ma famille pour ce qu’elle me raconte de moi, en tant qu’individu. Tous ces personnages collés les uns à côté des autres, vont raconter mon histoire. De ça, j’ai essayé de faire un objet de fiction. L’idée, ce n’est pas de raconter la vérité historique, c’est de raconter une vérité qui nous arrive, avec laquelle on vit et avec laquelle on se débat. Ce sont ces fantômes qui se sont penchés sur votre berceau quand vous étiez petits et qui vous ont donné une espèce de destinée que vous n’avez pas forcément choisie. C’est très facile de savoir le mal que vous font les gens mauvais, mais c’est beaucoup plus difficile de discerner le mal que vous font les gens qui vous veulent du bien. Comme cette grand-mère qui couche à côté de vous pour se protéger elle-même du désir sexuel de son mari, ou cette mère qui vous fait vivre en permanence dans l’idée que vous êtes un survivant. On a tous un cadavre dans le placard, on a tous une histoire, quelque chose qui nous fait marcher dans la vie ou qui nous bloque… C’est ça que j’aime creuser, c’est ça que j’ai voulu raconter dans mon roman. Et, d’une certaine façon, j’essaie de le raconter pour m’en libérer, pour libérer mes enfants parce qu’il n’y a pas de crime qui mérite l’éternité.
P. — Pour autant, vous évitez l’écueil de l’autofiction nombriliste et vous avez vraiment su transformer la galerie de portraits de tous ces « excommuniés, exilés, exclus, exécutés, exterminés, expatriés, exploités, exfiltrés » de votre famille, en un roman. Notamment par un jeu sur les narrateurs…
L. C. — Au départ, j’ai décidé d’un principe de base : il y a plusieurs narrateurs. Certes, il y a le « je » mais il y a aussi beaucoup de « il ». Et j’ai surtout essayé d’écrire toutes ces histoires en me mettant à la place de ces personnes. C’est-à-dire que quand je raconte l’histoire de ma mère, d’un seul coup, je suis ma mère en train d’accoucher, avec cet enfant qui meurt et ce beau-père qui est terrible pour elle. Et ça n’est pas évident, je vous l’assure, d’être sa mère… Trois chapitres plus loin, je suis le beau-père terrible, lui-même rongé par sa souffrance. En fait, je change de paradigme en permanence, en me mettant à chaque fois à leur place, et je raconte chaque histoire comme une fiction, comme si ce personnage n’était pas réel – même si tous les personnages le sont. Alors que cette histoire est quand même assez violente – c’est une histoire de mort, d’extermination –, à chaque fois, ces gens sont des personnages qui chantent. Pour moi, c’est un livre plein de joie. Et ça, il n’y a que la fiction qui peut le raconter. Ce qui m’intéresse, c’est de plonger le lecteur dans l’amour de ces personnages. Je crois que c’est un livre que j’ai vraiment écrit pour eux. C’est une sorte d’hommage. J’ai écrit ce livre parce que j’avais besoin de leur parler, il y avait une espèce d’urgence à leur rendre hommage parce qu’ils sont tous en train de mourir. J’ai fouillé l’histoire de ma famille, mais je n’ai pas fait de recherches historiques parce que la vérité historique ne m’intéresse pas. Ce qui m’intéresse, c’est la vérité telle qu’elle nous arrive, telle qu’on la porte… Je n’ai pas fait un travail de journaliste, j’ai fait un travail de fiction. J’ai essayé de savoir qui sont ces personnages de roman parce que notre vie est un roman. Ce que raconte cette famille, c’est que le plus important est de garder cette histoire vivante, quel que soit le malheur. Au fond, les histoires, c’est ce qui maintient en vie.
Sélection prix du Style 2015 et Fête du livre du Var 2015