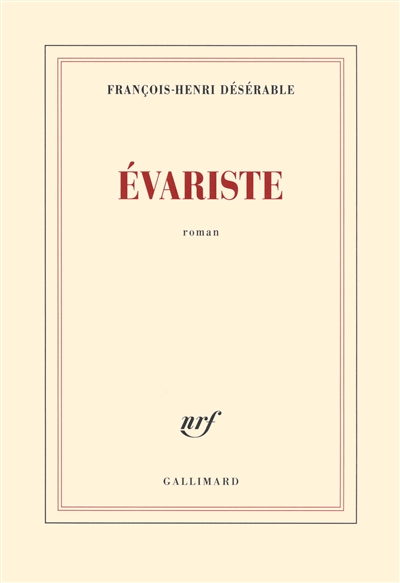Évariste, c’est un ton, un style, un rythme, une voix pleine de fraîcheur et d’impétuosité. Une écriture où l’on retrouve avec délice quelques accents infiniment respectueux venus de Pierre Michon. C’est aussi la vie d’un mathématicien génial, d’un homme pressé, passionné, impétueux et malchanceux, pris dans la tourmente des Trois Glorieuses qui, au moment d’expirer, murmure à son frère : « Ne pleure pas. J’ai besoin de tout mon courage pour mourir à vingt ans. » Un personnage on ne peut plus romantique et romanesque dont François-Henri Désérable s’est emparé avec fougue. Évariste est un de ces romans réjouissants dont on relit des passages à voix haute pour le plaisir d’écouter la langue riche, alerte, surprenante, avec des raccourcis parfois osés mais jamais déplacés. Vingt chapitres qui ne laissent aucun répit au lecteur (qui n’en demande surtout pas) et le laissent un peu groggy… mais si heureux !
Page — Les « littéraires » ayant la réputation d’être hermétiques aux mathématiques, j’imagine que ce ne sont pas les théorèmes d’Évariste Galois qui vous ont passionné. Qu’est-ce qui vous a séduit chez ce personnage ?
François-Henri Désérable — C’est vers 13, 14 ans – à un âge où je me foutais royalement de la lecture – que j’ai pour la première fois lu le nom d’Évariste Galois dans un essai de Simon Singh sur Le Dernier Théorème de Fermat. Je n’avais pas compris grand-chose, à l’époque, mais trois ou quatre pages m’avaient marqué : elles retraçaient le destin de ce garçon né à Bourg-la-Reine, génie romantique qui avait révolutionné l’algèbre, passé les derniers mois de sa vie en prison et qui, à l’âge de 20 ans était mort sur le pré. Depuis, Évariste était quelque part, égaré dans les limbes de mon esprit.
Page — Les mathématiques, la République et l’amour : aucune des trois passions d’Évariste ne lui portera chance...
F.-H. D. — Il se donne corps et âme aux mathématiques, s’y dévoue avec fureur, entièrement, et son mémoire est égaré, réécrit, perdu, refondé, incompris ; il s’éprend de la République avec toute l’impétuosité de sa jeunesse, combat la monarchie et, pour cela, on l’arrête, on le juge et, grand seigneur, on lui offre le gîte et le couvert à Sainte-Pélagie ; il tombe amoureux d’une jeune fille, très vite son cœur ne bat plus que pour elle, et tout aussi vite à cause d’elle il ne bat plus. Non, la chance n’était pas du côté d’Évariste.
Page — Vous avez su trouver un style très personnel et particulièrement attachant : vif, rapide, mâtiné d’impertinence et teinté de beaucoup d’humour, n’hésitant pas à jouer avec les anachronismes. Vous avez pris le parti de vous adresser, non pas au lecteur, mais à une jeune femme que vous interpellez parfois audacieusement. L’écriture et la construction de votre roman vous sont-elles venues spontanément ?
F.-H. D. — La construction du roman est une lente maturation. J’ai d’abord voulu écrire une longue nouvelle sur le duel qui a coûté la vie à Évariste (laquelle aurait complété un recueil avec deux autres nouvelles sur deux autres duels – celui, en 1837, entre Pouchkine et d’Anthès, et celui, moins connu en France, qui a eu lieu en 1804 entre Hamilton, bras droit de Washington, et Burr, alors vice-président des États-Unis). Et puis, en me documentant sur Évariste, je me suis ravisé et j’ai décidé de consacrer un court roman à sa courte vie éminemment romanesque. L’écriture vient alors assez vite dès lors que je tiens, pour chaque chapitre, l’incipit à partir de quoi se déploie tout le reste. Quant au style, au récit, il fallait qu’il soit au diapason de la vie d’Évariste, vif, alerte, tourmenté, mené au pas de charge, tambour battant.
Page — Qu’est-ce qui vous plaisait tant dans le duel pour avoir envie d’écrire sur le sujet ?
F.-H. D. — Il faut croire qu’il y a chez moi une fascination pour les destins brisés, pour les morts prématurées, un tropisme pour essayer de saisir les instants ultimes, les derniers tressaillements de vie chez ceux qui s’apprêtent à mourir – la tête tranchée par le couteau de la guillotine dans Tu montreras ma tête au peuple, ou d’une balle de pistolet dans le cas d’Évariste.
Page — Effectivement, dans Tu montreras ma tête au peuple (Folio), vous évoquiez dix destins brisés ou fortement marqués par la terreur révolutionnaire. Évariste Galois est étudiant au moment des « Trois Glorieuses ». Dans quelle mesure ces contextes politiques agités vous inspirent-ils ?
F.-H. D. — Il y a pendant la Révolution française, et dans une moindre mesure pendant les Trois Glorieuses, une véritable accélération de l’Histoire, comme si pendant des siècles on avait empilé des dominos les uns sur les autres, dans un équilibre précaire, et que le doigt de l’Histoire était venu effleurer cet énorme édifice un peu branlant – qui a pour nom Ancien Régime pendant la Révolution, ultracisme sous le règne de Charles X –, pour le faire vaciller, puis d’un seul coup s’effondrer. Dans cet effondrement des vies s’effondrent, elles aussi. Elles me fascinent.
Page — En exergue d’Évariste, vous citez Pierre Michon. Vous lui rendez aussi un très bel hommage en forme de clin d’œil, ainsi qu’à Hugo et Dumas, dans un des portraits du recueil Tu montreras ma tête au peuple. Que représentent ces écrivains pour vous ?
F.-H. D. — Ce sont des géants que je regarde en levant la tête, des guides envers qui je suis redevable, des pères dont je suis l’enfant naturel au sens du droit, c’est-à-dire illégitime, le bâtard qui joue des coudes pour trouver sa place dans la fratrie, qui s’évertue, toute sa vie, à racheter l’indignité de sa naissance en se montrant le plus digne des fils. Et qui échoue, le plus souvent.
Page — Quel roman de l’année 2014 vous a le plus marqué ?
F.-H. D. — Vous ne m’en voudrez pas si j’en cite quatre ? Histoire de ma sexualité d’Arthur Dreyfus, un roman dont on n’a pas encore mesuré l’importance, qui démythifie la sexualité pendant l’enfance. Le Désordre Azerty d’Éric Chevillard, pour la faculté jubilatoire, inouïe qu’il a de tordre le langage (je peux difficilement résister au plaisir de donner cette phrase en exemple : « Veuillez laisser en sortant ce lieu tel que vous auriez souhaité le trouver en arrivant, reçut pour consigne le Tintoret lorsqu’il pénétra pour la première fois dans la Scuola Grande di San Rocco à Venise, en 1564. Vingt-quatre ans plus tard, il était dehors. ») Réparer les vivants de Maylis de Kerangal, pour la poésie de ses phrases rythmées sur les battements d’un cœur. Et L’Amour et les forêts d’Éric Reinhardt, sublime portrait de femme – qui a bien failli me faire chialer.