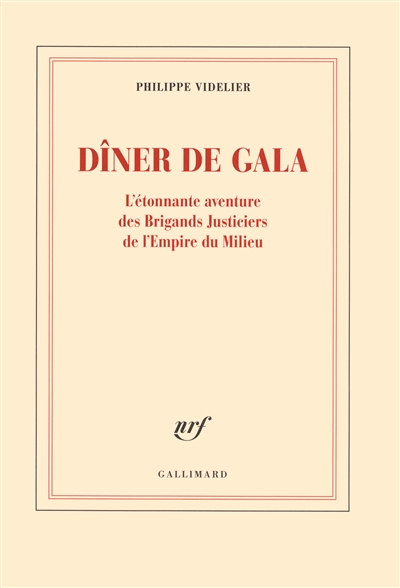Philippe Videlier, Dîner de gala est votre troisième roman. Vous aviez publié Nuit turque en 2005 et auparavant Le Jardin de Bakounine et autres nouvelles de l’Histoire chez Gallimard. Il avait été annoncé que votre livre était un grand roman sur l’histoire de Mao Tsé-toung. En réalité, c’est bien davantage car si vous racontez effectivement le parcours de celui-ci, vous évoquez également quantité d’autres choses. Dîner de gala est un roman immense, immense par la taille, 600 pages, l’un de ces grands formats typiques des éditions Gallimard, semblable, par exemple, à L’Art français de la guerre d’Alexis Jenni, paru l’année dernière. Un roman immense aussi par l’ambition littéraire, par le sujet, qui consiste à retracer non seulement l’épopée de Mao mais aussi celle de ses compagnons et des nombreux personnages qu’ils vont croiser, soit le xxe siècle chinois et une bonne partie de l’Histoire mondiale. Et c’est un livre immense par la façon dont vous envisagez cette aventure, puisque vous la rapportez à la manière d’un roman chinois. Ici, la grande Histoire est émaillée d’une multitude de petites histoires mises en scène avec beaucoup d’humour. J’ai dit que votre récit de l’aventure maoïste était rapporté à la manière d’un roman chinois, je précise toutefois qu’il ne s’agit en rien d’un pastiche. Je n’ai jamais lu quoi que ce soit qui s’approcherait de ce texte d’une radicale originalité et qui fait de Dîner de gala, à mon sens, le grand livre de la rentrée. Philippe Videlier, pourquoi avoir choisi la Chine ?
Philippe Videlier — Voilà une question qui remonte à loin et dont il serait trop long de vous exposer ici la chronologie. Disons, pour être le plus bref possible qu’elle naît avec la lecture du Lotus bleu. Je ne vais pas vous ennuyer avec ce qui a succédé à cette expérience fondatrice, mais sachez que j’ai entretenu à partir de ce moment une étroite relation avec la Chine. J’avais depuis longtemps le désir d’écrire une histoire qui raconterait ces trois quarts de siècle commençant, pour les cinéphiles, avec Les Cinquante-Cinq jours de Pékin, se poursuivant avec La Canonnière du Yang-Tse et s’achevant avec La Chinoise de Jean-Luc Godard. Sur cette période, il y a énormément à dire pour qui veut appréhender la Chine dans son rapport au monde. Par ailleurs, raconter cette épopée, qui est celle d’une bande plutôt que celle du seul Mao, la geste de la bande à Mao en quelque sorte et des multiples personnages la composant, me semblait un projet passionnant. Vous connaissez sans doute ce roman chinois, Au bord de l’eau, qui retrace les péripéties des 108 brigands justiciers. Dîner de gala est aussi une histoire de brigands justiciers – même s’ils ne sont pas 108 –, mais c’est sous cette forme qu’il me paraissait le plus pertinent de considérer cette histoire, sous la forme d’un corps, en tant que somme d’individualités très différentes les unes des autres, aux destins à la fois tragiques et extraordinaires, mais entraînées par un même moteur.
Comment est née l’idée de ce roman, hors normes dans sa dimension autant que dans son projet ? Est-ce que vous saviez, en vous lançant dans cette entreprise, qu’elle aboutirait à un monument de 600 pages ? Était-ce votre ambition initiale ?
P. V. — Absolument pas. Vous l’avez rappelé, j’avais publié chez Gallimard Le Jardin de Bakounine et autres nouvelles de l’Histoire qui parlait de dix personnages appartenant à l’histoire révolutionnaire des xixe et xxe siècles et se composait de dix nouvelles. J’ai abordé Dîner de gala dans cet esprit en le concevant d’abord comme une nouvelle qui s’articulait autour du personnage de Mao. Écrire une nouvelle implique, en général, que l’on en a préalablement imaginé la fin. J’avais ma fin, mais plus je progressais, plus je prenais conscience de la démesure du contexte, de sa lourdeur, de sa dimension tragique, de la gravité des événements vécus par la Chine tout au long du xxe siècle. Le registre de la nouvelle m’a dès lors semblé intenable pour rendre compte de faits d’une telle ampleur. Je devais trouver quelque chose de plus approprié, tout en transmettant ce contexte à un public occidental souvent peu initié à la chose chinoise.
Justement, vous recourrez à une forme influencée par la littérature chinoise. Chacun de vos chapitres est introduit par un incipit de ce genre : « À son corps défendant, l’Ours Téméraire revient sur le devant de la scène. Des étudiants inconscients attaquent le quartier général. » ; et tous se terminent par une formule du style : « Il ne faut pas être grand clerc pour imaginer la suite, mais si le détail de l’affaire vous intrigue, alors ne faites pas l’économie du chapitre suivant. » L’ensemble du roman est porté par ce ton, cette langue. Qu’est-ce qui vous a donné envie de donner à votre roman cette forme très singulière ?
P. V. — Il y a un classicisme du roman chinois auquel il m’intéressait de me frotter. Tous les grands romans chinois, dont ceux qui appartiennent à ce que l’on appelle communément « Les quatre Trésors », dont font par exemple partie Au bord de l’eau ou L’Histoire des Trois Royaumes, Le Singe Pèlerin, etc., sont écrits sous cette forme. Je me suis demandé comment, en tant qu’écrivain français, rendre accessible aux lecteurs un univers qui leur est fondamentalement étranger, comment restituer de la manière la plus vivante possible ce qui nous apparaît comme le comble de l’exotisme – tandis que, à l’inverse, l’Occident apparaît aux Chinois comme un sommet d’exotisme –, comment procéder à cette transcription, ce passage. J’ai utilisé cette forme littéraire afin de créer une passerelle entre nos deux mondes. Si je vous dis : « Voilà, c’est l’histoire de Mao… », je suis à peu près certain d’être accueilli par des réactions accablées d’ennui. En revanche, si je vous annonce les aventures de Petit Chien, dit « Rouge Vertu » que sa grand-mère tenta naguère de noyer, que c’est l’histoire de Tête de Fouine, colonel de l’Académie militaire de Whampoa qui avait peur du froid, du vent et de la pluie, si je vous dis : ceci est l’histoire de Petite Bouteille, qui imprimait des tracts à la ronéo dans un café de la place d’Italie, à Paris, quand il était étudiant en France… Si je vous présente les choses de cette manière, alors vous êtes propulsé dans une autre dimension, une dimension qui, je crois, est en mesure de rendre compte de ce que furent, véritablement, ces trois quarts du xxe siècle chinois.
Et le moins que l’on puisse dire est que cela fonctionne. Avec la musique de cette langue qui, je le répète, n’a rien d’un pastiche, Dîner de gala possède une patte occidentale et une forme chinoise. La fusion de ces deux univers fonctionne à merveille ; de même, la fusion, au sein de votre système narratif, de grandes séquences historiques et de petites anecdotes confère une autre de ses forces au roman. Je pense notamment à une partie de ping-pong entre Gregory Peck et Mao alors que le pays est plongé dans la terreur de la Révolution culturelle, et où l’acteur américain lance à son adversaire, en gros : « Votre livre, en dehors d’emballer du poisson, je ne vois pas pourquoi on fait un tel foin de ce petit truc rouge ! » Une foule d’histoires du même tonneau se greffe aux grandes décisions historiques, aux grandes batailles, aux grands événements de l’Histoire chinoise, et cela apporte une étonnante puissance à l’ensemble. Comment avez-vous construit la trame ?
P. V. — Je crois qu’il est impossible de parler d’une histoire atteignant ce degré de tragédie sans aller au plus profond des gens, des acteurs qui y ont participés à cette histoire. Ce qui rend compte de la tragédie des massacres de Nankin n’est pas de dire que Nankin a connu un assassinat de masse de type génocidaire en 1937 – passé relativement inaperçu en Occident. Une fois que vous avez énoncé cela, vous n’avez rien dit, ou presque. Par contre, se rendre à Nankin, décrire les lieux, expliquer que dans telle rue est survenue telle chose, qui s’est déroulée de telle manière, sous la direction de tel officier meurtrier… Là, vous rendez les choses vivantes, concrètes, compréhensibles. J’ai procédé de cette façon. Cette histoire est très méconnue en Occident, sauf à grands traits qui ne sont souvent que des caricatures. Pourtant, l’un des intérêts de cette histoire résidait aussi dans le fait que la Chine comptait à l’époque un nombre important d’Occidentaux, qui ont laissé des témoignages à travers leur correspondance, des écrits, des souvenirs, etc. En puisant dans cette matière, on se fait une idée assez précise de la perception que les Occidentaux se faisaient des événements.
De fait, on croise au fil des pages des personnalités comme André Malraux, Simone de Beauvoir, Andy Warhol, de nombreux autres encore. Et la truculence qui innerve le récit ne perd jamais de vue la nature du drame en train de se jouer. L’ampleur historique est par ailleurs omniprésente.