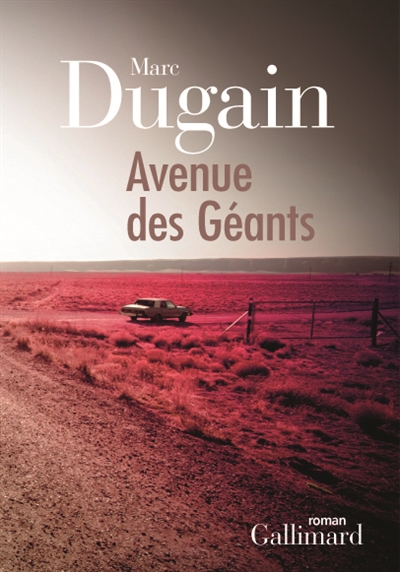Page : Des gueules cassées aux ombres de la présence française en Allemagne, la qualité de vos sujets frappe et vous place, à mon avis, en marge d’une grande partie de la production littéraire française actuelle. Comment appréhendez-vous ce moment de votre travail qui consiste à choisir un sujet ?
Marc Dugain : À bien y regarder, je parle un peu toujours de la même chose, du rapport de chacun à l’enfermement physique ou psychologique, de la prédestination, de l’appel de l’espace. Malgré un sujet difficile, j’ai pris beaucoup de plaisir à me glisser dans la peau de ce personnage pour comprendre son mode de fonctionnement. C’est une expérience littéraire originale pour moi, qui me permet aussi d’évoquer une époque qui compte énormément dans ma formation intellectuelle et artistique, celle des années 1965 à 1975, lesquelles marquent une réflexion profonde sur notre organisation sociale, même si cette réflexion est restée sans grands lendemains.
P. : Qu’est-ce qui vous a amené à vous glisser dans la peau d’un tueur en série et pourquoi celui-ci ?
M. D. : Me glisser dans la peau d’un tueur en série ne m’a jamais tenté jusqu’à ce que je croise mon personnage. J’ai trouvé fascinant que son intelligence supérieure lui ait permis de décrypter son mal et l’origine de celui-ci, mais que malgré cela, il n’ait pas pu résister aux pulsions meurtrières qui en résultaient, preuve que les facultés intellectuelles ne peuvent pas grand-chose contre les blessures de l’enfance, que le cerveau rationnel est impuissant devant la calcification du cerveau émotionnel.
P. : L’autre grande qualité de vos romans est l’angle toujours original sous lequel vous abordez vos sujets : vous parlez d’Edgar Hoover et vous mettez en scène son confident, vous parlez du Koursk et vous faites revivre la période stalinienne avec une femme médecin magnétiseur… Avenue des géants ne déroge pas à cette règle et surprend de bout en bout : pouvez-vous nous parler du double dispositif, hypnotique, que vous mettez en place pour nous raconter le parcours d’Al Kenner ?
M. D. : S’agissant d’un schizophrène, le sujet m’a poussé à mener deux narrations, l’une subjective, l’autre objective. La subjective repose sur une grande honnêteté du narrateur et une énorme duplicité. L’objective me permet de repréciser des enjeux, sociaux en particulier, ainsi que de montrer cet homme dans sa prison, près de quarante ans après les derniers faits. Je me suis attaché à ne jamais sombrer dans l’horreur, dans le voyeurisme ou dans le sensationnel, qui auraient, de mon point de vue, tué le sujet.
P. : Sur un thème véhiculant autant de légendes urbaines et souvent exploité par la littérature et le cinéma, comment avez-vous effectué vos recherches ?
M. D. : J’ai passé l’été dernier aux États-Unis et j’ai refait tout le parcours de mon personnage, tout en écrivant sur place chaque matin de 6 h à 10 h 30, avant de reprendre la route. Certains lieux m’ont terrifié, j’en ai inventé d’autres. De même, de nombreux travaux, dont ceux de Stéphane Bourgoin, m’ont permis de cerner le personnage, en particulier par les entretiens qu’il a pu donner, mais j’ai exercé pleinement mon droit d’écrivain en me l’appropriant pour essayer de le restituer au plus près de ce que je le crois être.
P. : Edmund Kemper est toujours en vie : cela a-t-il influencé votre écriture ? Avez-vous voulu/pu le rencontrer ? Pourquoi avez-vous changé son nom d’Edmund Kemper en Al Kenner ?
M. D. : Dès le moment où on romance la vie de quelqu’un, sauf s’il s’agit d’une très grande célébrité, je pense qu’il est préférable de choisir un autre nom. Je n’ai jamais eu l’intention de le rencontrer car je ne suis pas journaliste ni documentariste, il ne m’intéresse pas en tant que personne définie mais dans ce qu’il incarne d’une humanité complexe.
P. : Votre roman est aussi un roman sur une Amérique en rupture avec elle-même, dont vous décrivez le processus au travers de l’apparition du mouvement hippie et de la contestation des valeurs traditionnelles. Quelle est votre opinion sur cette tentative de parenthèse – malmenée dans votre livre entre la vision très négative d’Al Kenner et son rapport avec l’(ex ?)-hippie Susan ?
M. D. : Pour être sincère, j’ai beaucoup de tendresse pour cette période hippie et la formidable utopie qu’elle a représentée. Elle a été très prémonitoire quant au rapport catastrophique que nous entretenons avec la nature et je crois, comme le personnage, que cette expérience a été terrassée par le sida et l’excès de stupéfiants. Cela restera néanmoins pour moi une époque de grande liberté où l’Amérique s’est montrée telle que je l’aime, c’est-à-dire l’exact contraire de la période du gouvernement néo-conservateur de Bush.
P. : La littérature est très présente dans le livre, entre les évocations d’Al Kenner (sa condamnation du roman policier, Dostoïevski…) et son envie d’écrire : quel rôle y tient-elle ?
M. D. : La littérature est toujours là. En écrivant ce roman, je lisais le Journal de Kafka, autre exemple d’intelligence exceptionnelle, mais cette fois au service de la civilisation. L’histoire de Kemper est celle d’un gâchis dont on ne peut pas mesurer l’ampleur. Avec une mère autre que celle qui l’a tué dans l’œuf, c’est quelqu’un qui aurait peut-être pu jouer un grand rôle pour l’humanité. Je n’ai pas d’empathie pour mon personnage, mais je reste persuadé que l’animal culturel que nous sommes est essentiellement déterminé par le contexte familial et social dans lequel il grandit.