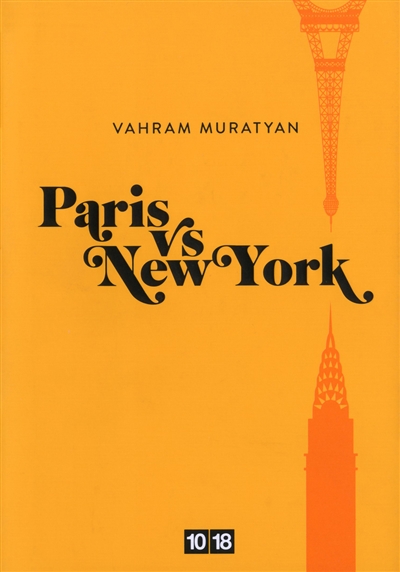PAGE : Comment vous est venue l’idée de ce livre en forme de « match amical entre deux villes » ?
Vahram Muratyan : Avant que Paris VS New York ne soit un livre publié chez 10/18, c’était un blog, né à l’automne dernier à la suite d’un voyage prolongé sur la côte Est des États-Unis. Je venais d’avoir 30 ans. J’ai vécu à Paris pendant plusieurs années et j’ai eu envie de voir autre chose. Une fois à New York, tout le monde me demandait comment j’avais pu quitter Paris ; je me suis dit que c’était marrant cette envie mutuelle qui habitent Parisiens et New-Yorkais. Ce sont deux villes vraiment proches, ça se joue parfois à des détails, j’ai eu envie de les mettre en rapport. Je dessinais dans mon carnet de croquis, comme un observateur du monde sous mes yeux. Je n’ai pas tout de suite pensé à en faire un livre, j’avais plutôt en tête des sérigraphies, une technique qui se limite à quelques superpositions d’encre, d’où l’aspect minimaliste que j’ai donné à mes dessins. J’avais cette volonté de revenir à quelque chose de simple, d’innocent.
P. : Pour en venir justement à l’esthétique de vos dessins, on sent une forte influence des années 1950. On pense à Mad Men ou au générique du film Attrape-moi si tu peux. Vous reconnaissez-vous dans ces influences ?
V. M. : J’imagine souvent New York en affiches de compagnies aériennes des années 1950. Ma mère travaillait pour la TWA, on avait pas mal d’affiches à la maison. Quand j’étais à New York, il y avait une exposition des affiches de la Pan Am au MOMA, très minimalistes, faites avec les moyens de l’époque et basées sur une façon simple de communiquer pour être compris par un maximum de personnes. C’est exactement ce que raconte la série Mad Men. Mes dessins sont un hommage à cette époque avec les moyens actuels.
P. : Comment sont classés les dessins ? Par ordre de création ? On sent parfois une envie de raconter une histoire...
V. M. : Oui, ce serait « a day in the life », comme on dit en anglais. Les pages de garde sont le commencement d’une journée à Paris, sa fin à New York. L’idée du début, c’était d’être dans l’humeur du jour en restituant des éléments d’une journée type : le café, le journal, les transports, avec des ponts et des croisements entre les deux villes. Il y avait cette idée de parcours, comme sur une carte imaginaire réunissant les deux lieux. Se réveiller à Chelsea, aller travailler à Miromesnil, se balader à Central Park et aller boire un verre avec des amis sur la rive gauche de la Seine.
P. : Dessine-moi un Parisien d’Olivier Magny ressort chez 10/18 en version augmentée, ainsi qu’en anglais aux USA, tout comme votre propre livre outre-Atlantique. Vous êtes-vous rencontrés ?
V. M. : Oui, nos projets se sont croisés chez les deux mêmes éditeurs. C’est assez marrant, il y a encore une fois un côté aller-retour entre les deux villes qui me plait, comme un voyage, un lien. Olivier Magny et moi partageons énormément de points de vue sur Paris et les Parisiens, lesquels ont beaucoup en commun avec les New-Yorkais. Les frontières par exemple : le Parisien ne dépasse jamais le périph’, comme le New-Yorkais ne dépasse jamais la quatorzième rue. Ce snobisme également très attachant du Parisien, ces défauts qui entrent en contradiction avec ses propres modes de pensée. C’est un calvaire pour lui de faire trente minutes de métro pour traverser la ville, mais il est prêt à perdre trois heures pour aller passer le week-end à Londres. Il en est conscient et il en joue.
P. : Dans la ville idéale, quels éléments garderiez-vous de Paris, quels éléments de New York ?
V. M. : Des deux villes, je garde l’aspect piéton. Le bruit, le mouvement des deux villes me plait. À Paris, je garde le degré d’amitié qui est plus fort. On entretient plus facilement une relation amicale, sincère et forte avec les gens que l’on rencontre. C’est moins le cas à New York, qui est plus une ville de passage, où les gens finissent par déménager et aller vivre loin, à Seattle, Atlanta ou San Francisco. À l’inverse, à New York, ce qui me plait, c’est qu’on part du principe que chaque personne croisée est intéressante. La conversation avec son voisin de table, de métro, s’engage facilement, sans arrière-pensée. Il y a une spontanéité, un art du vivre ensemble.
P. : Vous vous attachez beaucoup aux éléments de décor et d’architecture, plus qu’aux habitants. Si l’on distingue bien Paris de New York, votre propos est-il de dire que les Parisiens et les New-Yorkais eux, se ressemblent, ont en commun d’être des citadins ?
V. M. : Je voulais montrer les deux villes comme des terrains de jeux, vides, dépouillés à l’extrême, pour que le lecteur se projette, ne prenne pas partie. Qu’il s’approprie les situations, les décors pour se mettre en scène dans mes dessins. C’est lui qui choisit d’attraper le bagel ou la poussette dans Central Park. C’est aussi une distorsion de la réalité, j’avais envie de parler de ces villes de façon très positive, montrer leur essence. Je voulais un musée idéal constitué d’objets du quotidien et de plaisirs simples. À une époque où tout est alarmiste, où l’on vous annonce en permanence la fin du monde, je me rapproche de l’enthousiasme new-yorkais, et d’un côté Amélie Poulain idéalisant Paris.