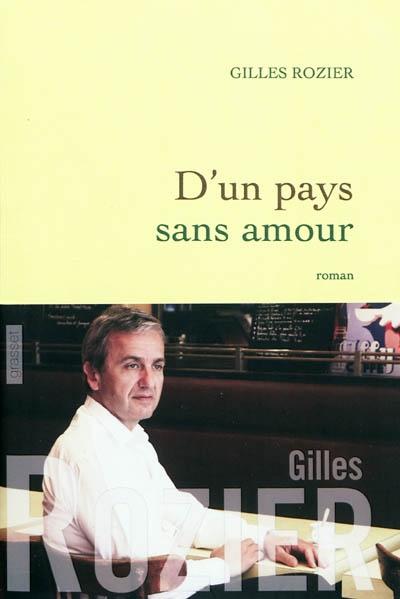PAGE : Dans votre dernier roman, vous vous intéressez à la vie de trois poètes yiddish. Pourquoi précisément ces auteurs ? Qu’est-ce qui vous a passionné dans leur destin ?
Gilles Rozier : Je suis tombé sur ces trois personnages quand j’ai commencé à apprendre le yiddish. Une de mes professeurs nous avait fait découvrir leurs poèmes. Mais plus encore que leur création, c’est leur vie qui m’a fasciné. Je les trouvais très romanesques. Ce qui m’a plu, c’est l’idée qu’ils se rencontrent à Varsovie alors qu’ils ont à peine plus de 20 ans et qu’ils ont envie de mettre le bazar dans l’establishment littéraire. Ils étaient contemporains des dadaïstes, et non moins talentueux. À 25 ans, ils écrivaient des choses magnifiques. Ils créent une revue littéraire en 1922, font scandale, mais l’aventure ne dure pas, et c’est là que ça devient encore plus romanesque : l’un, Uri-Zvi Grinberg, part en 1923 en Palestine, il tourne le dos au yiddish et devient un grand poète qui écrit en hébreu. Il vire à l’extrême droite, est élu en 1948 comme député à la Knesset sur la liste de Menahem Begin. Il est considéré en Israël comme le Céline israélien, si on peut oser la comparaison. Le deuxième, Peretz Markish, s’installe à Moscou en 1926, il devient un des écrivains yiddish en vue de l’Union soviétique, prix Lénine à la fin des années 1930, traduit en russe, en ukrainien. Le troisième, Melekh Rawicz, croit davantage à un avenir pour les Juifs en Pologne. Il est actif dans un réseau d’écoles yiddish qui se développe dans le pays, mais au début des années 1930, il commence à déchanter. Il part, fait le tour du monde, Mandchourie, Shanghai, Singapour, Australie, Afrique du Sud, Argentine, Mexique, New York, Chicago et s’installe finalement à Montréal en 1941. Ces trois destins me permettaient de retracer tout l’exode des Juifs de Pologne entre les deux guerres et, par leur petite histoire, de mettre un pied dans le grande : le bolchevisme, la création de l’État d’Israël, etc.
P. : Vous êtes directeur de la Maison de la culture yiddish. Votre roman entend faire revivre une langue, un monde disparu, le Yiddishland. Pourquoi un tel intérêt pour la culture yiddish ?
G. R. : J’y ai un intérêt personnel, c’était la langue que parlaient mes grands-parents maternels, que je n’ai pas connus. J’avais envie de retisser un lien avec mon grand-père assassiné à Auschwitz. Mais je me suis laissé prendre au piège. Si la culture yiddish n’avait été porteuse que de quelques chansons populaires et de comptines, je suppose qu’elle ne m’aurait pas accroché de cette manière. J’ai découvert une langue complexe, passionnante, et une grande littérature, largement méconnue. Je vous l’ai dit : ces trois poètes sont de la qualité de Cendrars, Apollinaire, Rilke.
P. : Le titre de votre livre D’un pays sans amour est tiré d’un poème d’Uri-Zvi Grinberg. Quel est le sens de ce poème ? En quoi représente-t-il l’âme de votre roman ?
G. R. : La strophe entière dit :
« Mère, nous arrivons d’un pays sans amour
D’un pays où Dieu est absent
Déluge en tête et crépuscule dans le sang. »
Dans ce poème, Uri-Zvi Grinberg prédit en 1922 que l’Europe ne sera bientôt plus qu’un grand cimetière juif. Il enjoint son lecteur de fuir à toutes jambes. C’est d’un prophétisme troublant. Ce vers est emblématique du roman dans la mesure où les Juifs avaient développé en Pologne, en Ukraine et en Biélorussie une culture originale sans puissance étatique, simplement constituée par un réseau de communautés et de bourgades en permanence reliées les unes aux autres. Les hommes et la pensée y circulaient à grande vitesse. Et tout cela avec une langue commune de Riga à Bucarest, de Breslau à Brest-Litovsk, dépassant les frontières des pays et des empires.
P. : Le narrateur rencontre Sulamita qui possède une magnifique bibliothèque. Celle-ci représente la culture, la mémoire, le passé. Pourquoi un tel attachement au passé ?
G. R. : Il me semble que, quand on aime un tantinet la littérature, on a toujours un pied dans le passé, non ? Stendhal ne nous livre pas seulement de formidables histoires d’amour, mais également la France du temps des guerres napoléoniennes. Proust décortique avec minutie l’âme humaine, il restitue un portrait sans concessions de la petitesse de ses contemporains et de leurs faiblesses, mais il décrit aussi la France de l’Affaire Dreyfus et de la guerre de 1914. Et Annie Ernaux dans Les années nous invite à nous retourner sur un demi-siècle d’Histoire de notre pays. D’un pays sans amour est né, outre l’idée que j’avais en tête depuis une vingtaine d’années, d’une conversation avec Pierre Assouline et Jean-Claude Grumberg. Grumberg remarqua que personne n’avait encore écrit l’équivalent de L’archipel du goulag concernant le génocide des Juifs par les nazis. Pierre Assouline se tourna vers moi en m’invitant à le faire. En l’occurrence, ce n’est pas du tout ce que j’ai fait, mais plutôt la tentative de restituer un monde, celui d’avant le génocide – la culture yiddish et le monde juif de Pologne dans son effervescence d’entre les deux guerres – de la manière la plus exhaustive possible. L’entreprise est impossible, bien entendu, et d’ailleurs, Sulamita, la narratrice, est en permanence obsédée par cette impossibilité. Mais taraudée par cette obsession, elle finit par raconter beaucoup de choses.
P. : Vous faites partie d’une génération dont les parents n’ont pas ou peu parlé de la Shoah, et qui cherche des réponses. Votre démarche s’apparente-t-elle uniquement à un désir de retisser les liens de l’histoire familiale ?
G. R. : Dans mon cas personnel, ma mère en a au contraire beaucoup parlé. Elle avait 8 ans quand ses parents ont disparu, elle ne se souvient pas de grand-chose, mais elle n’a jamais caché ce dont elle se souvenait. Il n’y a pas de réponse au génocide. C’est comme si on tentait de trouver une raison à un tsunami. Sauf que dans ce cas, ce n’est pas la nature qui s’affole, c’est l’humanité qui est soudain prise de démence. Mais Un pays sans amour n’est pas du tout un livre sur le génocide. Il tourne autour sans jamais tomber dans ce trou noir. Les trois poètes n’en furent pas victimes directement, les mères de deux d’entre eux furent assassinées à Belzec, mais eux-mêmes eurent la clairvoyance de comprendre qu’il fallait partir. C’est au contraire un roman qui raconte la vitalité d’une culture, il relate l’Atlantide avant que celle-ci ne soit engloutie. Les trois poètes ne cessent de passer les frontières, Vienne, Varsovie, Kiev, Moscou, Berlin, Paris, Tel-Aviv, Melbourne, Montréal. Ils s’aiment et se déchirent, ils séduisent des femmes et les quittent, mais les retrouvent parfois. Ils viennent d’un pays sans amour, mais leurs vies sont truffées d’amour et de passions.