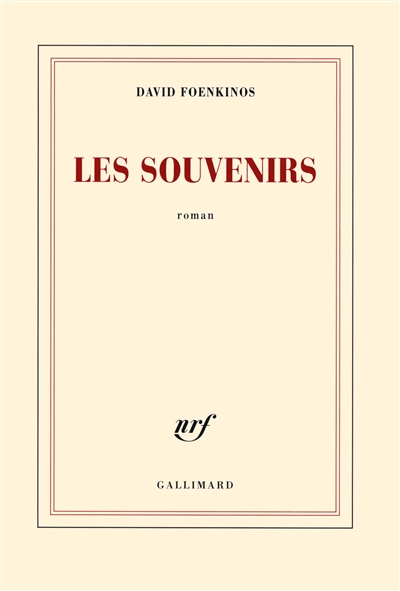PAGE : Vous vous êtes imposé en très peu d’années sur la scène littéraire française. Auteur prolifique, vous faites en plus preuve d’une grande diversité dans votre travail, puisque vous écrivez pour le théâtre et la jeunesse, vous êtes aussi nouvelliste et vous venez d’adapter votre précédent roman, La Délicatesse, au cinéma (le film devrait sortir sur nos écrans le 21 décembre). Le succès peut agacer, ce n’est pourtant pas encore avec ce roman que l’on trouvera des arguments pour vous éreinter. Il faut être, en effet, de très mauvaise humeur pour ne pas tomber amoureux de ce nouveau livre où votre héros, le narrateur, reçoit une double initiation à la vie, au monde : celle du rapport à la mort par le biais de la mort de son grand-père, et celle qui le lie au monde du travail et qui passe par son désir de se développer artistiquement au travers de l’écriture. Laquelle de ces initiations a déclenché l’écriture de ce livre ?
David Foenkinos : L’idée première consistait à parler de la vieillesse. C’est un livre plus grave que les précédents, je pense, plus personnel aussi et par moments plus complexe. La Délicatesse marche bien, mais je n’avais pas envie, malgré cette réussite, d’écrire La Délicatesse II. J’avais plutôt envie de me tenir au plus proche de ce que je ressentais à cette période de ma vie. Pour autant, il ne s’agit pas d’un texte autobiographique. C’est assurément un livre très personnel, ne serait-ce que parce que j’ai passé beaucoup de temps ces dernières années dans les maisons de retraite, et parce que j’avais une relation très forte avec la vieillesse − l’accompagnement de mes grands-parents en l’occurrence. Cette proximité avec l’extrême vieillesse m’a considérablement marqué, les maisons de retraite sont souvent la scène de moments très difficiles, et je repartais de mes visites franchement affecté… Bon, je suis en train de plomber l’ambiance. Ça commençait de manière enjouée, et puis voilà ! Je précise : mon but était de mettre de la beauté, de la fantaisie dans ce contexte effectivement lugubre, à travers le personnage de cette grand-mère incroyablement digne et qui ne comprend pas que l’on puisse envisager de quitter ce monde autrement qu’avec la beauté. En face d’elle, les choses revêtent souvent une allure pathétique. Il existe dans le quotidien des maisons de retraite des faits complètement dingues. Les menus des repas par exemple. Vous pouvez vous faire servir à table une « salade iceberg » − j’ignore si les cuisiniers pratiquent assidûment le second degré, mais tout ça fait un peu naufrage du Titanic. La décoration est également un problème récurrent des maisons de retraite, dont les salons, les chambres, les couloirs sont couverts de croûtes. À partir de ces divers éléments, je développe une réflexion sur les différentes façons de vieillir, sur le rapport à la sensualité, sur la routine, et j’entremêle ces considérations de choses plus légères. Cette grand-mère continue de déborder d’énergie, même si la sortie qui l’excite le plus… c’est de se rendre aux enterrements.
P. : Vous vous êtes imposé en très peu d’années sur la scène littéraire française. Auteur prolifique, vous faites en plus preuve d’une grande diversité dans votre travail, puisque vous écrivez pour le théâtre et la jeunesse, vous êtes aussi nouvelliste et vous venez d’adapter votre précédent roman, La Délicatesse, au cinéma (le film devrait sortir sur nos écrans le 21 décembre). Le succès peut agacer, ce n’est pourtant pas encore avec ce roman que l’on trouvera des arguments pour vous éreinter. Il faut être, en effet, de très mauvaise humeur pour ne pas tomber amoureux de ce nouveau livre où votre héros, le narrateur, reçoit une double initiation à la vie, au monde : celle du rapport à la mort par le biais de la mort de son grand-père, et celle qui le lie au monde du travail et qui passe par son désir de se développer artistiquement au travers de l’écriture. Laquelle de ces initiations a déclenché l’écriture de ce livre ?
Vous l’avez compris, le sujet est grave, le traitement l’est parfois aussi, mais, et c’est la raison pour laquelle on peut parler d’un roman de la maturité, David Foenkinos parvient à la fois à être drôle et à toucher – il manifeste un talent tout particulier dans sa faculté à faire pleurer. Et il touche si juste qu’on se demande sans cesse quelle part autobiographique il a mis dans Les Souvenirs.
D. F. : Pourtant, je ne me dis pas, tiens, ici je vais tirer les larmes du lecteur, et là je vais le faire rire. C’est très difficile de penser aux intentions. En réalité, ce qui m’importe d’abord, c’est de suivre des personnages à l’égard desquels j’éprouve une réelle tendresse. Mais pour en revenir à votre question, eh bien je ne sais pas vraiment quelle est l’importance de la dimension autobiographique de ce livre. Évidemment, Les Souvenirs est truffé d’éléments personnels, et en même temps, ce ne sont pas mes grands-parents, je n’ai pas non plus été veilleur de nuit − même si, peut-être, j’aurais aimé l’être… Par ailleurs, ce livre est une réflexion sur la jeunesse, sur le problème de trouver sa place dans la vie… C’est un roman extrêmement rond, qui compte de nombreux thèmes, qui est par moments un peu ambitieux. Certains le trouveront réussi, d’autres raté. Je tenais à aborder le rapport aux parents, le thème de la retraite, le vide du temps, le désœuvrement. La mère du narrateur, par exemple, entame une dépression parce qu’elle se retrouve seule avec son mari quand ses journées étaient jusque-là occupées par son métier de professeur. Elle est hospitalisée dans l’une des cliniques qui dépendent de la mutuelle de l’Éducation nationale. L’une des cliniques porte comme nom Camille Claudel, une autre s’appelle Vincent Van Gogh. Vous admettrez que ce n’est pas banal ! Le narrateur se dit : et pourquoi pas une clinique James Dean pour les accidentés de la route. Je cite ces exemples parce qu’ils sont à l’image de ce livre où je parle de choses difficiles et dont l’éventuelle noirceur est contrebalancée par les étrangetés qui en émanent souvent. Tenez, le père du narrateur est quelqu’un d’étonnant. L’une de ses plus grandes joies est de trouver une place pour se garer ! Il adore les choses concrètes, les choses pragmatiques, sans doute à cause de sa vie qui part progressivement en vrille. Dans l’une des scènes du roman, il conduit sa mère à la maison de retraite et lui sert un monologue interminable sur les mérites de ces institutions − ce qui le rend pathétique car il n’y a finalement pas grand-chose à avancer en faveur de la défense des maisons de retraite. Il dégotte pourtant des arguments, par exemple le fait que des excursions sont organisées pour participer à Questions pour un champion.
P. : C’est aussi l’occasion d’un bel hommage à La Grande vadrouille…
D. F. : Oui, les pensionnaires ont droit à des séances cinéma, et ce qui est fabuleux, c’est qu’on leur projette des films qu’ils n’ont jamais vus, comme La Grande Vadrouille. Le narrateur commence systématiquement par se moquer des situations, et puis finalement, en tout cas dans le cas de cette séance de cinéma, il passe l’après-midi en compagnie de sa grand-mère à regarder les excentricités de Bourvil et Louis de Funès ; il se dit qu’il est bien ce film, il ne vieillit pas. C’est un livre sur les souvenirs, alors je développe abondamment cette thématique. Ah oui ! Je voulais préciser que c’est la seconde fois que j’ai l’idée du titre avant de commencer le livre. Avec La Délicatesse déjà, le livre s’est construit autour de cette notion de délicatesse, et là, j’ai écrit le livre en pensant à l’idée des souvenirs.
P. : À l’instar de La Délicatesse où vous apportiez des sortes de compléments aux chapitres, des digressions farfelues (par exemple, vous imaginiez la discographie de John Lennon s’il avait survécu à son assassinat en 1980), vous incorporez dans votre nouveau roman des souvenirs : au début du récit, logiquement, vous glissez un souvenir du grand-père mais lorsque nous nous attendons à lire successivement les souvenirs de la famille, très vite vous jouez de ces souvenirs et de notre attente. Ainsi lors d’une discussion entre le patron de l’hôtel et le personnage, le premier raconte à notre narrateur que Patrick Modiano a commencé comme veilleur de nuit dans un hôtel. Et hop, après ce chapitre, nous retrouvons un souvenir de Patrick Modiano. Derrière cette fantaisie qui apporte du rythme au récit et suscite chez le lecteur une espèce d’impatience vis-à-vis de la prochaine trouvaille, derrière toute cette drôlerie on constate que les caractères des personnages s’épaississent et que les situations gagnent en subtilité. C’est très touchant.
D. F. : Et puis si on n’aime pas le livre, on aura au moins l’opportunité d’apprendre des choses. C’est vrai, j’ai glissé pas mal d’anecdotes dans la trame. Je raconte un souvenir de Fitzgerald seul, vieux et misérable, qui apprend que l’une de ses pièces est mise en scène. Il rend visite à la troupe et l’une des comédiennes s’exclame : « Je croyais que vous étiez mort ! » Il y a aussi cet article qui a accueilli le premier film de Claude Lelouch par un cinglant : « Souvenez-vous que vous n’entendrez plus jamais parler de ce cinéaste. » Tout ça pour dire que j’ai tenté de construire un jeu autour des souvenirs des personnages. Je m’explique : en me rendant dans une maison de retraite, je me suis fait la réflexion que toutes ces personnes avaient vraisemblablement été confrontées au cours de leur existence à des problèmes de courrier, des problèmes pour se garer. Dans le roman, l’un des pensionnaires ne peut pratiquement plus bouger, ne reçoit aucune visite, bave… Et moi, je plonge dans les souvenirs de son passé de champion de boxe confronté à des ennuis dans sa vie sentimentale. Bon, et puis je vais dire que c’est un polar ! J’ai crée une intrigue autour de la disparition de la grand-mère. Ça fait quinze minutes que tout le monde se dit : « Jamais je ne lirai ce livre », mais maintenant que vous savez qu’il y a une enquête, hein ! Malheureusement, mon héros est très déçu parce qu’il trouve la solution trop rapidement à son goût. Il était content, il se passait enfin quelque chose dans son quotidien, il voyait déjà se profiler une existence flamboyante… Et flop.
P. : Vous vous en prenez aussi à la peinture…
D. F. : Oui ! Il y a ce fameux tableau hideux avec vache. C’est quand même bizarre d’offrir la postérité à une vache, non ? Ce tableau est tellement laid que chaque fois que mon personnage et sa grand-mère sont déprimés, ils s’arrêtent devant et ça leur remet du baume au cœur. Je pense que la laideur peut générer de la joie. Le narrateur déclare à un moment qu’il est important d’avoir accès à la laideur. J’avais donc l’idée de ce portrait d’une vache quand j’ai entrepris le livre, et elle a pris une importance croissante au fil de l’écriture. Pour tout vous dire, je me suis attaché à elle. Ce serait bien de la reproduire sur le bandeau, non ?