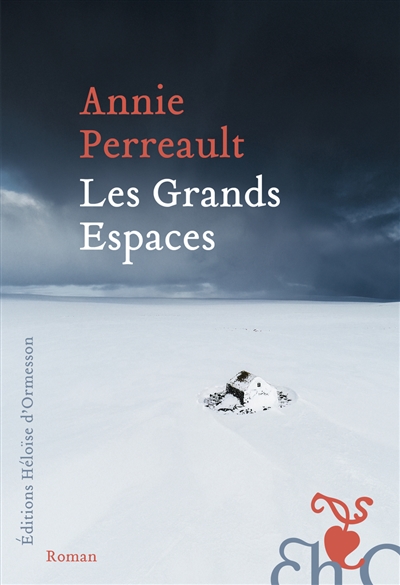Les Grands Espaces est une fiction qui met en scène les espaces géographiques mais aussi la distance entre les gens. Comment définissez-vous ces grands espaces du titre ?
Annie Perreault - J’avais envie d’explorer le rapport au paysage, du point de vue du froid. Dans ma jeunesse, j’ai étudié en Russie. C’était pour moi l’occasion de revisiter un pays que j’ai aimé et perdu de vue. Je suis quelqu’un qui court dans la vie et l’hiver, je cours sur le lac Champlain. J’ai eu envie de transposer cette expérience sur le lac Baïkal. Rapidement, en pensant à ce qu’est le froid, la froideur, j’ai imaginé cette espace comme un lieu de rencontres.
D’où vient votre fascination pour le lac Baïkal ?
A. P. - Quand je me suis lancée dans l’écriture de ce roman, je savais que le lac occuperait une place majeure mais je ne l’avais pas encore visité. Au fur et à mesure, ce roman est devenu aussi l’histoire d’une prise de risque. Celui de faire cette traversée dans le cadre d’un marathon. Je n’avais jamais connu une telle expérience. Le lac est un lieu sacré pour les Russes. Une dimension spirituelle à laquelle je n’adhérais pas forcément avant d’amorcer cette traversée. Mais j’ai couru dans un état de grâce sur cette immensité blanche. Quand je suis rentrée à Montréal, c’était le début de la pandémie. Le monde était dans un drôle d’état et cela m’a donné un élan pour traverser la fin de l’écriture de ce roman. J’ai alors décidé que le lac allait prendre la parole, qu’il serait un observateur, car ces eaux qui existent depuis des millénaires doivent prendre la parole.
Un jour, le lac rencontre Anna qui, dans un élan de liberté, tente la traversée. On ne sait pas d’où elle vient, pourquoi elle est là, à la fois révoltée et chancelante. Derrière elle, l’Ours tente de la rattraper. Qui est Anna ?
A. P. - C’est le personnage qui est apparu en premier. J’avais cette idée d’explorer le mouvement d’une femme qui répond à une impulsion pure, sans savoir ce qui l’attend. La rencontre avec l’Ours se fait dans cet état d’esprit inattendu où on se met à se confier et à s’apprivoiser. Je souhaitais un roman vu de l’extérieur où les personnages seraient exposés et où ils pourraient se confier à la faveur de ce paysage.
Ce roman parle de femmes et notamment d’une certaine Eleonore qui tombe amoureuse de Youri Gagarine sans l’avoir jamais rencontré !
A. P. - Avec Eleonore, nous sommes dans les années 1960 après le retour de Youri Gagarine. Elle développe une forme de fascination pour le cosmonaute, assez mal perçue par son entourage. C’est un personnage que j’ai eu beaucoup de plaisir à écrire. Elle connaîtra un destin tragique, notamment à cause d’une mauvaise prise en charge des troubles mentaux à l’époque. Elle apparaît dans le récit au détour de la rencontre dans un train entre Anna et Gaby, sa nièce, qui va lui raconter son histoire. Une manière de raconter ceux que l’on porte en soi, nos traces familiales.
Vous reliez en permanence le territoire à la quête identitaire que chacun porte en lui, notamment par ces portraits de femmes qui font le choix de la liberté et d’avancer.
A. P. - Cela me fait plaisir que vous ne parliez pas de femmes en fuite car pour moi il y a une distinction. Ce sont des femmes qui répondent à un élan qui vient d’elles, en réponse à un élément extérieur qui les propulse vers l’avant ou vers une quête de sens dans leur vie. Elles restent en mouvement malgré les difficultés et les aléas de l’existence.
Et puis il y a ce personnage, énigmatique, dont nous n’avons pas encore parlé : celle que l’on ne voit pas !
A. P. - Elle s’est ajoutée vers la fin du processus d’écriture. Comme si les réflexions que j’avais menées par rapport à la création et mes choix personnels s’intégraient naturellement au roman. Mais c’était une prise de risque : comment être à la fois du côté de la fiction et, de l’autre, du récit de soi ? Avec celle qu’on ne voit pas, je parle aussi d’effacement et de la manière dont on s’efface dans l’acte d’écriture.
Dans la rudesse du froid sibérien, une femme avance sur le lac Baïkal. Elle fonce, chancelante sous les coups du vent, déterminée à faire la traversée de ces eaux gelées qui l’observent et la sondent. Inspiré par un irrésistible élan de liberté, cet acte de pure folie la pousse à comprendre son histoire. Dans ce beau roman où le froid s’immisce dans les interstices de la vie, Annie Perreault s’enflamme pour ces femmes : Anna, Gaby, Eleonore et « celle qu’on ne voit pas ». Des femmes qui choisissent d’affronter la tempête afin de combler les manques d’une vie qui ne leur correspond pas. Les lieux exacerbent les fissures et les obsessions mais permettent surtout les rencontres inattendues, celles qui ravivent l’espoir à l’occasion de ce voyage vers l’autre et vers soi.