Essais
Vae victis !
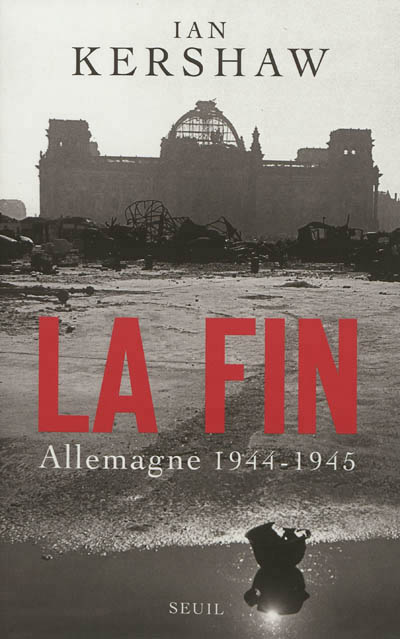
-
Ian Kershaw
La Fin
Traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat
Seuil
30/08/2012
672 pages, 26 €
-
Dossier de
Valérie Wosinski
Pigiste () -
❤ Lu et conseillé par
9 libraire(s)
- Laurence Behocaray de I.U.T. Carrières sociales, Université (Tours)
- Geneviève Gimeno de Maupetit (Marseille)
- Dominique Paschal
- Jean-François Delapré de Saint-Christophe (Lesneven)
- Cyril Canon
- Guillaume Le Douarin
- Stanislas Rigot de Lamartine (Paris)
- Julie Uthurriborde de Montmartre (Paris)
- Pauline Brun de Sauramps Cévennes (Alès)

-
R.M. Douglas
Les Expulsés
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Laurent Bury
Flammarion
05/09/2012
512 pages, 26 €
-
Dossier de
Valérie Wosinski
Pigiste ()
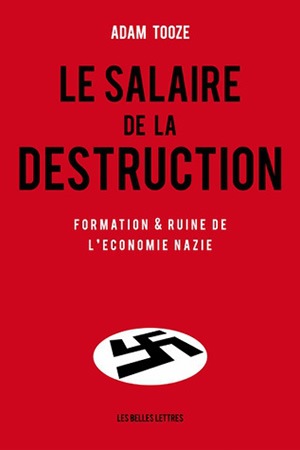
-
Adam Tooze
Le Salaire de la destruction
Traduit de l'anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat
Les Belles Lettres
15/10/2012
832 pages, 29,50 €
-
Dossier de
Valérie Wosinski
Pigiste () -
❤ Lu et conseillé par
2 libraire(s)
- Jonathan Burgun de Maison du livre (Rodez)
- Raphaël Rouillé de de Saint-Christol-lez-Alès (Saint-Christol-lez-Alès)
✒ Valérie Wosinski
(Pigiste )
La Seconde Guerre mondiale est en nette faveur dans le secteur de l’édition. Pour autant, les publications se suivent et ne se ressemblent pas. Car ce qui importe, ce sont les travaux qui complètent ou renouvellent notre compréhension des événements. C’est le cas – éminemment – de trois ouvrages qui paraissent à la rentrée.
L’idée selon laquelle Hitler aurait réussi à résorber le chômage en Allemagne, notamment par une politique de grands travaux, est encore largement répandue. La conquête allemande, assise sur une économie forte, aurait renversé tous les obstacles grâce à une Blitzkrieg apte à démontrer la valeur d’une organisation impeccable. Pour ce qui est de la Blitzkrieg, on sait désormais qu’elle surprit en premier lieu l’état-major allemand lui-même. La somme imposante d’Adam Tooze achève de battre en brèche l’image d’une Allemagne à l’économie florissante grâce au nazisme. En premier lieu, Hitler a bénéficié des mesures prises avant son accession au pouvoir, mesures qui n’ont produit leurs effets que progressivement. Si le taux de chômage a baissé, ce n’est donc pas grâce à la construction d’un réseau autoroutier (ou du moins très marginalement) ni par une relance de la consommation, ainsi que la propagande a pu le proclamer. En revanche, l’orientation nationaliste de l’économie a été choisie très tôt par Hjalmar Schacht, président de la Reichsbank puis ministre de l’Économie du IIIe Reich. La politique menée par ce dernier a consisté à refuser de continuer à honorer les indemnités allemandes réclamées par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, à rompre les échanges avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, et à accroître les facilités accordées aux chefs d’entreprise au détriment des employés. C’est toute l’économie qui fut réorientée en vue du réarmement. Mais cet isolement de l’Allemagne (quoique partiellement compensé par des partenariats, notamment avec le Brésil), n’était pas viable. Le manque de devises contraignit les autorités du Reich à recourir à un dirigisme financier permanent dans une logique de fuite en avant, en se servant des annexions pour palier les déficiences du système (le manque de matières premières en premier lieu). L’étude profonde et détaillée d’Adam Tooze montre de façon éclatante que l’expansionnisme nazi n’était finalement pas moins ordonné par l’économie que par l’idéologie. La suite des événements, conquêtes, exploitation, extermination, défaite, est connue dans ses grandes lignes. Mais la durée même de la guerre ne laisse pas de susciter des interrogations. Comment l’Allemagne a-t-elle pu résister si longtemps alors qu’elle était prise en étau entre, d’un côté l’Armée rouge, d’un autre les forces Alliées débarquées en Normandie, et d’un autre encore le recul du front italien ? Si l’on ajoute à cela la totale maîtrise du ciel par les Alliés et les privations sans cesse grandissantes d’une population à la merci de bombardements croissants (400 000 morts, 800 000 blessés), on ne peut que se demander ce qui a permis à Hitler de rester encore au pouvoir, a fortiori après l’attentat du 20 juillet 1944. Ce sont ces questions auxquelles répond Ian Kershaw dans son dernier livre. Il le fait en montrant à quel point la pression totalitaire s’est accrue sur la population allemande dans la dernière année de la guerre. Certes, pendant longtemps, le Führer avait joui de la confiance des Allemands, qui le croyaient souvent mal conseillé. Mais peu à peu, Hitler devint la cible des critiques de la population. L’attentat de Stauffenberg avait achevé de ruiner le peu de confiance de Hitler en ses généraux. De sorte que ceux qui n’étaient pas compromis dans le complot et qu’il ne jugeait pas incompétents étaient également les plus fanatisés. Les ordres absurdes qui enjoignaient à des soldats épuisés et débordés de résister à tout prix entraînèrent la mort inutile de centaines de milliers d’Allemands. Tout signe de tiédeur ou de renoncement était passible de la peine de mort, appliquée sans jugement et sur-le-champ par des escadrons volants déployés à l’arrière du front. Un front qui, se rapprochant de plus en plus de Berlin, apportait son lot d’horreurs dans cette guerre qui ne distinguait pas les civils des militaires. Les viols étaient une pratique systématique des armées russes, et la sauvagerie de ses soldats ne laissait aucun espoir à ceux qui auraient voulu se rendre. Le mot d’ordre était alors souvent : « plutôt la fin dans l’horreur qu’une horreur sans fin ». Que les potentats nazis, qui avaient concentré le pouvoir dans leurs mains (Goebbels, Speer, Himmler et Bormann), se soient perpétuellement opposés les uns aux autres, que les généraux se soient sentis liés à Hitler par leur serment ou par idéologie, que les fonctionnaires aient continué à servir l’État, voilà qui explique la poursuite de la guerre. Et pour le peuple allemand, une terreur de plus en plus forte. Jusqu’à la fin. Encore les souffrances ne s’achevèrent-elles pas avec la fin des combats. R. M. Douglas revient sur un épisode peu connu de l’immédiat après-guerre, quand les pays limitrophes de l’Allemagne (Pologne et Tchécoslovaquie principalement) expulsèrent les populations germanophones de leur territoire. Il en résulta « le plus vaste transfert forcé de population que l’humanité ait connu » et un nombre de morts estimé entre 500 000 et un million et demi… Les Alliés fermèrent les yeux sur des pratiques barbares, les conditions de transport et la malnutrition étant les principaux facteurs de mortalité. Or ces populations n’étaient souvent allemandes que d’origine, installées depuis plusieurs générations in situ, mais elles se retrouvèrent prises au piège des enjeux nationalistes pour lesquelles l’existence des minorités était par essence problématique. La mémoire de l’Europe repose également sur ces tragédies qu’on passe sous silence.

